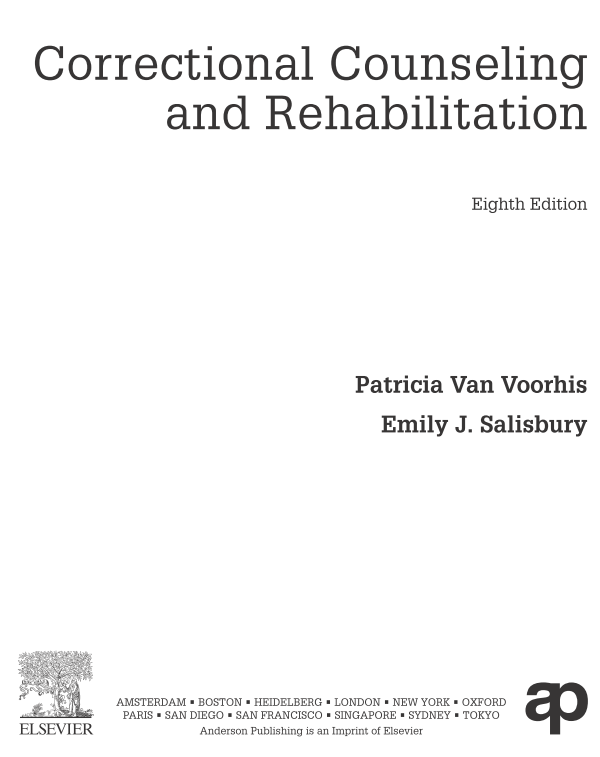 Petit focus, dans l’excellent ouvrage de P Van Voorhis et E Salisbury (2022), sur certaines limites auxquelles les professionnels peuvent être confrontés.
Petit focus, dans l’excellent ouvrage de P Van Voorhis et E Salisbury (2022), sur certaines limites auxquelles les professionnels peuvent être confrontés.
EXIGENCES CONTEXTUELLES
« L’environnement correctionnel lui-même est à l’origine d’une foule de questions et d’exigences. Le conseiller y est confronté régulièrement et son travail en est d’autant plus difficile et stressant. La capacité du conseiller à négocier efficacement ces exigences déterminera, dans une large mesure, sa susceptibilité à l’épuisement professionnel qui affecte si souvent les professionnels de l’aide. Plusieurs des exigences contextuelles les plus importantes sont examinées dans cette section.
Travailler dans un environnement bureaucratique
Une prison est l’exemple même de la bureaucratie. C’est une organisation dominée par les règles et la paperasserie, qui ignore souvent les individus au profit des procédures (Pollock, 1998). En outre, les établissements pénitentiaires adhèrent à un style de gestion paramilitaire avec une chaîne de commandement verticale (Elliott & Verdeyen, 2002). De toute évidence, certaines personnes se sentent plus à l’aise que d’autres dans une telle structure et s’y adaptent plus facilement. Les professionnels du traitement correctionnel peuvent notamment avoir du mal à faire face à la régimentation et à la rigidité si endémiques au fonctionnement des prisons. Les conseillers qui tentent de « contourner le système » se heurtent au proverbial mur de briques et finissent par être frustrés, désillusionnés et peu ou pas utiles aux délinquants. Les conseillers qui, en revanche, consacrent leur temps et leur énergie à se faire une place au sein de la bureaucratie deviendront des membres précieux de l' »équipe » correctionnelle.
Gérer l’excès de paperasserie
Le dossier écrit est l’élément le plus important du système de justice pénale. Quelle que soit l’importance de l’événement, tout ce qui est fait pour, par ou à un délinquant trouve son origine ou son aboutissement dans un rapport ou un dossier correctionnel (Schrink, 1976). La nature et la fonction exactes des rapports et des dossiers, ainsi que le type de personne chargée de les élaborer et de les tenir à jour, varient quelque peu en fonction de l’étape du système de justice pénale concernée. Au niveau correctionnel, c’est le conseiller qui est le plus responsable de la collecte des informations et de la rédaction des rapports. Plusieurs types de dossiers et de rapports différents doivent être élaborés périodiquement pour chaque délinquant. En raison du grand nombre de détenus dans un cas typique, la paperasserie qui en résulte peut souvent être énorme. Le temps consacré à la paperasserie réduit les possibilités pour le conseiller d’interagir avec le client. Malheureusement, certains conseillers inefficaces ont appris à se cacher derrière cette paperasse. Une évolution positive qui peut aider le conseiller correctionnel à mieux gérer la paperasserie est la disponibilité croissante d’ordinateurs personnels et de logiciels relativement bon marché.
Gestion d’un grand nombre de dossiers
Les conseillers doivent souvent s’occuper d’une centaine de détenus. L’ampleur de la charge de travail est encore aggravée par le fait qu’il y a généralement une rotation assez rapide des détenus qui en font partie. Si le séjour moyen d’un détenu dans un établissement est de deux ans et qu’un conseiller a une charge de travail de 125 détenus, il se peut qu’il ne connaisse jamais vraiment l’un d’entre eux avant sa sortie.
Non seulement la charge de travail est importante, mais elle est également très variée. Le conseiller doit accepter tous les détenus qui lui sont assignés, et il existe peu de possibilités de développer une clientèle spécialisée. Souvent, les détenus ont peu de choses en commun, si ce n’est qu’ils ont été reconnus coupables d’un crime et condamnés à un établissement ou à un programme correctionnel. Il n’est pas rare qu’un conseiller d’un établissement hébergeant des délinquants adultes ait à sa charge des détenus qui ont été condamnés pour meurtre, vol, viol, pédophilie, conduite en état d’ivresse, ivresse publique, et bien d’autres délits encore.
Sous une telle pression, le conseiller correctionnel peut être tenté de se concentrer sur les détenus avec lesquels il aime interagir plutôt que sur ceux qui ont le plus besoin d’aide. Les délinquants doivent être vus parce qu’ils ont besoin d’être vus, et non parce qu’ils veulent organiser leur temps libre en fonction du conseiller. De même, ils ne doivent pas être vus uniquement parce que le conseiller aime interagir avec eux et qu’il est capable de rationaliser le fait qu’il ne peut de toute façon pas aider tous les détenus dont il s’occupe.
Répondre à l’asymétrie raciale et ethnique
Aujourd’hui, plus de 60 % des détenus sont noirs ou hispaniques, et rien n’indique que cette asymétrie raciale et ethnique va diminuer de sitôt. Les conseillers correctionnels, comme la plupart des gens, ont tendance à recourir à l’ethnocentrisme lorsqu’ils ont affaire à des personnes différentes d’eux. L’ethnocentrisme consiste à juger les autres sur la base de ses propres croyances plutôt que sur celles des autres. L’ethnocentrisme est étroitement lié à la tendance humaine trop courante à stéréotyper les autres, c’est-à-dire à juger les gens sur la base de caractéristiques de groupe supposées plutôt que de les voir et de réagir à leur égard en tant qu’individus. De toute évidence, l’ethnocentrisme et les stéréotypes sont synonymes d’échec dans un établissement pénitentiaire.
Le conseiller correctionnel peut éviter bon nombre des problèmes liés à l’ethnocentrisme et aux stéréotypes s’il adopte une approche plus sensible à la race et à l’ethnie. Une telle approche est souvent qualifiée de counseling » interculturel » ou multiculturel (Dillard, 1987). Plus précisément, les conseillers correctionnels doivent essayer d’élargir et d’approfondir leurs connaissances et leur compréhension des groupes raciaux et ethniques diversifiés afin de pouvoir comprendre d’où viennent ces personnes et de commencer à les voir comme des individus plutôt que comme un groupe plus large. L’ACA a également choisi de s’attaquer à l’ethnocentrisme en modifiant les sections existantes du code de déontologie afin de mieux comprendre les problèmes particuliers associés au conseil multiculturel (ACA, 2005).
Travailler avec des délinquants ayant des besoins particuliers
Les conseillers correctionnels novices sont souvent surpris de constater que leur charge de travail se compose de délinquants souffrant de maladies mentales graves, de troubles du développement et de problèmes de toxicomanie. De plus en plus, ces « délinquants à besoins spéciaux » se retrouvent dans les populations carcérales et présentent des besoins de traitement et des défis uniques pour les conseillers. Les conseillers qui travaillent avec des femmes délinquantes seront confrontés à des exigences supplémentaires, car ces délinquantes présentent souvent une variété de problèmes familiaux et sociaux, y compris leurs relations avec leurs enfants et des antécédents d’abus physiques ou sexuels. L’une des sous-populations qui a connu la croissance la plus rapide depuis les années 1960 est celle des délinquants souffrant de maladies mentales. En 1998, on estimait à près de 300 000 le nombre de détenus souffrant de maladies mentales.
mentaux étaient hébergés dans les prisons et les centres pénitentiaires, ce qui représentait 15 % de la population carcérale (Schwartz, 2003). Les institutions correctionnelles ont souvent eu du mal à répondre aux besoins de ce groupe. En 1991, on estimait que seulement 50 % des personnes souffrant d’une maladie mentale grave et 25 % de celles souffrant d’une maladie mentale modérée dans les prisons américaines recevaient un niveau de soins approprié (Schwartz, 2003).
Un autre groupe important de détenus particulièrement vulnérables aux abus dans les prisons est celui des personnes souffrant de troubles du développement. Les détenus souffrant d’un retard mental ou d’autres déficiences cognitives peuvent être des cibles tentantes pour les abus physiques ou sexuels. En outre, le premier auteur a observé que ces personnes sont souvent enrôlées par d’autres détenus pour aider à commettre des crimes au sein de l’institution. Elles peuvent également avouer des infractions dont elles ne sont pas coupables.
Sur les 1,3 million de prisonniers incarcérés dans les établissements pénitentiaires américains, 21 % des prisonniers d’État, 57 % des détenus fédéraux et 21 % des détenus de prison sont incarcérés pour des délits liés à la drogue (Bureau of Justice Statistics, 2006a).
En outre, de nombreux liens ont été établis entre l’abus de substances et le comportement criminel (Walters, 1998). Les toxicomanes font état d’une activité criminelle beaucoup plus importante et ont des casiers judiciaires plus chargés que les non-consommateurs, tandis que les personnes ayant des antécédents criminels plus importants sont plus susceptibles de faire état d’un abus de substances antérieur (Peters & Matthews, 2003). Compte tenu de l’ampleur des problèmes d’abus de substances chez les détenus, les conseillers correctionnels devraient considérer le traitement de l’abus de substances comme un élément essentiel des services de counseling offerts à la population carcérale.
population carcérale. Walters (1998) propose des lignes directrices complètes et spécifiques pour la construction et la mise en œuvre d’un traitement efficace de l’abus de substances.
L’une des conclusions les plus largement acceptées dans la recherche criminologique est que les hommes sont arrêtés à un taux plus élevé que les femmes (Holtfreter, Reisig, & Morash, 2004). Bien que l’écart entre les sexes reste important, il s’est réduit au cours des trois dernières décennies (Pollock, 1998). Les délinquantes sont beaucoup plus susceptibles de demander des services de conseil, bien qu’elles ne soient pas plus motivées par un changement sincère que leurs homologues masculins (Elliott & Verdeyen, 2002). En outre, les délinquantes recherchent activement des services de conseil pour aborder les questions d’abus sexuels/physiques antérieurs et de séparation d’avec leurs enfants (Hislop, 2001). Par conséquent, le conseiller correctionnel qui travaille dans une prison pour femmes devra fournir une variété de services de conseil à une partie importante de la population.
Fournir des services d’intervention en cas de crise
Conseiller des délinquants incarcérés ayant des tendances criminelles profondément ancrées est une tâche ardue, et un véritable changement cognitif et comportemental peut s’avérer impossible dans de nombreux cas (Harris, 1995). En effet, la pathologie du délinquant typique est considérée par certains comme non modifiable (McMackin, Tansi, & LaFratta, 2004). Par conséquent, le travail avec ces délinquants, en particulier dans les institutions, se résume souvent à une intervention en cas de crise, c’est-à-dire à aider les détenus à gérer les crises naissantes.
Les établissements correctionnels sont incontestablement des environnements stressants et les délinquants doivent faire face à toute une série de problèmes résultant de l’incarcération. Il s’agit notamment, mais pas exclusivement, de la séparation d’avec les membres de la famille, de l’imposition d’une structure dans la vie d’une personne, de la perte des stratégies d’adaptation antérieures (par exemple, la consommation d’alcool et de drogues) et de la peur de l’environnement carcéral lui-même (par exemple, la violence physique ou sexuelle) (Morgan, 2003). Certains délinquants s’épanouissent dans la structure environnementale et le « code du détenu » (c’est-à-dire les règles de conduite non écrites) (Elliott & Verdeyen, 2002). Beaucoup s’adaptent simplement et se fondent dans l’environnement, tandis que d’autres éprouvent d’importantes difficultés d’adaptation et une détresse intérieure. En conséquence, des services d’intervention en cas de crise et des services de conseil de soutien de courte durée sont nécessaires pour aider ce dernier groupe à s’adapter à sa nouvelle vie de détenu.
Les difficultés d’adaptation ne se limitent évidemment pas aux détenus nouvellement incarcérés ; au contraire, l’anxiété et le stress chroniques sont des sous-produits inévitables de l’incarcération (Morgan, 2003). Les délinquants condamnés à des peines de courte ou de longue durée sont confrontés à divers facteurs de stress et à des problèmes de vie qu’ils doivent gérer.
Par exemple, il n’est pas rare que les membres de la famille ou les proches cessent de communiquer avec les délinquants, privant ainsi ces derniers d’une précieuse source de soutien social (Lynch & Sabol, 2001). Même les délinquants proches de leur libération éprouvent de l’appréhension et de l’anxiété, ce que l’on appelle « se mettre à l’abri ». Des questions telles que la reprise de contact avec les membres de la famille, la recherche d’un emploi et l’évitement d’un comportement criminel deviennent les principaux sujets de préoccupation.
Le conseiller correctionnel sera, à un moment ou à un autre de sa carrière, appelé à fournir des services de soutien en cas de crise à des détenus suicidaires. Le suicide est la première cause de décès dans les centres de détention et les prisons, et la deuxième cause de décès dans les prisons (Morgan, 2003). Il est donc nécessaire que les conseillers connaissent parfaitement les facteurs de risque démographiques, historiques, situationnels et psychologiques du suicide (White, 1999). En outre, le conseiller devra être prêt à fournir des services de soutien aux délinquants ayant des besoins particuliers, dont il a été question dans une sous-section précédente. Enfin, le conseiller correctionnel devra sans aucun doute amené à offrir des services de soutien aux délinquants qui sont victimes d’abus physiques ou sexuels de la part de détenus prédateurs.
Survivre à la brutalité de l’environnement carcéral
Il est évident que les prisons sont des environnements brutaux. Les agents pénitentiaires assistent à des manifestations de violence de la part des détenus, reçoivent des insultes et des menaces de la part des délinquants et observent ou, si nécessaire, participent à l’application de la force physique pour maîtriser un détenu perturbateur. Une telle exposition à la violence et à l’agression peut être une pilule amère à avaler pour de nombreux conseillers ; après tout, beaucoup entrent dans le secteur correctionnel pour « aider » les délinquants et « trouver ce qu’il y a de bon » en eux. Cependant, presque tous ceux qui ont fait carrière dans le milieu correctionnel ont connu un processus de « normalisation » (Welo, 2001) qui peut atténuer le choc, le dégoût, la peur et la colère ressentis après avoir été témoins de violence et d’autres comportements antisociaux. Malheureusement, les conseillers correctionnels sont encore confrontés à la violence et à la destruction perpétrées par les délinquants. On attend des conseillers qu’ils se familiarisent avec les rapports d’enquête et autres documents concernant les délinquants qui leur sont confiés. Ces rapports regorgent d' »histoires d’horreur sur les crimes [des délinquants], les déclarations des victimes, l’angoisse des membres de leur famille et [leur] degré de criminalité » (Welo, 2001, p. 166). L’exposition répétée aux récits de la douleur et de la misère causées par les délinquants peut conduire au cynisme, à la désillusion et, en fin de compte, à l’épuisement professionnel (Elliott & Verdeyen, 2002).
CONSIDÉRATIONS FINALES
Ce chapitre a été consacré à l’exploration des défis nombreux et diversifiés auxquels est confronté le conseiller correctionnel. Nous espérons que le lecteur a maintenant une bonne compréhension des complexités inhérentes à l’élaboration de stratégies de conseil efficaces auprès d’une population hostile et résistante, à la résolution des divers dilemmes éthiques endémiques au conseil dans un établissement correctionnel et à la négociation des exigences contextuelles uniques du conseil en milieu carcéral. Toutefois, cette discussion serait incomplète si l’on n’abordait pas la question de la prévention de l’épuisement professionnel.
Dans un effort concerté pour aider le conseiller correctionnel à ne pas succomber à l’épuisement professionnel et à ses conséquences physiques et émotionnelles délétères, Elliott et Verdeyen (2002) ont proposé 10 stratégies de prévention de l’épuisement professionnel et de satisfaction professionnelle. Ces stratégies, appelées « Les dix commandements pour le personnel pénitentiaire », sont énumérées dans la figure suivante:
| Dix commandements pour le personnel pénitentiaire. Elliott & Verdeyen, 2002. |
| 1. Rentrer chez soi sain et sauf à la fin de la journée |
| 2. Établir des attentes réalistes (pour soi-même, les délinquants et les autres membres du personnel). |
| 3. Fixer des limites fermes et cohérentes. |
| 4. Éviter les luttes de pouvoir. |
| 5. Gérer les limites interpersonnelles. |
| 6. Ne pas prendre les choses personnellement. |
| 7. S’efforcer d’adopter une attitude de scepticisme sain. |
| 8. Ne vous battez pas contre la bureaucratie. |
| 9. Demandez de l’aide (à vos supérieurs et à vos collègues). |
| 10. N’emportez pas votre travail chez vous. |
Enfin, les auteurs de ce chapitre recommandent au conseiller correctionnel de faire de son mieux pour conserver et exercer un bon sens de l’humour. e Même l’humour dit « de mauvais goût » peut être un moyen efficace de se distancier des situations choquantes, dégoûtantes ou dangereuses, et d’éviter des réactions émotionnelles et comportementales injustifiées à de telles situations (Kauffman, 1988). De même, l’un des meilleurs moyens de faire face à la tromperie et à la manipulation de l’agresseur est de réfléchir aux leçons à tirer d’une telle victimisation, de rire de soi et de passer à autre chose (Elliott & Verdeyen, 2002). »


Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.