Pourquoi utiliser l’entretien motivationnel avec les mineurs délinquants ?
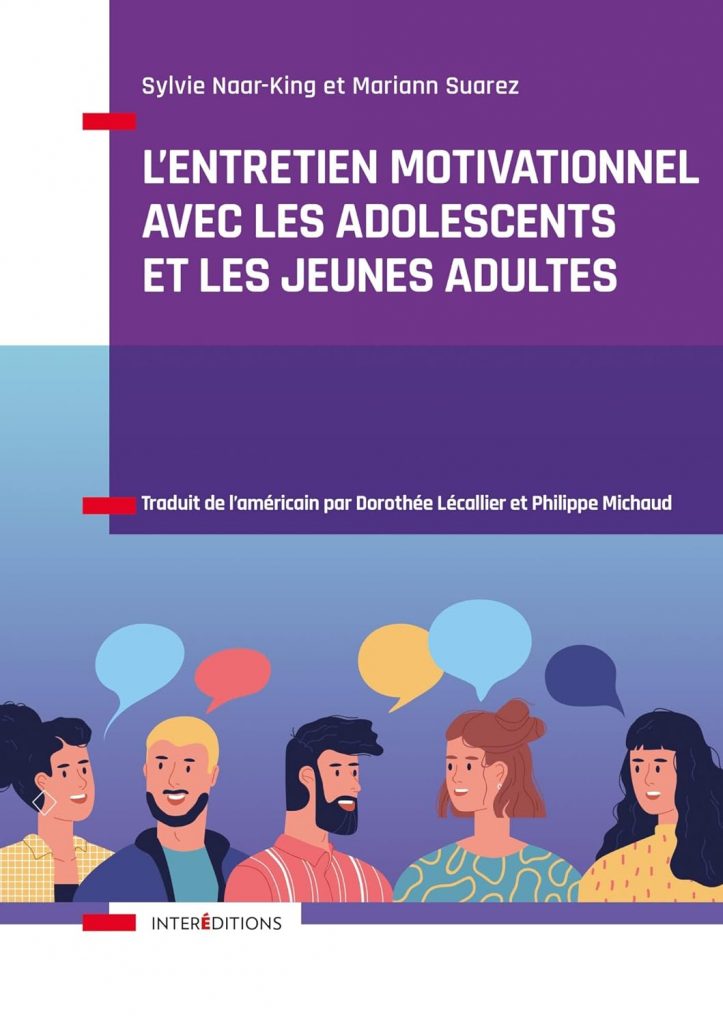 1. Une réponse adaptée à l’ambivalence adolescente
1. Une réponse adaptée à l’ambivalence adolescente
Les adolescents en conflit avec la loi présentent fréquemment une ambivalence quant à leurs comportements et à la nécessité de changer. L’EM, en facilitant l’exploration de cette ambivalence, permet au jeune de prendre conscience de ses motivations profondes et de ses valeurs, favorisant ainsi un engagement plus authentique dans un processus de changement.
2. Renforcement de l’alliance thérapeutique
L’établissement d’une relation de confiance est essentiel dans l’accompagnement des mineurs délinquants. L’EM, par son approche empathique et non jugeante, favorise la création d’une alliance thérapeutique solide, condition sine qua non pour un travail efficace.
3. Efficacité démontrée dans divers contextes
Des études ont montré que l’EM est efficace dans la réduction des comportements à risque chez les adolescents, notamment en matière de consommation de substances, de comportements violents ou de récidive. Son intégration dans les programmes de réhabilitation pour mineurs délinquants a permis d’améliorer l’engagement des jeunes et les résultats des interventions.
Comment mettre en œuvre l’entretien motivationnel auprès des mineurs délinquants ?
1. Adapter l’approche au développement adolescent
Il est crucial de tenir compte des spécificités du développement cognitif et émotionnel des adolescents. Cela implique d’utiliser un langage accessible, de respecter leur besoin d’autonomie et de valoriser leurs compétences et réussites.
2. Intégrer l’EM dans une approche multidisciplinaire
L’EM peut être combiné avec d’autres approches, telles que les thérapies cognitivo-comportementales, pour renforcer son efficacité. Cette intégration permet d’aborder les différentes dimensions des problématiques rencontrées par les mineurs délinquants.
3. Former les professionnels à l’EM
Pour une mise en œuvre efficace, il est essentiel que les intervenants soient formés aux principes et techniques de l’EM. Des formations spécifiques sont disponibles pour les professionnels travaillant avec des adolescents en difficulté
Extrait de « l’EM avec des adolescents et les jeunes adultes » (Naaar-king & Suarez 2011):
« PLUS DE 150 000 ADOLESCENTS SONT INCARCÉRÉS chaque année aux Etats-Unis d’Amérique. Les jeunes sous main de justice ont de multiples problèmes de santé mentale, en particulier l’usage de substances psycho-actives (SPA). Des prévalences élevées d’usage de substances ont été relevées chez les détenus, particulièrement pour l’alcool et le cannabis (McClelland, Elkington, Teplin & Abram, 2004). De même, les troubles psychiatriques sont fréquents chez ces adolescents (Teplin, Abram, McClelland, Dulan & Mericle, 2002), parmi lesquels les troubles anxieux, psycho-affectifs et ceux du comportement (Teplin, 2001). Enfin, ces adolescents sont engagés dans des troubles comportementaux variés qui les mettent, ainsi que leur entourage, en risque de développer divers dommages graves.
Les adolescents confrontés à la justice sont à haut risque pour deux situations, celle de la conduite sous l’emprise de l’alcool ou d’une autre substance (CEA/AS), et celle d’être le passager d’un conducteur sous l’emprise de l’alcool ou d’une autre substance (PCEA/AS) (Stein & al., 2006). Une étude portant sur 130 adolescents incarcérés indiquait que 58 % et 81 % d’entre eux avaient
respectivement connu l’une ou l’autre de ces deux situations dans les 12 derniers mois, les substances envisagées étant l’alcool et/ou le cannabis (Stein, 2004). Une autre étude montrait que 95 % des détenus adolescents avaient eu une expérience de sexe non protégé (vaginal ou anal) (Teplin, Mericle, McClelland & Abram, 2003).
On a montré que les adolescents incarcérés, lorsqu’on les compare avec des adolescents non incarcérés, utilisent les préservatifs de façon insuffisante (Nagamune & Bellis, 2002 ; Rickman, Lodico & DiClemente, 1994), échangent plus des services sexuels contre de la drogue (Wood & Shoroye, 1993), et ont plus souvent une activité sexuelle sous l’influence d’un produit (Otto-Salai, Gore-Felton, McGarvey & Canterbury II, 2002). Quoiqu’on sache le besoin de soin visant l’usage de produits (et les comportements à risque qui s’y rapportent) par les adolescents incarcérés, ceux-ci s’engagent peu dans les services qui leur sont proposés (Melnick, De Leon, Hawke, Jainchill & Kressel, 1997 ; Nissen, 2006 ; Prochaska et al. 1994).
De surcroît, il est fréquent qu’il n’y ait pas de service proposé (Nissen, 2006 ; Thornberry, Tolnay, Flanagan & Glynn, 1991 ; Young, Dembo & Henderson, 2007). De même, aucune offre de soin n’est, la plupart du temps, proposée aux familles d’adolescents sous main de justice (Young et al. 2007), et quand il en existe une, les familles ne montrent guère d’investissement dans ces programmes (Perkins-Dock, 2001). Enfin, au-delà de ces manques d’offre et d’engagement dans les traitements, il faut rappeler le tempo de l’action judiciaire : beaucoup d’adolescents ne sont détenus que pour quelques jours, et les sorties sont quelquefois inattendues.POURQUOI L’EM ?
L’EM peut être bref, il s’applique à des adolescents à un moment où ils ont intérêt au changement, est cohérent avec la phase du développement des adolescents qui se débattent avec la question de l’autonomie, et fait jouer des mécanismes mentaux considérés comme importants pour le changement (par exemple, le sentiment d’efficacité personnelle).
Etant bref, l’EM est adapté pour les situations de travail où les ressources sont faibles. Il est aussi indiqué pour les gens qui montrent un haut niveau de colère ou d’agressivité, sentiments Le système judiciaire spécialisé que l’on retrouve fréquemment dans le système pénal (Karno & Longabaugh, 2004 ; Waldron, Slesnick, Brody, Turner & Peterson, 2001). Par exemple, pas moins de 40 % des adolescents manifestent un niveau important de colère au moment de leur incarcération (Stein, Slavet, Gingras & Gloembeske, 2004). »


 Depuis longtemps, on suspecte que l’exclusion scolaire aggrave le risque de délinquance chez les jeunes, mais il est éthiquement impossible de randomiser ce type d’intervention . Les politiques éducatives récentes au Royaume-Uni ont vu une hausse significative des exclusions permanentes au terme d’automne 2023-24, suscitant des débats sur leurs effets délétères
Depuis longtemps, on suspecte que l’exclusion scolaire aggrave le risque de délinquance chez les jeunes, mais il est éthiquement impossible de randomiser ce type d’intervention . Les politiques éducatives récentes au Royaume-Uni ont vu une hausse significative des exclusions permanentes au terme d’automne 2023-24, suscitant des débats sur leurs effets délétères 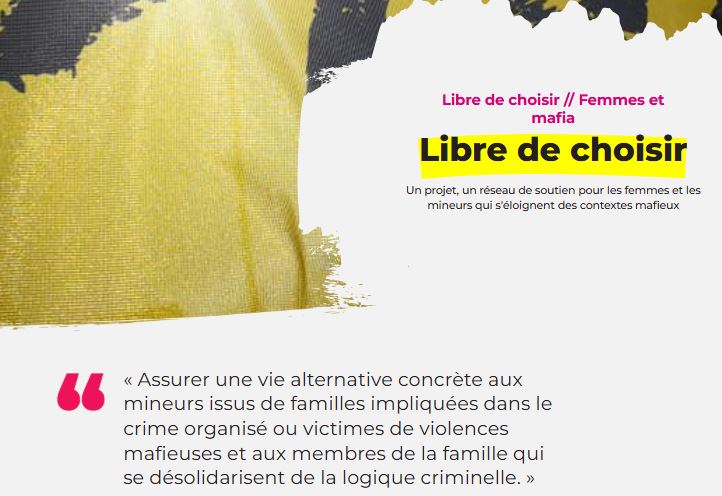

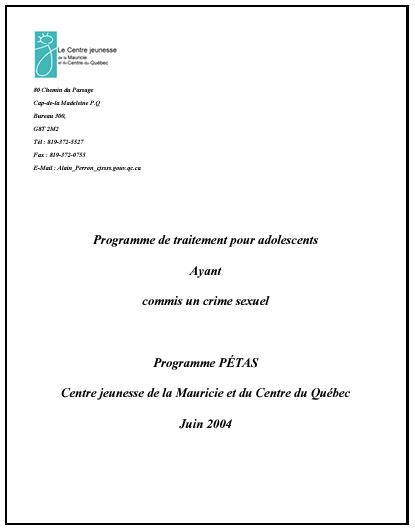
 Le stress est un élément normal et naturel de la vie. Mais pourquoi certaines personnes gèrent-elles bien le stress et développent-elles une résilience, alors que d’autres semblent éprouver des difficultés ? D le Dr Bruce Perry explore l’impact du stress et des traumatismes sur le cerveau et l’effet qui en résulte sur l’apprentissage. Ses enseignements ont aidé des écoles à réduire considérablement les problèmes de comportement et à créer des environnements d’apprentissage sûrs.
Le stress est un élément normal et naturel de la vie. Mais pourquoi certaines personnes gèrent-elles bien le stress et développent-elles une résilience, alors que d’autres semblent éprouver des difficultés ? D le Dr Bruce Perry explore l’impact du stress et des traumatismes sur le cerveau et l’effet qui en résulte sur l’apprentissage. Ses enseignements ont aidé des écoles à réduire considérablement les problèmes de comportement et à créer des environnements d’apprentissage sûrs.