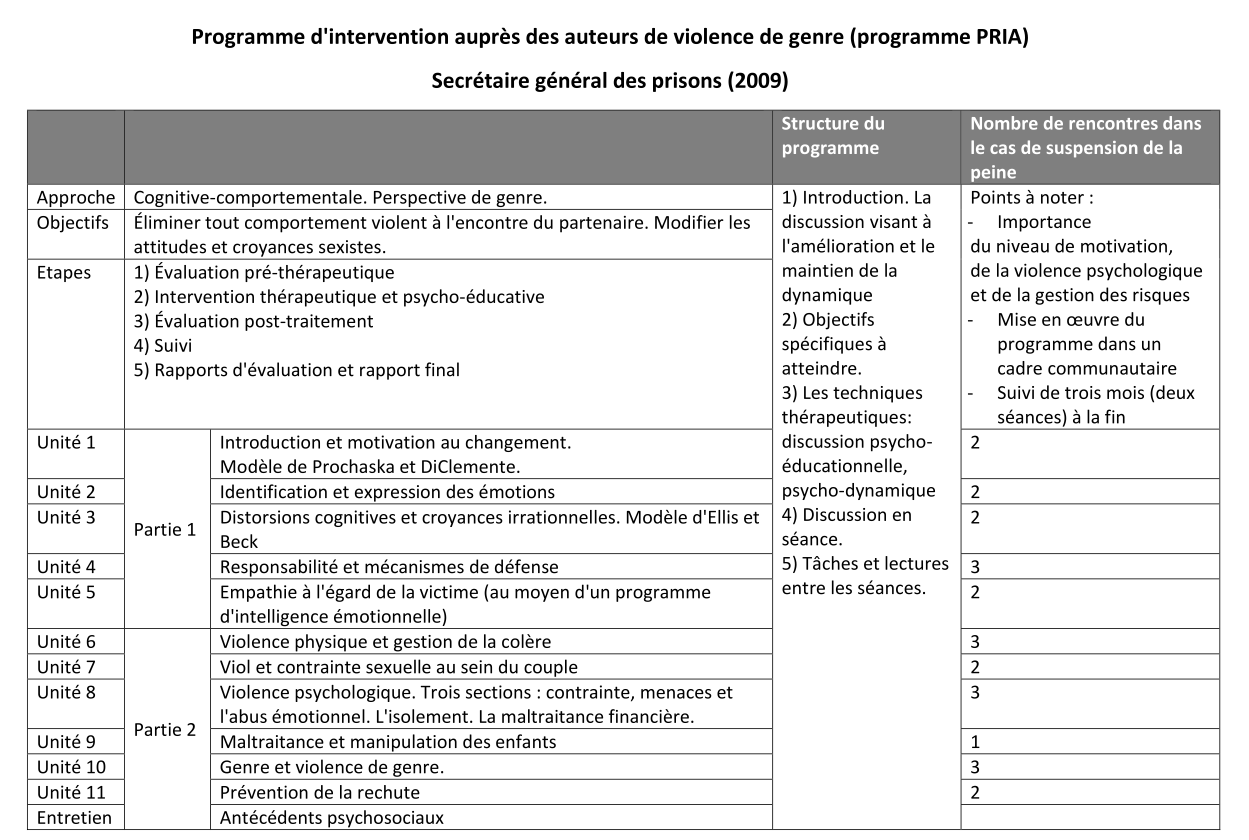« L’utilisation du conseil correctionnel (suivi pénitentiaire) par opposition à la psychothérapie est un sujet de débat permanent. Des arguments ont été soulevés concernant la différenciation des deux selon la théorie qui sous-tend la technique (par exemple, la psychanalyse comme psychothérapie), le degré de perturbation émotionnelle et de psychopathologie (c’est-à-dire que les perturbations plus graves nécessitent une psychothérapie), le cadre de travail clinique (par exemple, médical ou éducatif) et le niveau de diplôme et de formation professionnelle (par exemple, le psychiatre est un psychothérapeute, le psychologue titulaire d’un doctorat et le psychologue-conseil, titulaire d’une maîtrise, est un conseiller). En général, les psychothérapeutes sont titulaires d’un doctorat (M.D., Ph.D., Psy.D.).
« L’utilisation du conseil correctionnel (suivi pénitentiaire) par opposition à la psychothérapie est un sujet de débat permanent. Des arguments ont été soulevés concernant la différenciation des deux selon la théorie qui sous-tend la technique (par exemple, la psychanalyse comme psychothérapie), le degré de perturbation émotionnelle et de psychopathologie (c’est-à-dire que les perturbations plus graves nécessitent une psychothérapie), le cadre de travail clinique (par exemple, médical ou éducatif) et le niveau de diplôme et de formation professionnelle (par exemple, le psychiatre est un psychothérapeute, le psychologue titulaire d’un doctorat et le psychologue-conseil, titulaire d’une maîtrise, est un conseiller). En général, les psychothérapeutes sont titulaires d’un doctorat (M.D., Ph.D., Psy.D.).
Cependant, dans un sens fondamental, il est souvent difficile de déterminer où s’arrête le conseil et où commence la psychothérapie, en particulier dans les établissements correctionnels où la plupart des praticiens du traitement sont des conseillers titulaires d’une maîtrise (M.A.) ou des travailleurs sociaux titulaires d’une maîtrise en travail social (M.S.W.). Cela ne veut pas dire qu’il y a peu de différence entre le psychiatre titulaire d’un doctorat en médecine, qui peut prescrire des médicaments et qui a effectué un internat en psychiatrie, et le conseiller titulaire d’une maîtrise. Il existe des différences évidentes et significatives entre les deux. Il s’agit plutôt de souligner qu’en réalité, la plupart des professionnels du traitement clinique des établissements et des agences qui fournissent des services de conseil ou de psychothérapie aux délinquants sont formés au niveau de la maîtrise.
EFFICACITÉ DU CONSEIL ET DU TRAITEMENT DES DÉLINQUANTS
L’efficacité du conseil et du traitement des délinquants a fait l’objet d’un débat considérable parmi les praticiens et les chercheurs. Cependant, l’efficacité du conseil aux délinquants peut dépendre dans une large mesure du sens que l’on donne au mot « efficace ». Pour certains, un conseil et un traitement efficaces sont ceux qui permettent à la routine de la prison de se dérouler sans heurts, sans se soucier de préparer le délinquant à retourner et à se réadapter à la communauté extérieure. Pour d’autres, les programmes de traitement efficaces sont assimilés aux programmes les moins chers à mettre en œuvre et à maintenir en termes de coûts financiers. Enfin, pour de nombreux décideurs, membres du grand public et praticiens du système correctionnel, la réduction de la récidive représente la mesure de référence de l’efficacité.
Quel que soit le point de vue, le rôle, la fonction et le degré de réussite des programmes de traitement des délinquants ont fait l’objet de vives controverses, le soutien allant de l’accent mis sur la réadaptation et la réintégration dans la collectivité (Andrews et Bonta, 2010 ; Cullen et Gendreau, 2000; Cullen, Wright et Applegate, 1996 ; MacKenzie, 2006 ; Lipsey, 2009 ; Palmer, 1992 ; Smith, Gendreau et Schwartz, 2009) et la justice réparatrice (Van Ness et Strong, 2010) à une très faible confiance, voire aucune, dans les programmes de counseling et de traitement correctionnels (DiIulio, 1991 ; Farabee, 2005 ; Gaes et coll. , 1999 ; Whitehead et Lab, 1989).
Un certain nombre d’approches ont été utilisées pour tenter de mesurer l’efficacité du traitement des délinquants. Les approches les plus respectées comprennent les mesures de suivi à long terme, après le traitement, les modèles expérimentaux (utilisant des groupes de comparaison) et les changements de personnalité ou d’attitude mesurés par des tests psychologiques. En examinant ces approches, il apparaît que les techniques d’évaluation les plus acceptées reposent sur une méthodologie quantitative (Van Voorhis, 2006). L’une des méthodologies d’évaluation les plus respectées utilise la technique statistique de la méta-analyse. La méta-analyse permet de résumer les résultats de nombreuses études, combinant ainsi plusieurs échantillons de recherche en un seul grand échantillon et créant une statistique sommaire (taille de l’effet) qui évalue l’efficacité de tous les types de programmes ou de certains d’entre eux. Les méta-analyses corrigent bon nombre des problèmes méthodologiques des études individuelles, notamment les faibles taux de base et les échantillons de petite taille (Lipsey et Wilson, 2001). Une série de méta-analyses offre de solides recommandations concernant l’efficacité des interventions comportementales, d’apprentissage social et cognitivo-comportementales pour les délinquants (par exemple, Andrews et al., 1990 ; Lipsey, 1992, 2009 ; MacKenzie, 2006 ; Sherman et al., 1997).
Il ne fait aucun doute que les praticiens et les chercheurs continueront à débattre des mérites des techniques d’évaluation des programmes. Il est également probable qu’ils continueront à remettre en question l’efficacité des programmes de conseil et de traitement correctionnels. Cependant, il semble y avoir un consensus général parmi de nombreux praticiens et chercheurs concernant les éléments qui composent un programme de conseil ou de traitement efficace. Ces éléments sont les suivants
- la concentration des interventions intensives sur les délinquants à haut risque plutôt que sur les délinquants à faible risque qui sont souvent mis à mal par la rencontre d’autres délinquants et l’interruption des influences prosociales dans leur vie (voir chapitre 7) ;
- l’utilisation d’interventions comportementales et cognitivo-comportementales (voir chapitres 4, 8, 9) ;
- un haut degré d’intégrité du traitement et de qualité du programme, où le personnel adhère à la conception du programme et aux normes professionnelles (voir chapitre 16) ;
- une méthode permettant de faire correspondre les caractéristiques du délinquant, du thérapeute et du programme – appelée principe de réceptivité (voir chapitre 7) ;
- une communauté de traitement coopérative où les professionnels des soins de santé, de l’éducation, de la formation professionnelle, des loisirs, de la santé mentale et de la toxicomanie travaillent ensemble dans le cadre d’une approche globale et intégrée pour intervenir auprès des délinquants et promouvoir un comportement prosocial et productif ;
- un soutien administratif et institutionnel permettant de fournir des ressources et des possibilités adéquates pour élaborer et mettre en œuvre un traitement significatif et des programmes connexes;
- une variété de compétences pratiques à la vie quotidienne et d’expériences de traitement qui renforcent la responsabilité personnelle et la pertinence tant au sein de l’établissement que dans la communauté ;
- l’évaluation des programmes afin (a) d’identifier et de comprendre les programmes qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas, (b) de surveiller les forces et les faiblesses des programmes efficaces, et (c) d’identifier les possibilités d’amélioration ;
- des stratégies de prévention des rechutes pour aider le délinquant dans la communauté à la fin de la phase formelle d’un programme de traitement dans un établissement correctionnel ; et
- un personnel de traitement bien formé qui a obtenu les titres de compétences appropriés.
CONCLUSION
Les conseillers correctionnels participent aux programmes communautaires et institutionnels destinés aux délinquants. La nature de leur travail implique à la fois des fonctions de sécurité et de traitement. Le fait que ces fonctions soient souvent en conflit les unes avec les autres peut être frustrant pour les conseillers. Malgré tout, l’objectif principal de la plupart des conseillers correctionnels reste l’intervention pour traiter l’adaptation à la prison, la réinsertion du détenu, le risque de récidive, la toxicomanie, les traumatismes, les préoccupations familiales, la santé mentale et l’emploi.
La portée et l’objectif du conseil aux délinquants couvrent une gamme dynamique d’expertise et de responsabilité professionnelle qui continue d’évoluer et de défier les énergies créatives du conseiller qui choisit de travailler dans un environnement correctionnel. Malgré tout, les conseillers qui réussissent possèdent de bonnes aptitudes à la communication et à la synchronisation, ainsi que la capacité de motiver les délinquants à changer. Ces compétences doivent faire appel à l’empathie, à la capacité d’écouter les préoccupations des clients de manière réfléchie et à la capacité d’aider les clients à découvrir comment leurs comportements interfèrent avec leurs espoirs et leurs objectifs. Un conseil réussi implique également d’aider les clients à « risquer » le processus et les perspectives de changement d’une manière réaliste et planifiée. L’intention thérapeutique est essentielle et implique l’utilisation par le conseiller de l’engagement, du bon modèle, de l’empathie et de l’authenticité. Enfin, les conseillers doivent faire preuve d’humilité professionnelle, car ils comprennent et acceptent que certains délinquants changeront et d’autres non, et que la plupart des délinquants passeront par une série d’objectifs à atteindre et d’échecs.
Le débat permanent sur l’efficacité des traitements est en train d’être résolu par un certain nombre d’études impressionnantes qui montrent que certains types de programmes de conseil et de réinsertion changent effectivement certains types de délinquants. Il est clair, cependant, que les programmes qui réussissent doivent faire preuve d’un grand professionnalisme, d’une qualité élevée et d’une fidélité à leur conception sous-jacente.
Questions de discussion
- Quels sont les défis auxquels les conseillers correctionnels sont confrontés et que les autres conseillers n’appartenant pas au domaine correctionnel n’ont pas à affronter ?
- Quelles sont les capacités essentielles qu’un conseiller ou un thérapeute en milieu correctionnel doit posséder ?
- Qu’est-ce que l’entretien motivationnel et pourquoi peut-il être utile aux délinquants ?
- Qu’entend-on par sensibilité au genre et comment peut-on la démontrer ?
- Quels sont les six éléments de base de la communication et quel est leur lien avec les « capacités » de la question 2 ?
- Quelles sont les quatre façons dont les conseillers correctionnels peuvent devenir plus sensibles à la diversité ethnique et culturelle des délinquants ?
- Discutez du rôle crucial que jouent les spécialistes de l’éducation et des loisirs au sein de l’équipe de counseling et de traitement correctionnel. »
https://www.routledge.com/Correctional-Counseling-and-Rehabilitation/Salisbury-Van-Voorhis/p/book/9780367406455
Biographie des auteurs
 Emily J. Salisbury, Ph.D., est professeur associé et directrice du Utah Criminal Justice Center à l’University of Utah College of Social Work. Elle a une formation de criminologue appliquée et concentre ses recherches sur la science des interventions de traitement correctionnel, en particulier chez les femmes impliquées dans le système. Le Utah Criminal Justice Center est un centre de recherche interdisciplinaire qui fournit aux organisations des recherches, des formations et une assistance technique fondées sur des preuves scientifiques afin de prévenir et de réduire la criminalité et la victimisation au sein de toutes les communautés, étant entendu que les approches doivent être adaptées aux besoins contextuels des organisations et des diverses populations qu’elles desservent.
Emily J. Salisbury, Ph.D., est professeur associé et directrice du Utah Criminal Justice Center à l’University of Utah College of Social Work. Elle a une formation de criminologue appliquée et concentre ses recherches sur la science des interventions de traitement correctionnel, en particulier chez les femmes impliquées dans le système. Le Utah Criminal Justice Center est un centre de recherche interdisciplinaire qui fournit aux organisations des recherches, des formations et une assistance technique fondées sur des preuves scientifiques afin de prévenir et de réduire la criminalité et la victimisation au sein de toutes les communautés, étant entendu que les approches doivent être adaptées aux besoins contextuels des organisations et des diverses populations qu’elles desservent.
Les recherches de Mme Salisbury portent sur la politique correctionnelle, l’évaluation des risques et des besoins et les stratégies d’intervention en matière de traitement, avec un accent particulier sur les femmes impliquées dans le système, les pratiques tenant compte du genre et les soins tenant compte des traumatismes. Grâce à ses travaux sur les femmes, elle a reçu le prix Marguerite Q. Warren et Ted B. Palmer Differential Intervention Award de l’American Society of Criminology Division on Corrections and Sentencing.
 Patricia Van Voorhis est professeure émérite de justice pénale à l’université de Cincinnati. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont deux livres et de nombreux articles dans les principales revues de criminologie et de justice pénale. Elle a apporté son expertise à des agences fédérales, étatiques et locales sur des sujets liés à l’efficacité correctionnelle, à la mise en œuvre de programmes, aux techniques d’évaluation, aux femmes délinquantes, à l’évaluation des risques et à la classification correctionnelle. Elle a dirigé de nombreux projets de recherche financés par l’État et le gouvernement fédéral sur la classification des détenus, l’évaluation sexospécifique, la mise en œuvre de programmes et les interventions cognitivo-comportementales, et continue de mener un programme rigoureux de conseil et de recherche à la retraite. Mme Van Voorhis a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix August Vollmer de la Société américaine de criminologie, qui récompense un criminologue dont les travaux de recherche ont contribué à la justice ou au traitement ou à la prévention des comportements criminels ou délinquants.
Patricia Van Voorhis est professeure émérite de justice pénale à l’université de Cincinnati. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont deux livres et de nombreux articles dans les principales revues de criminologie et de justice pénale. Elle a apporté son expertise à des agences fédérales, étatiques et locales sur des sujets liés à l’efficacité correctionnelle, à la mise en œuvre de programmes, aux techniques d’évaluation, aux femmes délinquantes, à l’évaluation des risques et à la classification correctionnelle. Elle a dirigé de nombreux projets de recherche financés par l’État et le gouvernement fédéral sur la classification des détenus, l’évaluation sexospécifique, la mise en œuvre de programmes et les interventions cognitivo-comportementales, et continue de mener un programme rigoureux de conseil et de recherche à la retraite. Mme Van Voorhis a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix August Vollmer de la Société américaine de criminologie, qui récompense un criminologue dont les travaux de recherche ont contribué à la justice ou au traitement ou à la prévention des comportements criminels ou délinquants.



 « L’utilisation du conseil correctionnel (suivi pénitentiaire) par opposition à la psychothérapie est un sujet de débat permanent. Des arguments ont été soulevés concernant la différenciation des deux selon la théorie qui sous-tend la technique (par exemple, la psychanalyse comme psychothérapie), le degré de perturbation émotionnelle et de psychopathologie (c’est-à-dire que les perturbations plus graves nécessitent une psychothérapie), le cadre de travail clinique (par exemple, médical ou éducatif) et le niveau de diplôme et de formation professionnelle (par exemple, le psychiatre est un psychothérapeute, le psychologue titulaire d’un doctorat et le psychologue-conseil, titulaire d’une maîtrise, est un conseiller). En général, les psychothérapeutes sont titulaires d’un doctorat (M.D., Ph.D., Psy.D.).
« L’utilisation du conseil correctionnel (suivi pénitentiaire) par opposition à la psychothérapie est un sujet de débat permanent. Des arguments ont été soulevés concernant la différenciation des deux selon la théorie qui sous-tend la technique (par exemple, la psychanalyse comme psychothérapie), le degré de perturbation émotionnelle et de psychopathologie (c’est-à-dire que les perturbations plus graves nécessitent une psychothérapie), le cadre de travail clinique (par exemple, médical ou éducatif) et le niveau de diplôme et de formation professionnelle (par exemple, le psychiatre est un psychothérapeute, le psychologue titulaire d’un doctorat et le psychologue-conseil, titulaire d’une maîtrise, est un conseiller). En général, les psychothérapeutes sont titulaires d’un doctorat (M.D., Ph.D., Psy.D.). Emily J. Salisbury, Ph.D., est professeur associé et directrice du Utah Criminal Justice Center à l’University of Utah College of Social Work. Elle a une formation de criminologue appliquée et concentre ses recherches sur la science des interventions de traitement correctionnel, en particulier chez les femmes impliquées dans le système. Le Utah Criminal Justice Center est un centre de recherche interdisciplinaire qui fournit aux organisations des recherches, des formations et une assistance technique fondées sur des preuves scientifiques afin de prévenir et de réduire la criminalité et la victimisation au sein de toutes les communautés, étant entendu que les approches doivent être adaptées aux besoins contextuels des organisations et des diverses populations qu’elles desservent.
Emily J. Salisbury, Ph.D., est professeur associé et directrice du Utah Criminal Justice Center à l’University of Utah College of Social Work. Elle a une formation de criminologue appliquée et concentre ses recherches sur la science des interventions de traitement correctionnel, en particulier chez les femmes impliquées dans le système. Le Utah Criminal Justice Center est un centre de recherche interdisciplinaire qui fournit aux organisations des recherches, des formations et une assistance technique fondées sur des preuves scientifiques afin de prévenir et de réduire la criminalité et la victimisation au sein de toutes les communautés, étant entendu que les approches doivent être adaptées aux besoins contextuels des organisations et des diverses populations qu’elles desservent. Patricia Van Voorhis est professeure émérite de justice pénale à l’université de Cincinnati. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont deux livres et de nombreux articles dans les principales revues de criminologie et de justice pénale. Elle a apporté son expertise à des agences fédérales, étatiques et locales sur des sujets liés à l’efficacité correctionnelle, à la mise en œuvre de programmes, aux techniques d’évaluation, aux femmes délinquantes, à l’évaluation des risques et à la classification correctionnelle. Elle a dirigé de nombreux projets de recherche financés par l’État et le gouvernement fédéral sur la classification des détenus, l’évaluation sexospécifique, la mise en œuvre de programmes et les interventions cognitivo-comportementales, et continue de mener un programme rigoureux de conseil et de recherche à la retraite. Mme Van Voorhis a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix August Vollmer de la Société américaine de criminologie, qui récompense un criminologue dont les travaux de recherche ont contribué à la justice ou au traitement ou à la prévention des comportements criminels ou délinquants.
Patricia Van Voorhis est professeure émérite de justice pénale à l’université de Cincinnati. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont deux livres et de nombreux articles dans les principales revues de criminologie et de justice pénale. Elle a apporté son expertise à des agences fédérales, étatiques et locales sur des sujets liés à l’efficacité correctionnelle, à la mise en œuvre de programmes, aux techniques d’évaluation, aux femmes délinquantes, à l’évaluation des risques et à la classification correctionnelle. Elle a dirigé de nombreux projets de recherche financés par l’État et le gouvernement fédéral sur la classification des détenus, l’évaluation sexospécifique, la mise en œuvre de programmes et les interventions cognitivo-comportementales, et continue de mener un programme rigoureux de conseil et de recherche à la retraite. Mme Van Voorhis a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix August Vollmer de la Société américaine de criminologie, qui récompense un criminologue dont les travaux de recherche ont contribué à la justice ou au traitement ou à la prévention des comportements criminels ou délinquants.