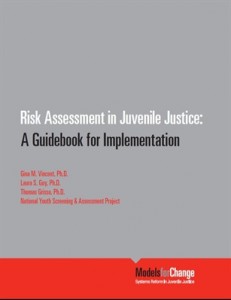SCIENCE ET VIE (15/05/2013) Analyser le cerveau pour évaluer les risques de récidive criminelle
Évaluer le risque de récidive criminelle chez des délinquants, en analysant leur activité cérébrale ? Des neurologues de l’université de Duke (Durham, États-Unis) l’ont fait. Ce résultat, qui n’est pas sans rappeler le film de science-fiction Minority Report réalisée par Steven Spielberg, a été publié le 27 mars 2013 dans la revue des Annales de l’Académie Américaine des Sciences (PNAS) .
Pour parvenir à ce résultat, Eyal Aharoni et ses collègues ont analysé le niveau d’activation cérébrale de 96 détenus à leur sortie de prison via imagerie à résonance magnétique fonctionnelle. Ces derniers ont été ensuite suivis pendant quatre ans par les chercheurs, afin de relever d’éventuels actes de récidive.
Résultat ? Les neurologues de l’université de Duke ont découvert que les délinquants qui présentaient un faible niveau d’activation dans le cortex cingulaire antérieur (une zone cérébrale située dans les zones dites « frontales » de notre cerveau, soit la partie avant de notre crâne) présentaient un taux de récidive deux fois supérieur à celui des anciens détenus caractérisés par un niveau d’activation normale du cortex cingulaire antérieur.
Ce résultat était si surprenant que cela ? En réalité, pas vraiment. En effet, le cortex cingulaire antérieur, une zone notamment impliquée dans la réaction empathique à la douleur physique d’autrui, ou encore dans l’inhibition dite des « réponses surapprises » (par exemple, être capable de répondre « rouge » à la question « quelle est la couleur de l’encre qui a été utilisée pour écrire ce mot ? » lorsque le mot BLEU, écrit en rouge, est présenté), est une aire cérébrale bien connue des neurobiologistes spécialisés dans l’analyse du comportement criminel (lire à ce titre l’article « neurobiologie de l’impulsivité, de l’agressivité et de la violence » ).
Lire l’intégralité de l’article sur Science-et-vie.com


 Les enquêtes sociales apportent donc des éléments intéressants dont certains ne seraient pas fournis par le sujet. Mais il est bon de s’assurer, en cours d’entretien, de l’exactitude des données de l’enquête. L’entretien, (comme tout entretien dans un examen psychotechnique) doit apporter par l’étude de l’histoire personnelle, familiale, sociale du sujet, du passé scolaire et professionnel, des renseignements sur le développement « longitudinal » de personnalité (les tests n’apportant des indications que sur l’aspect présent et momentané de la personnalité). Il peut permettre ainsi, par la compréhension des événements passés, la prédiction des attitudes et des comportements futurs (et cela est particulièrement important pour les délinquants).
Les enquêtes sociales apportent donc des éléments intéressants dont certains ne seraient pas fournis par le sujet. Mais il est bon de s’assurer, en cours d’entretien, de l’exactitude des données de l’enquête. L’entretien, (comme tout entretien dans un examen psychotechnique) doit apporter par l’étude de l’histoire personnelle, familiale, sociale du sujet, du passé scolaire et professionnel, des renseignements sur le développement « longitudinal » de personnalité (les tests n’apportant des indications que sur l’aspect présent et momentané de la personnalité). Il peut permettre ainsi, par la compréhension des événements passés, la prédiction des attitudes et des comportements futurs (et cela est particulièrement important pour les délinquants).