Les Échelles des agressions sexuelles et des viols (Bumby, 1996) visent à évaluer les cognitions qui nourrissent respectivement la violence sexuelle à l’endroit des enfants (molest scale de Bumby) et les agressions sexuelles à l’endroit des femmes (rape scale de Bumby). Sur l’échelle des agressions sexuelles envers les enfants (38 éléments), les scores peuvent varier de 38 à 152. Sur l’échelle des viols (36 éléments), ils peuvent varier de 36 à 144. Plus les scores sont élevés, plus on dénombre de cognitions qui nourrissent les agressions sexuelles.
Les scores de cette échelle sont positivement corrélés au nombre de victime et au nombre d’abus perpétrés (Bumby 1996) .
echelle de bumby feuille cotation
Réponses :
1 : Totalement en désaccord 2 : En désaccord 3 : D’accord 4 : Totalement d’accord
Veuillez relire chaque question et placer un « X » au-dessus des réponses correspondant à ce que vous auriez répondu avant que d’autres personnes (famille, amis, policiers) connaissent vos comportements sexuels déviants.
| QUESTIONS |
1-2-3-4 |
| 1. Je crois que la sexualité avec les enfants peut amener l’enfant à se sentir plus proche des adultes. | |
| 2. Étant donné que certaines victimes disent à l’abuseur qu’elles se sentent bien quand il les touche, l’enfant y prend probablement plaisir et ne sera pas très affecté par cela. | |
| 3. Plusieurs enfants qui ont été abusés sexuellement n’éprouvent pas beaucoup de problèmes majeurs venant des abus. | |
| 4. Toucher un enfant sexuellement est parfois une façon de lui montrer de l’amour et de l’affection. | |
| 5. Parfois les enfants ne disent pas non aux activités sexuelles parce qu’ils sont curieux au sujet de la sexualité et qu’ils y prennent plaisir. | |
| 6. Quand les enfants ne disent pas qu’ils ont été impliqués dans des activités sexuelles avec un adulte, c’est probablement parce qu’ils ont aimé ça et que cela ne les a pas dérangés. | |
| 7. Avoir des pensées et des fantaisies sexuelles concernant un enfant n’est pas si mauvais que ça parce qu`au moins ça ne fait pas de mal à l’enfant. | |
| 8. Si une personne n’utilise pas la force pour avoir une activité sexuelle avec un enfant, ça ne fera pas autant de mal à l’enfant. | |
| 9. Certaines personnes ne sont pas des « vrais » abuseurs d’enfants – ils sont seulement hors contrôle et ils ont fait une erreur. | |
| 10. Faire seulement des attouchements à un enfant n’est pas aussi mal que de le pénétrer et cela n’affectera probablement pas autant l’enfant. | |
| 11. Certaines relations avec des enfants, qui incluent de la sexualité, ressemblent beaucoup aux relations qu’on peut avoir avec un adulte. | |
| 12. Les activités sexuelles avec un enfant peuvent aider l’enfant à apprendre au sujet de la sexualité. | |
| 13. Je crois que les abuseurs d’enfants reçoivent souvent des sentences plus longues que ce qu’ils devraient. | |
| 14. Les enfants qui se font abuser par plus d’une personne font probablement quelque chose pour attirer les adultes à eux. | |
| 15. La société voit les contacts sexuels avec les enfants d’une façon bien pire qu’ils ne le sont vraiment. | |
| 16. Parfois ce sont les abuseurs qui souffrent le plus, perdent le plus et sont le plus blessés suite à un abus sexuel avec un enfant. Ils sont plus blessés ou souffrent plus que l’enfant. | |
| 17. Il est mieux d’avoir des contacts sexuels avec son enfant que de tromper sa femme. | |
| 18. Dans plusieurs abus sexuels sur des enfants il n’y a pas de vraies manipulations ou menaces qui sont utilisées. | |
| 19 . Certains enfants aiment les contacts sexuels avec les adultes parce que cela les fait se sentir désirés et aimés. | |
| 20. Certains hommes ont abusé sexuellement d’enfants parce qu’ils croyaient vraiment que les enfants aimeraient comment ils allaient se sentir. | |
| 21. Certains enfants désirent vraiment avoir des activités sexuelles avec des adultes. | |
| 22. Pendant les contacts sexuels, certains hommes demandent à leurs victimes si elles aiment ça parce qu’ils veulent vraiment faire plaisir à l’enfant et qu’il se sente bien. | |
| 23. Les enfants qui ont été impliqués dans des contacts sexuels avec des adultes font finir par passer par-dessus ça et poursuivre normalement leur vie. | |
| 24. Certains enfants peuvent agir de façon séductrice. | |
| 25. Tenter de rester éloigné des enfants est probablement une façon suffisante pour un abuseur de s’empêcher d’abuser de nouveau. | |
| 26. Très souvent les abus sexuels sur les enfants ne sont pas planifiés, ils arrivent sans être prévus. | |
| 27. Plusieurs hommes abusent sexuellement d’enfants à cause du stress et parce qu’abuser les aidaient à se sentir moins stressés. | |
| 28. Il arrive souvent que les enfants inventent des histoires que quelqu’un les abuse parce qu’ils veulent avoir de l’attention. | |
| 29. Si une personne se dit que jamais elle n’abusera de nouveau, alors elle ne le refera probablement jamais. | |
| 30. Si un enfant regarde les organes génitaux d’un adulte, il est probablement intéressé à la sexualité. | |
| 31. Parfois ce sont les victimes qui débutent les activités sexuelles. | |
| 32. Certaines personnes se tournent vers les contacts sexuels avec des enfants parce qu’elles ont été privées de sexe par les femmes adultes. | |
| 33. Certains enfants sont beaucoup plus adultes que d’autres. | |
| 34. Les enfants qui vont dans la salle de bain quand un adulte est en train de se déshabiller ou est à la toilette font probablement ça juste pour essayer de voir les organes génitaux de l’adulte. | |
| 35. Les enfants peuvent donner aux adultes plus d’acceptation et d’amour que les autres adultes. | |
| 36. Certains hommes qui abusent sexuellement d’enfants n’aiment vraiment pas abuser d’enfant. | |
| 37. Je crois que la principale chose qui fait que les activités sexuelles avec les enfants ne peuvent pas être tolérées est que c’est contre la loi. | |
| 38. Si la plupart des abuseurs d’enfants n’avaient pas été eux- mêmes abusés sexuellement comme enfant, alors ils n’auraient probablement jamais abusé d’un enfant. | |
| TOTAL= |



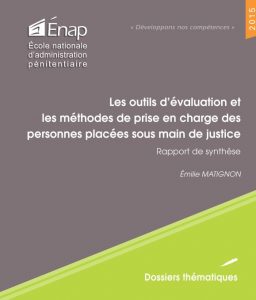 Les défis et perspectives pratiques de l’évaluation sont révélés par l’intérêt porté aux outils à proprement parler, c’est-à-dire aux grilles utilisées par les professionnels. Ces outils sont nombreux et variés puisque pas moins de quatre générations sont décomptées. En outre, ils sont éminemment évolutifs car sujets à des réévaluations constantes et une volonté de perfectibilité indéniable. Dans un tel contexte, la question du choix des outils s’impose et avec ce choix celle sous-jacente de la « philosophie » irriguant tel ou tel instrument. Par ailleurs, l’outil d’évaluation n’est qu’un simple outil et ne revêt une véritable utilité et un sens que lorsqu’il est associé à des programmes constituant la véritable révolution pratique de la probation. Ce sont les acteurs de l’évaluation, au-delà de ces objets inanimés, qui sont au cœur des réflexions et des changements qu’opère leur introduction dans les pratiques de la probation. La responsabilisation des probationnaires, la responsabilité des professionnels et l’adhésion des uns et des autres sont notamment des enjeux et défis soulevés par l’évaluation. La formation est également au centre de ces questions qu’il s’agisse de permettre la compréhension et l’appropriation d’outils nouveaux ou de favoriser l’adhésion à ces formes d’exercice de la probation.
Les défis et perspectives pratiques de l’évaluation sont révélés par l’intérêt porté aux outils à proprement parler, c’est-à-dire aux grilles utilisées par les professionnels. Ces outils sont nombreux et variés puisque pas moins de quatre générations sont décomptées. En outre, ils sont éminemment évolutifs car sujets à des réévaluations constantes et une volonté de perfectibilité indéniable. Dans un tel contexte, la question du choix des outils s’impose et avec ce choix celle sous-jacente de la « philosophie » irriguant tel ou tel instrument. Par ailleurs, l’outil d’évaluation n’est qu’un simple outil et ne revêt une véritable utilité et un sens que lorsqu’il est associé à des programmes constituant la véritable révolution pratique de la probation. Ce sont les acteurs de l’évaluation, au-delà de ces objets inanimés, qui sont au cœur des réflexions et des changements qu’opère leur introduction dans les pratiques de la probation. La responsabilisation des probationnaires, la responsabilité des professionnels et l’adhésion des uns et des autres sont notamment des enjeux et défis soulevés par l’évaluation. La formation est également au centre de ces questions qu’il s’agisse de permettre la compréhension et l’appropriation d’outils nouveaux ou de favoriser l’adhésion à ces formes d’exercice de la probation. Vacheret Marion, Cousineau Marie-Marthe (2005)
Vacheret Marion, Cousineau Marie-Marthe (2005)