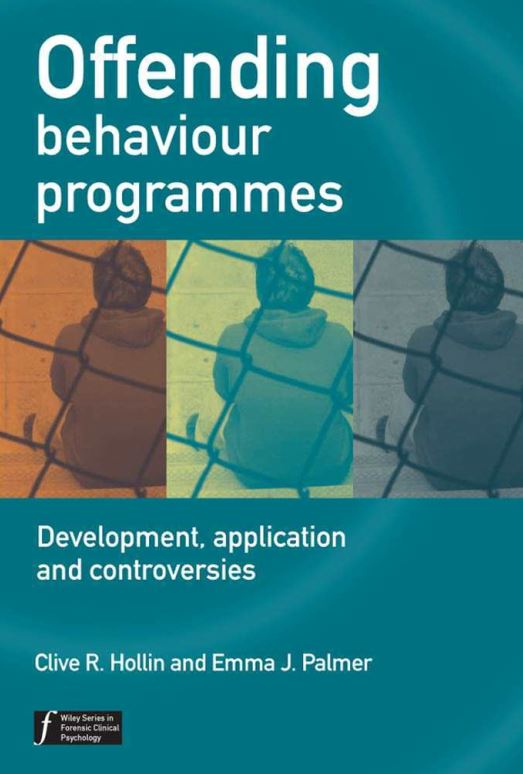 « Un certain nombre de synthèses des méta-analyses sont disponibles (voir, par exemple, Andrews, 1995, 2001 ; Gendreau, 1996 ; Hollin 1999 ; Losel, 1995a, 1995b) qui ont servi de base à la formulation des principes d’une pratique efficace. Ainsi, en définissant « ce qui marche » dans les interventions auprès des délinquants, Andrews (1995, 2001) a dérivé les 18 principes de « services humain (rehabilitation) »qui sous-tendent les interventions efficaces.
« Un certain nombre de synthèses des méta-analyses sont disponibles (voir, par exemple, Andrews, 1995, 2001 ; Gendreau, 1996 ; Hollin 1999 ; Losel, 1995a, 1995b) qui ont servi de base à la formulation des principes d’une pratique efficace. Ainsi, en définissant « ce qui marche » dans les interventions auprès des délinquants, Andrews (1995, 2001) a dérivé les 18 principes de « services humain (rehabilitation) »qui sous-tendent les interventions efficaces.
Principes d’une pratique efficace
1. Les interventions auprès des délinquants doivent être fondées sur une théorie psychologique du comportement criminel.
2. Cette théorie doit être axée sur la personnalité et la théorie de l’apprentissage social pour les facteurs de risque de la délinquance.
3. Les stratégies d’intervention doivent être basées sur le « service humain » plutôt que sur les principes de rétribution, de justice réparatrice ou de dissuasion.
4. Dans la mesure du possible, les interventions doivent se dérouler au sein de la communauté, dans des environnements naturels (tels que la famille). Toutefois, lorsqu’il est nécessaire de recourir à la détention, ces structures doivent être aussi proches que possible de la communauté.
5. Le niveau de risque de récidive des délinquants doit être évalué et servir de base à l’affectation aux services.
6. Les besoins criminogènes dynamiques des délinquants – les besoins associés à leur comportement délinquant – devraient être évalués et utilisés comme cibles pour les interventions.
7. Les interventions doivent être de nature multimodale, c’est-à-dire qu’elles doivent cibler un éventail de besoins criminogènes afin de refléter le fait que la délinquance est associée à de multiples facteurs de risque.
8. L’évaluation du niveau de risque et des besoins criminogènes doit être effectuée à l’aide de méthodes validées.
9. Les interventions doivent être adaptées à la situation générale et les services doivent correspondre aux styles d’apprentissage, aux motivations et aux capacités des délinquants.
10. Les interventions devraient avoir une réceptivité spécifique et être adaptées pour tenir compte de la diversité des délinquants (par exemple, en termes d’âge, de sexe, d’ethnie/de race, de langue) et de leurs forces et limites.
11. La réceptivité spécifique et les forces et faiblesses des délinquants devraient être évaluées de manière régulière, à l’aide d’outils spécialement conçus à cet effet.
12. Des stratégies organisationnelles doivent être mises en place pour contrôler la continuité du service, y compris la prévention des rechutes.
service, y compris en ce qui concerne le travail de prévention des rechutes.
13. Les organisations devraient identifier les domaines de pratique dans lesquels le personnel peut exercer son pouvoir discrétionnaire dans l’application des principes de service approprié.
Ces domaines doivent être clairement indiqués à l’ensemble du personnel.
14. Les organisations devraient élaborer une politique et des lignes directrices au niveau du service pour l’application des principes de service approprié et s’assurer qu’ils sont diffusés à l’ensemble du personnel.
15. Les organisations devraient mettre en place des procédures pour contrôler la fourniture et l’intégrité des interventions, et pour traiter les problèmes. Ces procédures devraient inclure des questions telles que la sélection, la formation et la supervision du personnel, ainsi que l’enregistrement des informations de suivi sur la prestation des services.
16. L’accent devrait être mis sur le développement des compétences du personnel, y compris les capacités à établir des relations, à motiver les autres et de structurer les programmes et les séances.
17. Les responsables devraient avoir les compétences attendues de leur personnel, ainsi qu’une connaissance et une compréhension approfondies des principes qui sous-tendent les interventions.
Ils doivent également être capables de coordonner les procédures associées à l’accréditation des programmes et des sites.
18. Au niveau de l’organisation, l’intervention programmatique devrait être placée dans un contexte plus large, en prêtant attention aux différences entre les contextes locaux.
dans un contexte plus large, en prêtant attention aux différences entre les contextes locaux et les groupes de clients, afin de permettre l’adaptation des services si nécessaire.
et des groupes de clients afin de permettre l’adaptation des services si nécessaire.
Les listes ne peuvent constituer un ensemble exhaustif de principes qui garantiront absolument le succès de la réduction de la récidive. Cependant, il est également vrai que la base de connaissances sur ce qui fonctionne s’est considérablement améliorée au cours de la dernière décennie. Il est juste de dire que nous pouvons avoir un degré raisonnable de confiance que ces principes fournissent une orientation solide pour le développement et la mise en œuvre des interventions, et constituent donc une base à partir de laquelle il est possible d’étendre la théorie, la recherche et la pratique. »
Principes d’une programmation correctionnelle efficace
1. Le risque
- Les délinquants à haut risque se caractérisent par des besoins criminogènes plus importants.
- Utiliser une mesure valide/fiable pour évaluer le risque des délinquants.
- Cibler les délinquants à haut risque pour le traitement.
2. Besoin
- Cibler les caractéristiques des délinquants les plus prédictives de la récidive.
- Les prédicteurs sont classés comme statiques (par exemple, les antécédents criminels) ou dynamiques (par exemple, les attitudes antisociales).
- Les facteurs dynamiques, ou besoins criminogènes, sont des cibles de traitement appropriées.
- Les besoins criminogènes qui sont des prédicteurs solides de la récidive : attitudes/valeurs antisociales, fréquentations pro-criminelles, impulsivité/mauvaise maîtrise de soi.
- Les besoins criminogènes qui sont de mauvais prédicteurs de la récidive : estime de soi, dépression, anxiété.
- Cibler davantage les besoins criminogènes que les besoins non criminogènes (ratio 3:1).
3. Réactivité
- Utiliser des stratégies efficaces de changement de comportement (c’est-à-dire cognitives/comportementales) incorporant les principes du conditionnement opérant pour modifier les comportements.
- Remplacer les cognitions antisociales par des compétences cognitives/sociales plus adaptatives.
- Envisager une « récéptivité spécifique », faire correspondre le style de prestation de services aux capacités et au style d’apprentissage du délinquant (c’est-à-dire prendre en compte le manque de motivation, les déficits intellectuels, les sentiments de dépression ou d’anxiété).
4. Autres considérations
- Contexte du traitement : dispenser le traitement dans la communauté si possible.
- Employer un personnel sensible aux relations interpersonnelles, cliniquement bien formé et supervisé.
- Offrir une prévention structurée des rechutes (c’est-à-dire une « prise en charge complète »).
- Inclure les proches des délinquants lorsque cela est possible.
Source : d’après Andrews & Bonta (2003).


Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.