[Dr Bruce Perry, Senior Fellow de la Child Trauma Academy, Houston, Texas. Vidéo pour la conférence du 50e anniversaire de Early Years Scotland, 30 septembre 2017]
 Le stress est un élément normal et naturel de la vie. Mais pourquoi certaines personnes gèrent-elles bien le stress et développent-elles une résilience, alors que d’autres semblent éprouver des difficultés ? D le Dr Bruce Perry explore l’impact du stress et des traumatismes sur le cerveau et l’effet qui en résulte sur l’apprentissage. Ses enseignements ont aidé des écoles à réduire considérablement les problèmes de comportement et à créer des environnements d’apprentissage sûrs.
Le stress est un élément normal et naturel de la vie. Mais pourquoi certaines personnes gèrent-elles bien le stress et développent-elles une résilience, alors que d’autres semblent éprouver des difficultés ? D le Dr Bruce Perry explore l’impact du stress et des traumatismes sur le cerveau et l’effet qui en résulte sur l’apprentissage. Ses enseignements ont aidé des écoles à réduire considérablement les problèmes de comportement et à créer des environnements d’apprentissage sûrs.
Bruce D. Perry, MD, PhD, est membre principal de la Child Trauma Academy, membre principal du Neurosequential Network et professeur auxiliaire au département de psychiatrie et de sciences comportementales de la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University à Chicago.
Le Dr. Perry a mené à la fois des recherches en neurosciences fondamentales et des recherches cliniques. Ses recherches en neurosciences ont examiné les effets de l’exposition prénatale aux médicaments sur le développement du cerveau, la neurobiologie des troubles neuropsychiatriques humains, la neurophysiologie des événements traumatisants de la vie et les mécanismes fondamentaux liés au développement des récepteurs de neurotransmetteurs dans le cerveau. Ses recherches cliniques et sa pratique se sont concentrées sur les enfants à risques élevés. Ces travaux ont examiné les effets cognitifs, comportementaux, émotionnels, sociaux et physiologiques de la négligence et des traumas chez les enfants, les adolescents et les adultes.
La presente vidéo (VOSTFR) explore les conséquences des trauma précoces ou experiences aversives précoce sur le developpement du cerveau des jeunes enfants et sur leurs capacités d’apprentissage, qui doit être compris et intégré par os systémes éducatifs.
Bruce Perry cite notament l’implication de ces travaux sur la justice de mineurs et les centres pour mineurs.
Voir aussi l’excellent podcast de M. Puder, avec Bruce Perry, de l’excellente chaine Psychiatry & Psychotherapy
Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous nous entretenons avec le Dr Bruce Perry, coauteur de The Boy Who Was Raised As A Dog (Le garçon élevé comme un chien), Born For Love (Né pour l’amour) : Pourquoi l’empathie est essentielle et menacée, et What Happened to You ? Conversations sur le traumatisme, la résilience et la guérison (2021). Megan White Zappitelli, docteur en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, et Maddison Hussey, docteur en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, se joindront également à nous.
Bruce Perry a signalé ce conflit d’intérêts potentiel : Développeur du modèle thérapeutique neuroséquentiel et reçoit une rémunération pour la formation et le temps d’enseignement liés à la mise en œuvre de ce modèle.
Aucun des autres présentateurs n’a de conflit d’intérêts
Nous vous recommandons également de consulter les ressources ci-dessous fournies par le Dr Perry : Intro to The Neurosequential Model Network


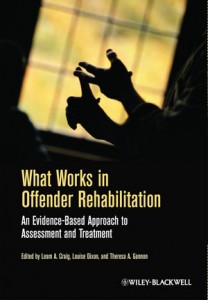 This comprehensive volume summarizes the contemporary evidence base for offender assessment and rehabilitation, evaluating commonly used assessment frameworks and intervention strategies in a complete guide to best practice when working with a variety of offenders.
This comprehensive volume summarizes the contemporary evidence base for offender assessment and rehabilitation, evaluating commonly used assessment frameworks and intervention strategies in a complete guide to best practice when working with a variety of offenders. Extraits:
Extraits: