Communiqué de presse de Christiane Taubira, Garde des sceaux, ministre de la Justice
Christiane Taubira, Garde des sceaux, ministre de la Justice, s’est rendue aujourd’hui à la rencontre des personnels du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) à Melun.
Cette visite s’inscrit dans le cadre la préparation de la réforme pénale, que la ministre soumettra dans les prochains jours au conseil d’Etat, en vue d’une présentation en conseil des ministres en septembre, et illustre le rôle majeur des SPIP dans l’efficacité de la politique pénitentiaire.
Les quatre premiers articles du projet de loi mettent en avant le service public pénitentiaire et notamment le SPIP. Les missions d’insertion et de probation sont intégrées dans les missions régaliennes de la direction de l’administration pénitentiaire. Elles occupent désormais une place prépondérante dans la capacité de l’administration pénitentiaire, non seulement à surveiller le détenu, mais aussi à préparer sa réinsertion sociale, seul rempart contre la récidive et la surpopulation carcérale.
Mais au-delà de la loi, c’est l’organisation même du travail pénitentiaire qui sera revisitée pour accompagner cette réforme. Aussi la garde des Sceaux, ministre de la Justice, a-t-elle décidé d’annoncer aujourd’hui les moyens supplémentaires immédiats qu’elle mobilise pour les SPIP :
- Création de 300 emplois supplémentaires pour les SPIP dès 2014, qui viendront donc s’ajouter aux 63 postes déjà créés en 2013.
- Rétablissement dès cette année d’un comité technique spécifique aux SPIP, afin d’assurer au corps une visibilité spécifique au sein de l’administration pénitentiaire
- Installation d’un groupe de travail dès septembre sur les métiers du SPIP, ses pratiques, sa déontologie, ainsi que sur la formation.
- Ouverture de consultations relatives à l’organisation de la Direction de l’Administration Pénitentiaire, notamment sur les différentes sous-directions de l’administration centrale.
- Création d’un nouvel outil d’évaluation globale de la situation de la personne condamnée, élaboré avec les professionnels du secteur, pour remplacer le diagnostic à visée criminologique (DAVC), plus adapté pour déterminer les axes d’interventions socio-éducatives.
Ces mesures immédiates permettront d’accompagner la mise en œuvre de la réforme pénale, afin de permettre de donner toutes ses chances à la lutte contre la récidive, de réduire le nombre de victimes et d’assurer le droit pour tous à la sécurité.
Lire les commentaires de Martine Herzog Evans à propos de ces annonces…


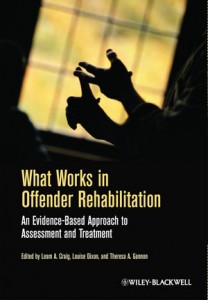 This comprehensive volume summarizes the contemporary evidence base for offender assessment and rehabilitation, evaluating commonly used assessment frameworks and intervention strategies in a complete guide to best practice when working with a variety of offenders.
This comprehensive volume summarizes the contemporary evidence base for offender assessment and rehabilitation, evaluating commonly used assessment frameworks and intervention strategies in a complete guide to best practice when working with a variety of offenders. We began our work on ‘Offender Supervision in Europe’ on March 27, 2012. This newsletter summarizes our progress during the first year of the Action. It includes brief resumes of the work of each of our four working groups, and an account of our first international conference at Liverpool Hope University on April 26-27, 2013. But first, a few words about why we set up the network and what it aims to achieve. The Action was created to address the neglect in existing social science research and scholarship of the emergence of ‘mass supervision’ (of ‘offenders’ in the community). In our proposal, we argued that, as well as representing an important analytical lacuna for penology in general and comparative criminal justice in particular, the neglect of supervision meant that research has not delivered the knowledge that is urgently required to engage with political, policy and practice communities grappling with delivering justice efficiently, effectively and legitimately. The Actionaims to remedy these problems by facilitating cooperation between institutions and individuals in different European states (and with different disciplinary perspectives) who are already carrying out research on offender supervision or, in the case of early stage researchers, are attracted to that field.
We began our work on ‘Offender Supervision in Europe’ on March 27, 2012. This newsletter summarizes our progress during the first year of the Action. It includes brief resumes of the work of each of our four working groups, and an account of our first international conference at Liverpool Hope University on April 26-27, 2013. But first, a few words about why we set up the network and what it aims to achieve. The Action was created to address the neglect in existing social science research and scholarship of the emergence of ‘mass supervision’ (of ‘offenders’ in the community). In our proposal, we argued that, as well as representing an important analytical lacuna for penology in general and comparative criminal justice in particular, the neglect of supervision meant that research has not delivered the knowledge that is urgently required to engage with political, policy and practice communities grappling with delivering justice efficiently, effectively and legitimately. The Actionaims to remedy these problems by facilitating cooperation between institutions and individuals in different European states (and with different disciplinary perspectives) who are already carrying out research on offender supervision or, in the case of early stage researchers, are attracted to that field. Pour nombre de personnes, prévenir la criminalité est un voeu pieux, ou doit nécessairement impliquer un durcissement du système pénal. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre : la justice est trop laxiste ! Les États qui misent sur des sanctions très sévères, telles que la neutralisation à vie, voire la peine capitale, ne sont toutefois pas parvenus à abaisser sensiblement leurs niveaux de criminalité, bien au contraire. S’il vaut mieux prévenir que réprimer, quelles sont alors les approches préventives les plus prometteuses ? Quels sont les principaux acteurs susceptibles de les mettre en œuvre ? Quels sont les outils nécessaires pour les mener à bien ? Quels sont les défis auxquels la prévention de la criminalité est confrontée ? Pourquoi peine-t-elle à gagner ses lettres de noblesse ? Cet ouvrage se propose d’étayer ces interrogations et d’en soulever les enjeux, notamment à l’aune d’exemples concrets.
Pour nombre de personnes, prévenir la criminalité est un voeu pieux, ou doit nécessairement impliquer un durcissement du système pénal. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre : la justice est trop laxiste ! Les États qui misent sur des sanctions très sévères, telles que la neutralisation à vie, voire la peine capitale, ne sont toutefois pas parvenus à abaisser sensiblement leurs niveaux de criminalité, bien au contraire. S’il vaut mieux prévenir que réprimer, quelles sont alors les approches préventives les plus prometteuses ? Quels sont les principaux acteurs susceptibles de les mettre en œuvre ? Quels sont les outils nécessaires pour les mener à bien ? Quels sont les défis auxquels la prévention de la criminalité est confrontée ? Pourquoi peine-t-elle à gagner ses lettres de noblesse ? Cet ouvrage se propose d’étayer ces interrogations et d’en soulever les enjeux, notamment à l’aune d’exemples concrets.