FRANCE CULTURE ; Emission « Culture monde » (14.02.2013) De Chorrillos à Guantánamo: derrière les barreaux – Préparer la sortie
Pierre Victor Tournier
Aujourd’hui, une trentaine d’experts du monde de la justice et de la société civile se préparent à être auditionnés à la Maison de la chimie à Paris pour proposer des réponses « efficaces » à la récidive. La ministre de la justice, Christiane Taubira, et François Hollande ont effectivement souhaité la mise en place d’une nouvelle « peine de probation », permettant aux condamnés de purger leurs peines hors de prison (une direction qui, par ailleurs, est souhaitable pour l’ensemble de l’Europe à en croire une recommandation adoptée par le Conseil de l’Europe le 11 janvier 2006). Alors que la France ne se sort pas du problème de la surpopulation carcérale (la conséquence, selon certains, d’un durcissement législatif ayant fait augmenter le nombre d’incarcérations) ; allons nous prendre le chemin inverse et faire sortir, autant que faire se peut et sous certaines conditions bien sûr, les détenus de la prison? Comment nos voisins européens s’y prennent- ils ?
En Europe, la problématique de la sortie de prison est abordée de façon très diverse. Les pays du nord revendiquent une approche plus « douce » : des peines courtes, un recours généralisé à la libération conditionnelle, des projets innovants de réinsertion des détenus avec, à la clé, des résultats probants semble-t-il. Cependant, ceux-ci doivent être mis en rapport avec les efforts considérables qui ont été faits dans ces pays, pendant des années, pour penser ces politiques carcérales. Bien au-delà des instances judiciaires, la population et le secteur associatifs sont étroitement liésà la réinsertion des détenus. D’autres pays, en Europe de l’Est principalement, sont beaucoup plus en retard : des peines longues, pas ou peu de libérations conditionnelles ou d’aménagements de peines, et à l’arrivée, une situation carcérale qui n’a rien à envier à celle des pays en développement dans laquelle la question de la réinsertion des détenus n’est, de fait, pas posée ou presque.
Entre ces deux extrêmes : la plus grande partie des pays européens qui selon les contextes, les périodes, semblent hésitants quant à leurs choix de politique carcérale. Si l’examen de ce sujet semble complexe, c’est qu’il met en jeu des cultures juridiques, pénales et carcérales différentes : on ne pense pas de la même manière la réintégration d’un détenu à la vie civile de Madrid à Stockholm. Quelles sont donc les grandes « recettes » pratiquées en Europe, et surtout, lesquelles semblent fonctionner?
Invité(s) :
Pierre-Victor Tournier, directeur de recherches au CNRS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Marie-Pierre Lassus, maître de conférences en musicologie à Lille 3, responsable du projet des ateliers d’orchestre dans les prisons du Pas-de-Calais, sur l’exemple du Venezuela.
Jacques Dayan, pédopsychiatre au CHU de Caen, consultant honoraire à l’institut de psychiatrie de Londres.



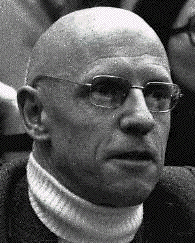
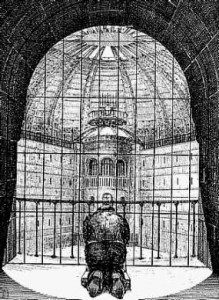 En décembre dernier, l’équipe de Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de prévention de liberté – entendez, pour l’essentiel, des prisons – est sortie effarée, je cite le journal Le Monde, d’une visite à la maison des Baumettes à Marseille. Les observateurs ont constaté « l’effroyable odeur d’ordures et d’urine, des murs qui tombent en ruine, de l’eau qui ruisselle dans les bâtiments, des rats qui pullulent au point que les surveillants tapent des pieds pendant les rondes de nuit pour les éloigner. Ils ont trouvé un scorpion dans une flaque et surpris un détenu qui lapait l’eau des toilettes, lassé de réclamer depuis trois semaines qu’on répare le robinet de sa cellule. Un autre a fini par murmurer, vert de peur, qu’il était l’esclave, y compris sexuel, de ses deux codétenus. » Le contrôleur général a jugé ce naufrage assez épouvantable pour utiliser la procédure d’urgence prévue en cas « de violation grave des droits fondamentaux. » Mais les effets de cette décision demeurent, pour l’heure, fort incertains. Dans notre République, telle qu’elle est, ressurgissent régulièrement, comme par bouffées, des moments d’indignation et de honte devant une situation scandaleuse au pays des droits de l’homme. Une des dernières fois, ce fut en 2000, lorsque le médecin-chef à la prison de la Santé, Véronique Vasseur, publia un livre où elle dressait un bilan accablant des conditions de détention dans cet établissement.
En décembre dernier, l’équipe de Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de prévention de liberté – entendez, pour l’essentiel, des prisons – est sortie effarée, je cite le journal Le Monde, d’une visite à la maison des Baumettes à Marseille. Les observateurs ont constaté « l’effroyable odeur d’ordures et d’urine, des murs qui tombent en ruine, de l’eau qui ruisselle dans les bâtiments, des rats qui pullulent au point que les surveillants tapent des pieds pendant les rondes de nuit pour les éloigner. Ils ont trouvé un scorpion dans une flaque et surpris un détenu qui lapait l’eau des toilettes, lassé de réclamer depuis trois semaines qu’on répare le robinet de sa cellule. Un autre a fini par murmurer, vert de peur, qu’il était l’esclave, y compris sexuel, de ses deux codétenus. » Le contrôleur général a jugé ce naufrage assez épouvantable pour utiliser la procédure d’urgence prévue en cas « de violation grave des droits fondamentaux. » Mais les effets de cette décision demeurent, pour l’heure, fort incertains. Dans notre République, telle qu’elle est, ressurgissent régulièrement, comme par bouffées, des moments d’indignation et de honte devant une situation scandaleuse au pays des droits de l’homme. Une des dernières fois, ce fut en 2000, lorsque le médecin-chef à la prison de la Santé, Véronique Vasseur, publia un livre où elle dressait un bilan accablant des conditions de détention dans cet établissement. Depuis deux ans, certaines opérations sont spectaculaires : fac-simile d’oeuvres du musée du Louvres à Poissy, peintures contemporaines de Mamadou Cissé à Fresnes, ou encore des lithographies originales de Matisse à Maubeuge en septembre dernier. Au delà de ces événements, la France a un modèle de culture en milieu carcéral unique au monde. Quand tout le monde s’intéresse à la récidive, comme cette politique s’exprime-t-elle aujourd’hui, envers ceux qui ne sortiront pas tout de suite ?
Depuis deux ans, certaines opérations sont spectaculaires : fac-simile d’oeuvres du musée du Louvres à Poissy, peintures contemporaines de Mamadou Cissé à Fresnes, ou encore des lithographies originales de Matisse à Maubeuge en septembre dernier. Au delà de ces événements, la France a un modèle de culture en milieu carcéral unique au monde. Quand tout le monde s’intéresse à la récidive, comme cette politique s’exprime-t-elle aujourd’hui, envers ceux qui ne sortiront pas tout de suite ? Cet article présente les composantes du programme correctionnel Parcours et la façon dont elles ont été implantées dans les prisons provinciales. On a confié au premier auteur le mandat d’élaborer un programme correctionnel de courte durée, encourageant les contrevenants à prendre conscience des conséquences de leur comportement et à amorcer un cheminement personnel axé sur le sens des responsabilités. Parcours repose sur trois modules prévoyant chacun huit heures d’intervention. Le premier vise la conscientisation et la responsabilisation des personnes incarcérées par l’entremise de certaines applications de l’approche motivationnelle. Le deuxième vise à amener les participants à prendre conscience des raisonnements moraux et des autojustifications qui viennent banaliser leurs comportements criminels. Quant au dernier, il vise à mieux comprendre le processus de passage à l’acte et à élaborer un plan de prévention de la récidive. Un premier bilan de l’implantation montre que le programme Parcours est introduit à des degrés variables dans 95 % des établissements de détention du Québec. Néanmoins, la plupart des participants n’ont bénéfi cié que de deux des trois modules prévus. Une conclusion s’impose : dans un avenir rapproché, il faudra uniformiser l’implantation du programme et évaluer ses effets.
Cet article présente les composantes du programme correctionnel Parcours et la façon dont elles ont été implantées dans les prisons provinciales. On a confié au premier auteur le mandat d’élaborer un programme correctionnel de courte durée, encourageant les contrevenants à prendre conscience des conséquences de leur comportement et à amorcer un cheminement personnel axé sur le sens des responsabilités. Parcours repose sur trois modules prévoyant chacun huit heures d’intervention. Le premier vise la conscientisation et la responsabilisation des personnes incarcérées par l’entremise de certaines applications de l’approche motivationnelle. Le deuxième vise à amener les participants à prendre conscience des raisonnements moraux et des autojustifications qui viennent banaliser leurs comportements criminels. Quant au dernier, il vise à mieux comprendre le processus de passage à l’acte et à élaborer un plan de prévention de la récidive. Un premier bilan de l’implantation montre que le programme Parcours est introduit à des degrés variables dans 95 % des établissements de détention du Québec. Néanmoins, la plupart des participants n’ont bénéfi cié que de deux des trois modules prévus. Une conclusion s’impose : dans un avenir rapproché, il faudra uniformiser l’implantation du programme et évaluer ses effets.