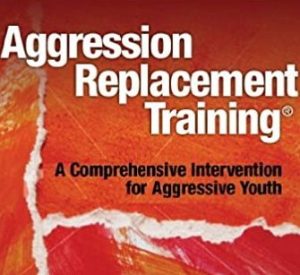 Le programme ART (Aggression replacement training) est une intervention cognitivo-comportementale visant à réduire les comportements agressifs et violents. Il s’agit d’un programme multimodal qui comporte trois composantes : les habiletés sociales, l’entraînement au contrôle de la colère et le raisonnement moral. ART a été développé aux États-Unis dans les années 1980 par Arnold P. Goldstein et Barry Glick et est maintenant utilisé dans toute l’Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, en Amérique du Sud et en Australie.
Le programme ART (Aggression replacement training) est une intervention cognitivo-comportementale visant à réduire les comportements agressifs et violents. Il s’agit d’un programme multimodal qui comporte trois composantes : les habiletés sociales, l’entraînement au contrôle de la colère et le raisonnement moral. ART a été développé aux États-Unis dans les années 1980 par Arnold P. Goldstein et Barry Glick et est maintenant utilisé dans toute l’Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, en Amérique du Sud et en Australie.
Informations générales
Le programme ART a été conçu par Arnold P. Goldstein et Barry Glick dans les années 1980 (Glick, Barry; Goldstein, Arnold P. (1 March 1987). « Aggression Replacement Training ». Journal of Counseling & Development. 65 (7): 356–362). Ils ont repris les concepts d’un certain nombre d’autres théories de travail avec les jeunes et ont synthétisé la théorie, la pratique et les techniques en un système complet. Chacune des trois composantes utilise un processus pour s’assurer que les jeunes apprennent les compétences pendant le programme et transfèrent ces compétences à de nouvelles situations en dehors du groupe. Le modèle se concentre également sur le concept de Jean Piaget d’apprentissage par les pairs. Il a été démontré que les jeunes apprennent mieux des autres jeunes.
ART est un programme de 10 semaines, se réunissant trois fois par semaine pendant une heure pour chacune de ses composantes. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est animé et co-animé par des animateurs de groupe formés. L’aménagement de la salle, la présentation du matériel, le nombre de participants et les antécédents des participants sont autant de facteurs qui contribuent à la réussite du groupe.
Formation à la maîtrise de la colère
La formation au contrôle de la colère est la composante affective de l’ART. Il s’agit de passer de l’enseignement des compétences sociales à l’extinction des compétences antisociales et à leur remplacement par des compétences prosociales. La formation au contrôle de la colère utilise la chaîne de contrôle de la colère. Il s’agit d’un processus enseigné aux participants pour faire face aux situations qui les mettent en colère. Une fois encore, un segment de la chaîne de contrôle de la colère est enseigné chaque semaine et les animateurs et les jeunes mettent en pratique les nouvelles compétences dans le cadre d’activités de la vie courante. La chaîne de maîtrise de la colère est la suivante ;
- Déclencheurs (externes et internes) – La situation qui déclenche la colère et le discours personnel qui l’alimente.
- Indices – signes physiques de la colère
- Réducteurs de colère – trois méthodes (respiration profonde, comptage à rebours et images agréables) pour nous aider à réduire ou à oublier la situation.
- Rappels (ou autosuggestions) – courtes déclarations positives que l’on se dit à soi-même pour réduire davantage les impulsions de colère.
- Penser à l’avenir, Anticiper – Identifier les conséquences de nos comportements.
- Compétences sociales : mettre en œuvre une aptitude pro-sociale dans la situation (comme négocier un accord).
- Évaluation – Revenir sur l’utilisation de la chaîne de contrôle de la colère et évaluer la façon dont elle a été mise en œuvre.
La recherche sur ART a considérablement progressé depuis sa création par Goldstein et ses collègues, il y a plus de vingt ans. Le programme a été mis en œuvre dans au moins 45 États, six provinces canadiennes et de nombreux pays étrangers et il est utilisé avec une variété de populations juvéniles (Glick, 2006). ART s’est progressivement imposé comme un traitement fondé sur des preuves, efficace pour accroître le comportement prosocial et les capacités de raisonnement moral, et réduire l’impulsivité et le comportement antisocial (Goldstein, Nensen, Deleflod, & Kalt, 2004). La recherche sur l’efficacité suggère fortement que l’ART est efficace pour enseigner les compétences sociales, améliorer les compétences en matière de gestion de la colère et réduire la colère autodéclarée et des taux de récidive chez les jeunes délinquants (Goldstein et al., 2004).
Pour en savoir plus:



Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.