Dans cette vidéo le professeur Faye Taxman de l’université George Mason s’entretient avec le directeur de VERA, Michael Jacobson, sur la manière dont les systèmes correctionnels américains peuvent adopter des pratiques visant à réduire la récidive – un changement qui nécessitera des modifications substantielles et culturelles. Le professeur Taxman est le directeur du Center for Advancing Correctional Excellence à George Mason et a publié plus de 125 articles. En 2008, la Division on Corrections and Sentencing de l’American Society of Criminology lui a décerné le titre de « Distinguished Scholar ». Cet entretien fait partie de la série de conférences de recherche Neil A. Weiner de Vera.
VERA s’appuie sur des centaines de chercheurs et d’avocats qui travaillent à la transformation des systèmes juridiques pénaux et d’immigration afin qu’ils soient équitables pour tous.
Fondée en 1961 pour défendre des solutions alternatives à la mise en liberté sous caution à New York, Vera est aujourd’hui une organisation nationale qui s’associe aux communautés concernées et aux responsables gouvernementaux pour faire évoluer les choses. « Nous développons des solutions justes et antiracistes afin que l’argent ne détermine pas la liberté, qu’il y ait moins de personnes dans les prisons et les centres de détention pour immigrés, et que tous les acteurs du système soient traités avec dignité ».
Faye S. Taxman est professeur à l’université George Mason. Elle est reconnue pour son travail dans le développement de modèles de systèmes de soins continus qui relient la justice pénale à d’autres systèmes de prestation de services, ainsi que pour la réorganisation des services de probation et de surveillance des libérations conditionnelles, et pour les modèles de changement organisationnel. Elle a mené une enquête organisationnelle à plusieurs niveaux sur les systèmes correctionnels et de traitement de la toxicomanie afin d’examiner l’utilisation des pratiques fondées sur des données probantes dans les établissements correctionnels et de traitement de la toxicomanie et les facteurs qui influent sur l’adoption de processus et d’interventions fondés sur des données scientifiques. Elle a réalisé plusieurs études qui examinent l’efficacité de divers modèles de transfert de technologie et de processus d’intégration du traitement et de la supervision. Dans une étude, elle explore l’utilisation de la gestion des contingences et des systèmes d’incitation pour les délinquants toxicomanes.
Ses travaux couvrent l’ensemble du système correctionnel, des prisons aux services correctionnels communautaires, en passant par les délinquants adultes et mineurs. Elle a bénéficié de trois R01 du National Institute on Drug Abuse et d’un accord de coopération. Elle a également reçu des fonds du National Institute of Justice, du National Institute of Corrections et du Bureau of Justice Assistance pour ses travaux. Elle a des « laboratoires » actifs avec son accord de 18 ans avec le Maryland Department of Public Safety and Correctional Services et son accord de quatre ans avec le Virginia Department of Corrections. Faye Taxman (2011) «Comment les systèmes pénitentiaires peuvent prévenir la criminalité future». Elle est l’auteur principal de « Tools of the Trade : A Guide to Incorporating Science into Practice », une publication du National Institute on Corrections qui fournit un guide pour la mise en œuvre de concepts scientifiques dans la pratique. Elle fait partie des comités de rédaction du Journal of Experimental Criminology et du Journal of Offender Rehabilitation. Elle a publié des articles dans le Journal of Quantitative Criminology, le Journal of Research in Crime and Delinquency, le Journal of Substance Abuse Treatment, le Journal of Drug Issues, Alcohol and Drug Dependence et Evaluation and Program Planning. En 2002, elle a reçu le prix de l’Université de Cincinnati décerné par l’Association américaine de probation et de libération conditionnelle pour ses contributions dans ce domaine. Elle est membre de l’Academy of Experimental Criminology et du Correctional Services Accreditation Panel (CSAP) d’Angleterre. En 2008, la division « Sentencing and Corrections » de l’American Society of Criminology lui a décerné le titre de « Senior Scholar ». Elle est titulaire d’un doctorat de la Rutgers University-School of Criminal Justice et d’une licence de l’université de Tulsa.
Si le lien est brisé: tools of the trade



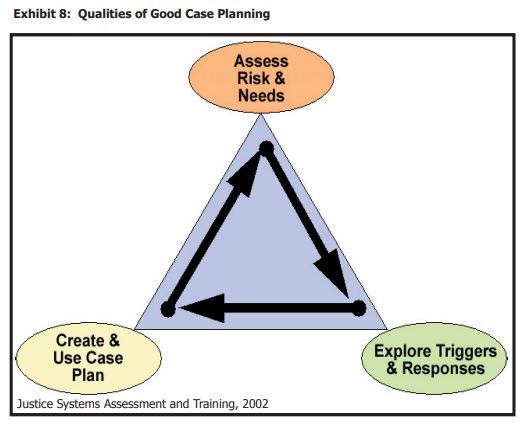
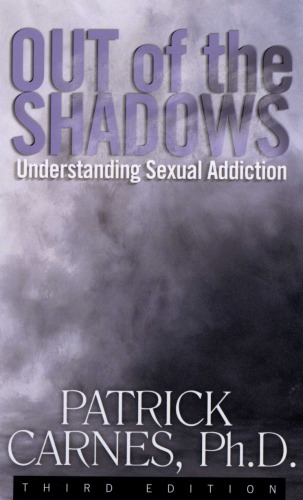

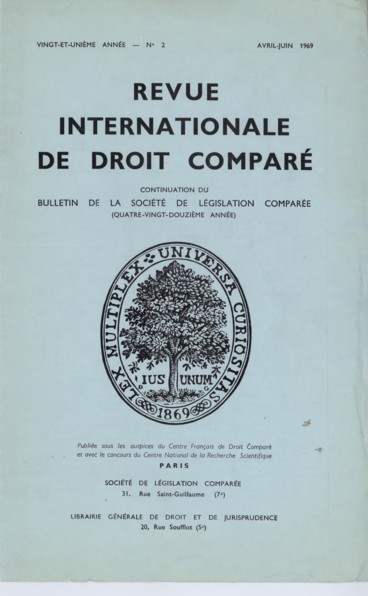 Jacques-Bernard Herzog était bien connu des familiers de la rue SaintGuillaume, mais il était également très connu de tous les comparatistes actuels, en France et à l’étranger. Ses attaches avec le droit comparé ont été nombreuses. Elles ont tout de suite marqué son orientation scientifique et lui-même a beaucoup donné à la science comparative, pour laquelle sa disparition constitue une lourde perte.
Jacques-Bernard Herzog était bien connu des familiers de la rue SaintGuillaume, mais il était également très connu de tous les comparatistes actuels, en France et à l’étranger. Ses attaches avec le droit comparé ont été nombreuses. Elles ont tout de suite marqué son orientation scientifique et lui-même a beaucoup donné à la science comparative, pour laquelle sa disparition constitue une lourde perte.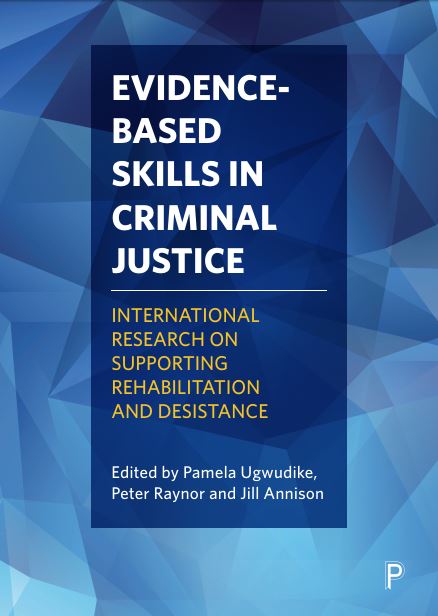

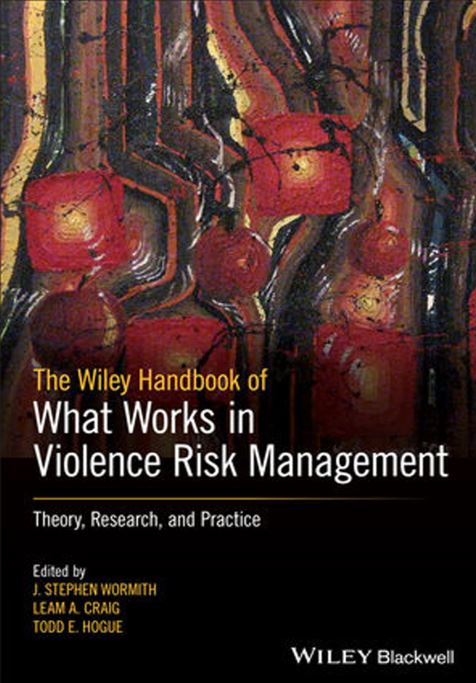

 La conclusion la plus importante pour des raisons pratiques immédiates est que la qualité moyenne des rapports de notification rapide ne diffère pas significativement de la qualité moyenne des rapports pour lesquels des délais de préparation plus longs avaient été accordés.
La conclusion la plus importante pour des raisons pratiques immédiates est que la qualité moyenne des rapports de notification rapide ne diffère pas significativement de la qualité moyenne des rapports pour lesquels des délais de préparation plus longs avaient été accordés.