Kia Marama Sex Offender Treatment Programme (New Zealand)
Lucy Faithfull Foundation 2015, Eradicating Child Sexual Abuse (ECSA)
 Population cible
Population cible
Hommes adultes placés dans une unité de sécurité moyenne et ayant commis des délits sexuels à l’encontre d’enfants.
Kia Marama a été créé en 1989 en tant que premier programme néo-zélandais de traitement pénitentiaire spécialisé pour les délinquants sexuels mineurs. Basé à l’origine sur le Programme de traitement et d’évaluation des délinquants sexuels d’Atascadero en Californie (Marques, 1988), Kia Marama a été créé en tant que communauté thérapeutique de 60 lits offrant des interventions de groupe aux délinquants sexuels mineurs condamnés.
Organisme de mise en œuvre
Department of Corrections (Statutory Body), Nouvelle-Zélande.
Mode et contexte de mise en œuvre
L’unité de sécurité moyenne de 60 lits est dédiée au traitement des délinquants sexuels mineurs et permet une interaction sociale et thérapeutique. Le programme fonctionne avec des groupes de huit hommes.
Niveau/Nature de l’expertise du personnel requise
Le personnel compte cinq thérapeutes (quatre psychologues et un travailleur social/thérapeute) qui sont étroitement supervisés afin de maintenir la qualité du traitement. Les agents pénitentiaires employés dans l’unité sont affectés à chaque groupe de thérapie et sont encouragés à soutenir et à suivre les progrès des détenus. Le programme Kia Marama a accès à un consultant culturel à temps partiel qui a aidé les thérapeutes avec des clients individuels et a développé des cérémonies d’accueil et de départ culturellement appropriées.
Intensité/étendue de l’engagement avec le(s) groupe(s) cible(s)
Le programme s’étend sur 31 semaines, les groupes se réunissant pour des séances de deux heures et demie, trois fois par semaine. Le temps non thérapeutique est consacré aux devoirs, aux activités liées à la thérapie, aux travaux de la prison (par exemple, la cuisine et le jardin) ou aux loisirs.
Description de l’intervention
Le programme très structuré vise à prévenir les rechutes en enseignant aux délinquants que leur délinquance est le résultat d’étapes de pensée et de comportement liées entre elles. Il offre des compétences et des stratégies pour rompre ces liens et des possibilités de changement, depuis l’évaluation initiale jusqu’à l’après-liberté, en passant par le traitement. Le programme envisage la délinquance sexuelle à travers un cadre de prévention des rechutes, basé sur des principes cognitivo-comportementaux. Nous pensons que ce cadre est plus efficace pour le client parce que
- il l’encourage à considérer sa délinquance comme une série de maillons identifiables dans une chaîne de comportements problématiques, plutôt que comme un événement aléatoire, ce qui est l’opinion courante
- il lui donne la possibilité de contrôler plusieurs points (c’est-à-dire de fuir ou d’éviter) afin de mettre fin à la chaîne de comportements
- il n’est pas tenu responsable des facteurs qui le rendent vulnérable à la délinquance, mais il est responsable de leur gestion
- s’il peut saisir le cadre de la prévention des rechutes, même à un niveau simple, et si son traitement et ce qu’il exige de lui ont un sens, alors il sera plus motivé
Évaluation :
Le programme commence par une évaluation de deux semaines, qui aboutit à une formulation clinique permettant de personnaliser le programme d’un individu dans le cadre de la structure globale. Il comprend une série d’entretiens cliniques, commençant par le point de vue de l’homme sur sa délinquance et ce qui l’a conduit à la commettre, et se poursuivant par l’étude des compétences sociales. Les hommes remplissent également 16 échelles d’auto-évaluation.
Traitement :
- Établissement de normes – Le premier module vise à établir des règles de conduite essentielles au bon fonctionnement du groupe et à donner aux participants une vue d’ensemble du traitement : « la vue d’ensemble ». Les hommes partagent des détails personnels, tels que la structure familiale et l’histoire sociale et développementale, afin d’établir des interactions appropriées au sein du groupe et de susciter des déclarations auto-motivantes, ainsi que d’initier la divulgation, la prise de risque et l’honnêteté.
- Comprendre votre délinquance – Ce module vise à permettre au participant de comprendre sa propre chaîne de délinquance. Avec l’aide des autres membres du groupe, il est censé comprendre comment les facteurs de son passé, tels que la mauvaise humeur, les déséquilibres du mode de vie, les difficultés sexuelles et d’intimité (Ward, Hudson & Marshall, 1996) ont préparé le terrain pour la délinquance.
Les deux maillons suivants de la chaîne (planification à long terme et entrée dans une situation à haut risque, qui comprend la planification à court terme et le comportement délictueux) se distinguent par la présence d’une victime potentielle (Hudson & Ward, 1996) ou par le fait d’être dans un lieu où la présence d’une victime potentielle est probable.
Le participant décrit ses réactions à la suite de l’infraction et la manière dont elles ajoutent à ses difficultés et augmentent la probabilité de sa récidive. Il identifie ensuite les éléments essentiels de son processus d’infraction, généralement trois liens dans chacune des phases de planification distale et de risque élevé. Les objectifs du traitement sont spécifiés pour chaque lien.
- Conditionnement de l’excitation – Nous pensons que tout lien entre les enfants et le plaisir sexuel signifie que dans une situation de risque (par exemple, une humeur négative et la présence d’une victime potentielle), l’homme éprouvera une excitation sexuelle déviante. Ce point de vue est confirmé par la littérature (par exemple Marshall & Barbaree, 1990b).
- Impact sur les victimes et empathie – Les hommes sont encouragés à lire à haute voix des récits d’abus sexuels et à visionner des vidéos de victimes décrivant leur expérience. Une survivante d’abus est invitée à prendre la parole et à animer une discussion sur l’impact de l’abus, à la fois en général et pour elle en particulier. Les hommes rédigent ensuite une « autobiographie » de leur propre point de vue de victime, couvrant la détresse qu’ils ont subie et les conséquences actuelles de l’abus. Enfin, chaque membre du groupe joue son propre rôle et celui de sa victime, le groupe l’aidant, le remettant en question, suggérant des éléments supplémentaires et, avec le thérapeute, l’approuvant.
- Gestion de l’humeur – Les hommes sont initiés à un modèle cognitivo-comportemental basé sur l’humeur. Ils apprennent à faire la distinction entre une série d’émotions, dont la colère, la peur et la tristesse. Les techniques physiologiques comprennent l’entraînement à la relaxation et des informations sur le régime alimentaire et l’exercice physique.
- Compétences relationnelles – Le programme établit les avantages des relations intimes et discute de la manière dont elles peuvent être améliorées. Il se concentre sur quatre domaines : les conflits et leur résolution, l’utilisation constructive d’activités de loisirs communes, la nécessité de communiquer, de se soutenir et de se récompenser mutuellement, et l’intimité comme clé des trois autres domaines.
Le programme s’intéresse au style de relation que chaque homme manifeste ou décrit, identifie les caractéristiques susceptibles de bloquer le développement de l’intimité et étudie des moyens plus efficaces de développer l’intimité.
Ce module aborde également les questions de sexualité et de dysfonctionnement sexuel, ainsi que la confusion concernant l’orientation sexuelle de l’adulte, dans le cadre de la réduction des risques.
- Prévention des rechutes – Il s’agit de la pierre angulaire du programme et ses concepts sont introduits dès le début. Il aide en outre le participant à identifier les facteurs internes et externes qui présentent un risque pour lui et à les associer à de bonnes réactions d’adaptation. L’idée maîtresse du programme est qu’il n’existe pas de « remède » à l’attirance sexuelle d’une personne pour les enfants et que l’objectif du traitement est d’améliorer l’autocontrôle et le contrôle du comportement.
- Planification de la rechute et suivi – Les plans de libération sont discutés et affinés tout au long du programme. Un membre du personnel thérapeutique à plein temps (coordinateur de la réinsertion) assure la liaison entre le délinquant, les organismes communautaires et les proches.
Évaluation
« And there was Light » (Bakker, Hudson, Wales & Riley, 1998) détaille l’efficacité du programme Kia Marama en matière de réduction de la récidive. 238 diplômés de Kia Marama ont été comparés à un groupe de contrôle composé d’enfants délinquants sexuels condamnés entre 1983 et 1987 (N=284), avant le début du programme. Le groupe de contrôle n’était pas un groupe de contrôle pur dans le sens où le personnel du service psychologique aurait déjà vu un grand nombre de ces délinquants pour un traitement individuel.
Après prise en compte de diverses variables démographiques et infractionnelles (par exemple, l’origine ethnique, le nombre de condamnations sexuelles antérieures) et des différentes durées de suivi, l’analyse de survie a révélé une différence significative (statistique de Ward = 5,6221 [df=1], p<0,05) entre le groupe ayant suivi le traitement Kia Marama et le groupe de contrôle n’ayant pas suivi de traitement. Les sujets traités par Kia Marama comptaient moins de la moitié de récidivistes que le groupe de contrôle (10 % contre 23 % de nouvelles condamnations pour un délit sexuel).
Voir aussi: Hudson, S. M., Wales, D. S., & Ward, T. (1998). Kia Marama: A treatment program for child molesters in New Zealand. In W. L. Marshall, Y. M. Fernandez, S. M. Hudson, & T. Ward (Eds.), Sourcebook of treatment programs for sexual offenders (pp. 17–28). Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-1916-8_2
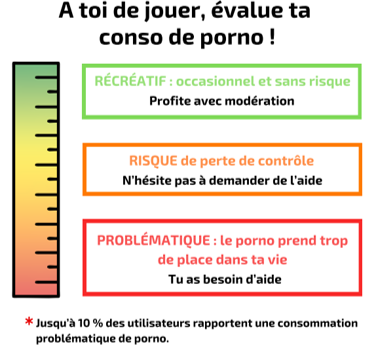 Découvrez le Pornomètre du CRIAVS Lorraine pour sensibiliser et agir.
Découvrez le Pornomètre du CRIAVS Lorraine pour sensibiliser et agir. Objectifs :
Objectifs :

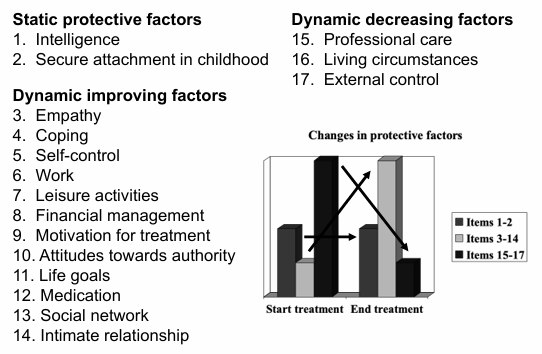
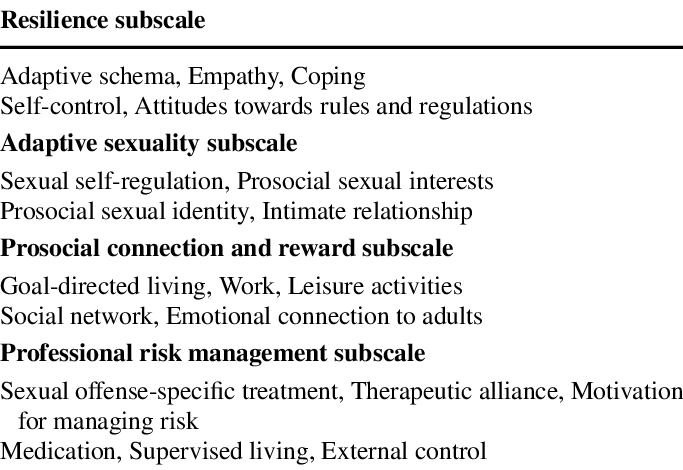
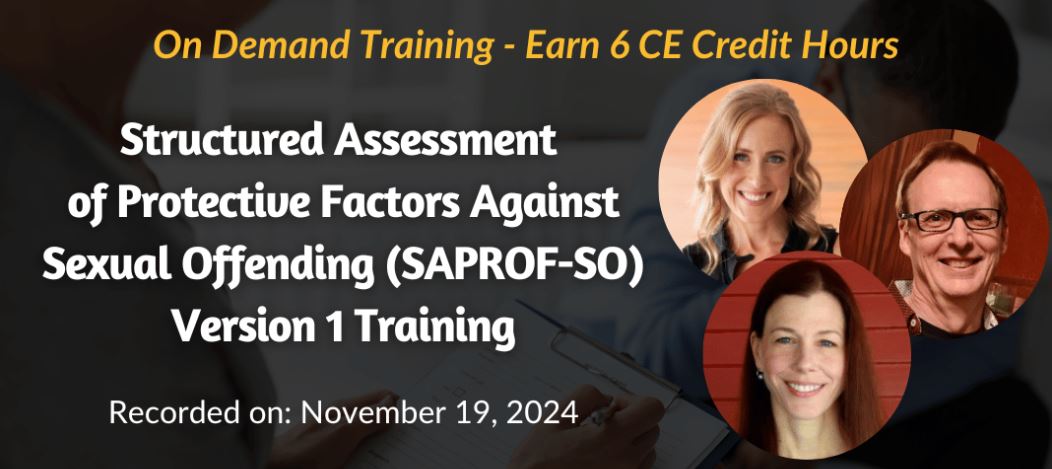

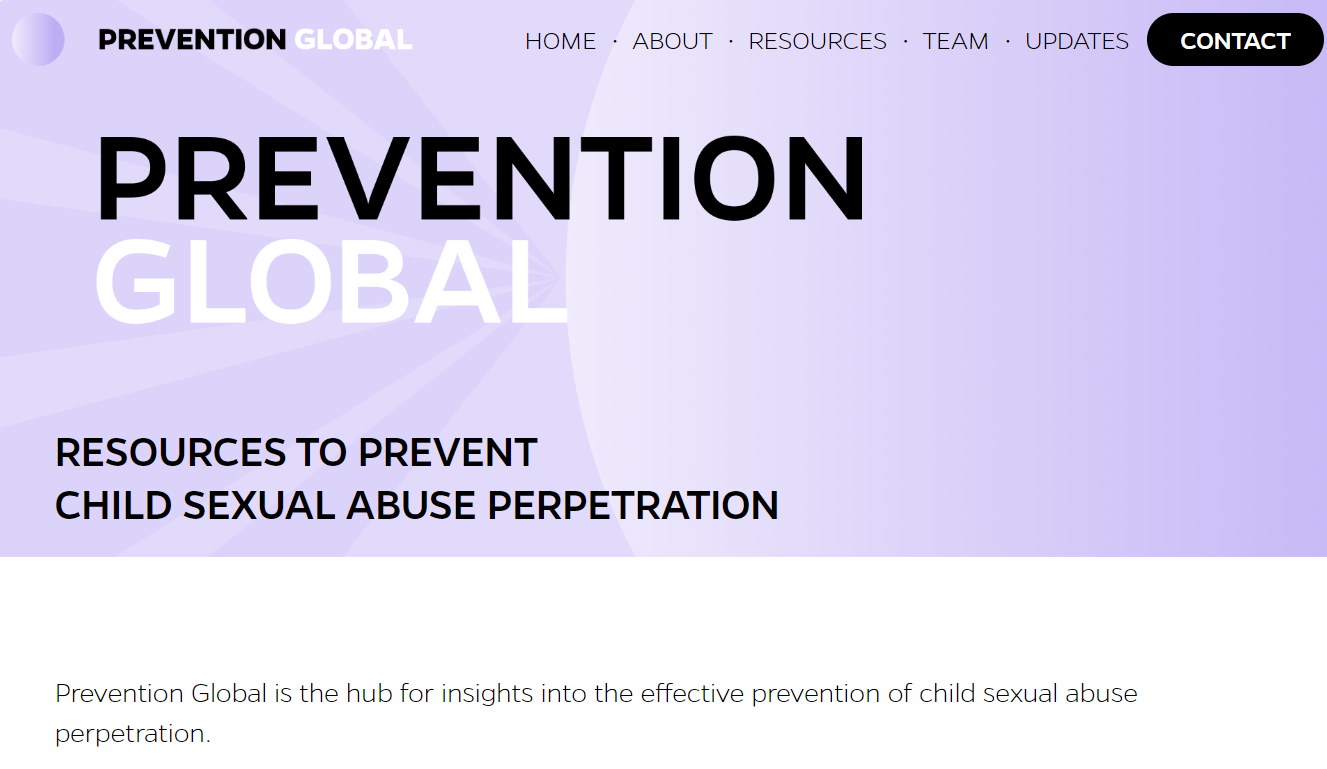
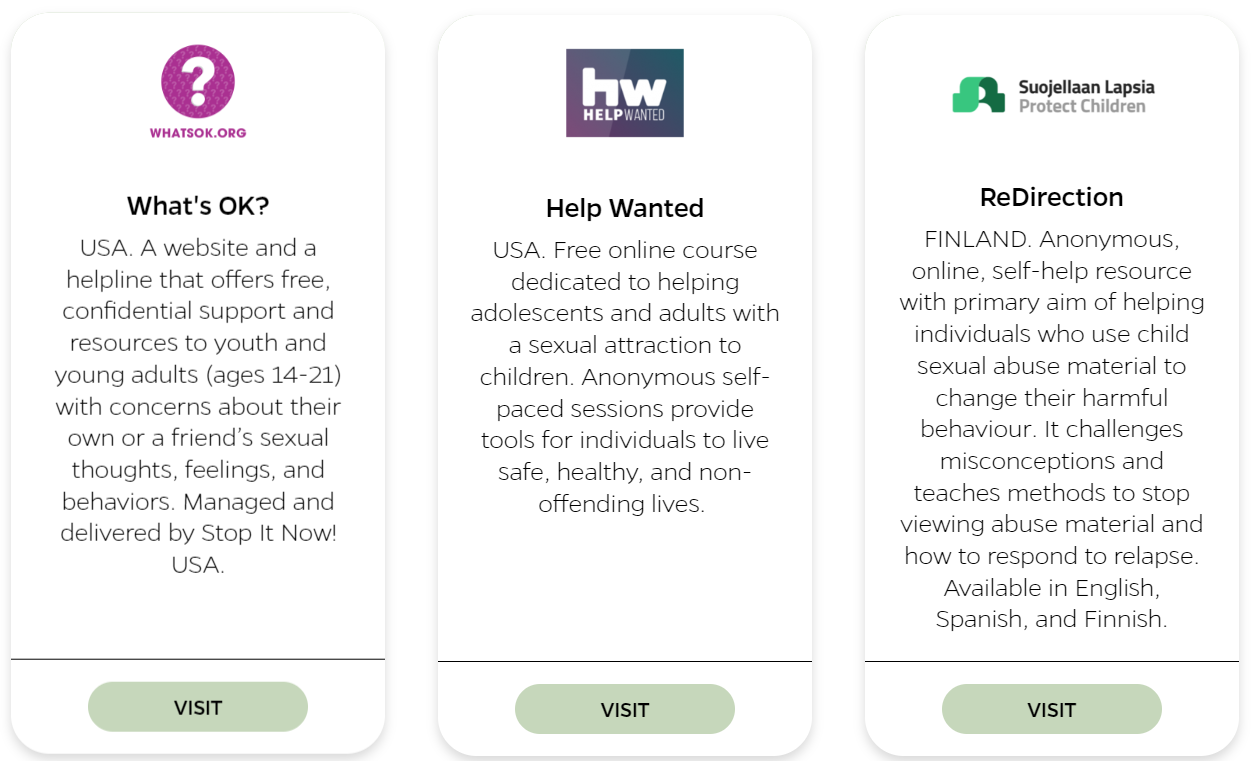
 Le SCC oriente les hommes qui ont commis des infractions sexuelles vers le programme
Le SCC oriente les hommes qui ont commis des infractions sexuelles vers le programme 