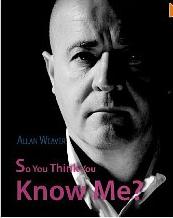Steve Jacob(2009) Opération chloroforme ou la réinvention de l’État rationnel : l’évaluation et les données probantes
Revue: Criminologie, Volume 42, numéro 1, printemps-été 2009, p. 201-223
Département de science politique, Université Laval, Laboratoire de recherche sur la performance et l’évaluation (PerfEval)
Résumé
L’évaluation de politiques ou de programmes s’est enracinée dans les pratiques de la gestion publique contemporaine. Dans le présent article, nous décrivons les multiples finalités poursuivies par l’évaluation (ex. : production d’information, amélioration des programmes, alimentation du débat démocratique) et les principaux débats qui animent la communauté des évaluateurs. Parmi ces débats, celui sur le courant de la décision fondée sur des données probantes est l’un des plus récents et des plus vifs. Les principales tensions portent sur la hiérarchisation des connaissances évaluatives, l’utilisation contrainte des connaissances et la volonté d’homogénéiser la pratique évaluative. En observant ces développements, nous constatons également une résurgence de la rationalisation des processus de prise de décisions et des principes de gestion publique qui semblent être en décalage avec les aspirations de la population à plus de participation et de transparence. Dans le présent article, nous présentons également les défis auxquels sont confrontés les décideurs et les gestionnaires publiques face à la réinvention de l’État rationnel.
Mots-clés : Évaluation de programmes, hiérarchisation des connaissances, rationalisation de la prise de décisions
http://www.erudit.org/revue/crimino/2009/v42/n1/029813ar.pdf