Paula Smith & Myrinda Schweitzer (2006) The Therapeutic Prison
 Résumé
Résumé
Depuis la fondation des institutions pénitentiaires, l’espoir persiste que l’incarcération pourrait servir des objectifs de réhabilitation. Cette intention de créer une prison vraiment transformatrice n’est pas un rêve utopique. Une approche théoriquement éclairée et fondée sur des données probantes pour la conception d’un établissement correctionnel qui offre des interventions efficaces est maintenant disponible : l’Inventaire d’évaluation des programmes correctionnels (Correctionnal Program Assessment Inventory – CPAI) ). Dans ce contexte, cet article met en lumière comment le CPAI peut être utilisé pour guider le développement d’une prison dont les objectifs et les pratiques favorisent la réadaptation des délinquants.
Extrait:
« CCP : Core Correctionnal Pratices
Ce domaine du CPAI-2000 détaille les compétences cliniques essentielles liées à la prise en charge, ce que l’on appelle communément les pratiques fondamentales de suivi (Andrews & Bonta, 2010; Gendreau et al., 2010).
Il est important de souligner que les CCP ne se référent pas à l’application de programmes ou techniques particuliers mais plutôt à des compétences et attitudes que les professionnels des services correctionnels doivent présenter chaque fois qu’ils interagissent avec les personnes suivies (Andrews et Bonta, 2010).
Avant tout, le professionnel des services correctionnels devrait servir de modèle pour les délinquants en adoptant des comportements prosociaux et en renforçant positivement les personnes lorsque elles agissent de même .
Cela exige que les membres du personnel de première ligne soient capables de distinguer les expressions procriminelles des expressions prosociales (Andrews et Bonta, 2010).
En outre,la modélisation efficace implique l’utilisation d’un modèle d’adaptation (coping) dans lequel les professionnels manifestent le comportement prosocial de manière concrète et vivante et modélisent auprès des personnes une stratégie auto-corrective.
En outre, le professionnel des services correctionnels devrait veiller à inclure des verbalisations sur les auto-instructions (ou des cognitions et des pensées) qui sont utilisées pour soutenir l’engagement dans les comportements souhaités. Les membres du personnel de première ligne doivent régulièrement renforcer les personnes pour qu’elles manifestent les comportements attendus et devraient servir de source générale de renforcement pour les personnes plutôt que d’être toujours punitifs ou négatifs.
Deuxièmement, les professionnels correctionnels les plus efficaces sont capables d’utiliser des renforcements positifs de hauts niveaux pour encourager les comportements prosociaux tout comme utiliser des renforcements négatifs efficaces (désapprobations) pour décourager les expressions antisociales.
Les renforcements efficaces comprennent les 3 éléments suivants :
- (a) des déclarations d’approbation immédiates et un soutien pour ce que le délinquant a dit ou fait
- b) une élaboration des raisons pour lesquelles ce comportement est souhaitable;
- et c) la prise en compte des avantages à court et à long terme associés à la poursuite de l’utilisation du comportement prosocial.
En revanche, une désapprobation efficace doit être utilisée lorsque le membre du personnel de première ligne a l’intention de communiquer sa désapprobation pour un comportement spécifique. Elle comprend les quatre éléments suivants:
- a) des déclarations de désapprobation immédiates pour ce que le délinquant a dit ou fait;
- b) une élaboration des raisons pour lesquelles ce comportement est indésirable;
- c) une prise en compte des coûts à court et à long terme associés l’utilisation de ce comportement;
- et (d) une démonstration claire d’un comportement prosocial alternatif.
Une fois le comportement indésirable corrigé et le comportement prosocial proposé ou modélisé, il est important pour le membre du personnel d’immédiatement terminer la désapprobation et fournir un renforcement social en direction du changement.
La plupart des professionnels des services correctionnels sont en position de force par rapport au délinquant et doivent dés lors donc faire attention à utiliser efficacement l’autorité pour guider respectueusement le délinquant vers une alliance de travail. À ce titre, les membres du personnel sont encouragés à focaliser leurs message sur le comportement exposé (et non sur la personne qui l’exécute), à être directs et spécifiques concernant leurs demandes, à préciser les choix du délinquant et leurs conséquences dans une situation donnée.
Une autre pratique correctionnelle essentielle consiste en des procédures d’apprentissage structurées pour le renforcement des habiletés .
Goldstein (1986) a identifié cinq composantes principales de ce processus:
- a) définir la compétence à apprendre en la décrivant en étapes concrètes;
- b) modéliser ou manifester la compétence auprès de la personne ;
- (c) que la personne pratique la nouvelle compétence par jeu de rôle avec de la rétroaction corrective (feedback);
- d) utiliser les « devoirs » pour élargir les possibilités d’apprentissage
- e) faire pratiquer l’habileté dans des situations de plus en plus difficiles avec de la rétroaction constante.
Il convient de noter que des recherches antérieures ont souligné l’importance de la résolution de problèmes en tant que compétence sociale spécifique qui devrait être enseignée aux délinquants, applicable à une grande variété de situations à haut risque (Trotter, 1999, 2006).
Au sein de la prison, les membres du personnel devraient recevoir une formation approfondie en restructuration cognitive. Plus précisément, les membres du personnel devraient pouvoir enseigner aux personnes suivies comment décrire objectivement les situations problématiques ainsi que leurs pensées et sentiments. Les professionnels devraient alors aider les délinquants à identifier les pensées à risque à mettre en œuvre des solutions alternatives plus prosociales.
De nombreux programmes correctionnels utilisent les « rapports de pensée » ou tableaux des pensée » (voir Bush, Bilodeau et Kornick, 1995) pour aider les personnes à identifier les pensées et sentiments à risques et comment ceux-ci affectent leur comportement.
Enfin, pour assurer le développement d’une alliance de travail entre le personnel et la population pénale, le personnel devraient posséder plusieurs compétences relationnelles importantes. Les membres du personnel doivent être ouverts, chaleureux et manifester une communication respectueuse. Les membres du personnel devraient également être non jugeants, empathiques, souples, enthousiastes et stimulants.
En outre, les professionnels les plus efficaces utilisent l’humour, expriment leur optimisme, sont structurés et directifs, et sont centrés sur les solutions (plutôt que sur les problèmes).
Plus encore, ces professionnels évitent les arguments et les luttes de pouvoir avec les personnes suivies, ils travaillent à développer la motivation intrinsèque et renforcent le sentiment d’efficacité personnelle des personnes. »
source et article complet: The therapeutic prison (in english only)





 Résumé
Résumé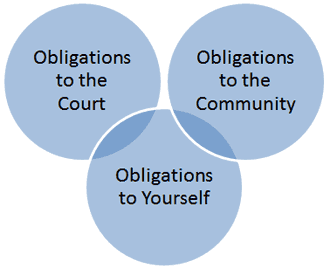 Les méthodes de traitement criminologique efficaces (evidence-based practices – EBP) ont le vent en poupe dans les SPIP et l’adoption du Référentiel des Pratiques Professionnelles (RPO1) en est l’heureux témoin.
Les méthodes de traitement criminologique efficaces (evidence-based practices – EBP) ont le vent en poupe dans les SPIP et l’adoption du Référentiel des Pratiques Professionnelles (RPO1) en est l’heureux témoin.