Échelle d’empathie pour les victimes de viol (RVES) et échelle d’empathie pour les auteurs de viol (RPES)
 “Examining Rape Empathy from the Perspective of the Victim and the Assailant” by C. A. Smith and I. H. Frieze, 2003, Journal of Applied Social Psychology, 33
“Examining Rape Empathy from the Perspective of the Victim and the Assailant” by C. A. Smith and I. H. Frieze, 2003, Journal of Applied Social Psychology, 33
Ces dernières années, les chercheurs ont commencé à examiner les facteurs qui influencent l’empathie pour les auteurs et les victimes de viol (Feldman, Ullman, & Denkel-Schetter, 1998 ; Jimenez & Abreu, 2003 ; Osman, 2011). L’empathie à l’égard du viol est définie comme la capacité de comprendre la victime et/ou l’auteur d’un viol en réfléchissant sur son expérience, ses émotions et ses actions au moment du viol (Deitz, Blackwell, Daley, & Bentley, 1982 ; Osman, 2011 ; Smith & Frieze, 2003). Une étude a révélé que les participants qui partageaient des caractéristiques similaires avec une victime de viol décrite dans un article de journal, comme le fait qu’ils étaient tous les deux étudiants, avaient plus d’empathie envers la victime que ceux qui n’avaient pas de caractéristiques communes (Feldman et al., 1998). De même, les participants ayant des antécédents de victimisation sexuelle étaient plus empathiques envers la victime de viol que l’agresseur (Miller, Amacker et King, 2011 ; Osman, 2011). Il est intéressant de noter que les participants de sexe masculin ayant des antécédents de victimisation sexuelle n’ont montré aucune différence dans les niveaux d’empathie envers les victimes de sexe masculin ou féminin (Osman, 2011). En ce qui concerne l’empathie des agresseurs, les hommes ont tendance à être beaucoup plus empathiques envers les agresseurs de viol qu’envers les victimes de viol (Osman, 2011 ; Sinclair et Bourne, 1998). La plupart des études analysant l’empathie à l’égard du viol ont utilisé l’échelle Rape Empathy Scale (Deitz et 1982 ; Deitz, Littman et Bentley, 1984 ; Jimenez et Abreu, 2003 ; O’Donohue, Yeater, et Fanetti, 2003). Des études utilisant cette échelle ont révélé que les participantes ont plus d’empathie envers les victimes de viol que les hommes (Jimenez et Abreu, 2003 ; Sinclair et Bourne, 1998). En outre, les participants qui ont peu d’empathie pour les victimes de viol considèrent les victimes de viol peu attrayantes comme étant plus responsables du viol et sont plus susceptibles de les blâmer que les victimes attrayantes (Deitz, et al., 1984). Bien que l’échelle d’empathie à l’égard du viol ait fourni des données utiles, les critiques ont souligné qu’un problème majeur de cette échelle est qu’elle est unilatérale et qu’elle exige donc de ne s’identifier qu’à la victime ou à l’auteur (Osman, 2011 ; Smith et Frieze, 2003). Un autre problème est que certains éléments de l’échelle décrivent des mythes sur le viol, tels que » je pense qu’il est (impossible) possible pour un homme de violer une femme contre sa volonté » (Smith & Frieze, 2003, p. 477). Comme les mythes sur le viol reflètent les préjugés des participants, il est possible que ces éléments de l’échelle ne mesurent pas réellement l’empathie et pourraient donc fausser les résultats de l’échelle. Afin de résoudre ces problèmes, Smith et Frieze (2003) ont créé l’échelle d’empathie pour les victimes de viol et l’échelle d’empathie pour les auteurs de viol. Ces échelles permettent aux participants de juger de l’empathie envers la victime et l’agresseur indépendamment l’un de l’autre. Ainsi, les participants peuvent exprimer de l’empathie envers la victime, l’agresseur ou les deux. Les résultats obtenus à l’aide de cette échelle ont donné des résultats similaires à ceux d’autres études sur l’empathie à l’égard du viol, les hommes faisant preuve d’une plus grande empathie envers l’agresseur et les femmes d’une plus grande empathie envers la victime (Osman, 2011 ; Smith et Frieze, 2003).
L’empathie de la victime de viol et l’empathie de l’auteur du viol ne sont pas corrélées, donc mesurées avec des échelles différentes : la Rape Victim Empathy Scale (RVES) & la Rape Perpetrator Empathy Scale (RPES).
Ces échelles ont été développées par Smith & Frieze en 2003 pour comprendre la nature empathique de l’observateur envers la victime de viol et l’auteur du viol respectivement.
RVES: Il s’agit d’un total de 18 items cotés sur l’échelle de Linkert à 7 points allant de » fortement en désaccord » à » fortement en accord « [Fig 2.4]. Certains items utilisés ont été tirés de RES (Rape Empathy Scale, Dietz et al.,1982) . Il mesure l’empathie pendant (la sous-échelle) et après (la sous-échelle) le viol, de sorte que des scores d’empathie élevés signifient une grande empathie pour la victime. L’échelle est conçue de manière à être neutre sur le plan du genre, de sorte que nous puissions mesurer l’empathie des hommes et des femmes victimes et auteurs de violence.
RPES: Elle reflète les aspects émotionnels et cognitifs concernant l’auteur du viol pour mesurer l’empathie pendant (la sous-échelle) et après (la sous-échelle) le viol. Il se compose de 18 éléments cotés sur l’échelle de Likert en 7 points allant de » fortement en désaccord » à » fortement d’accord « . Chaque élément utilisé ici est parallèle aux éléments utilisés dans l’échelle d’empathie des victimes de viol et est également neutre du point de vue du genre. Ici, une empathie plus faible signifie la nature empathique envers l’agresseur ou nous pouvons également inverser l’échelle où un score plus élevé se rapporte à une plus grande empathie envers l’agresseur.
(source : Mary Dorene Bell (2013) thèse de psychologie, « PERCEPTIONS OF AN ACQUANTANCE RAPE: THE RAMIFICATIONS OF VICTIM’S WEIGHT, SEXUAL HISTORY AND CLOTHING « , Department of Psychology California State University, Sacramento)
|
Échelle d’empathie pour les victimes de viol (RVES)
|
|
1
|
Je trouve facile de prendre le point de vue d’une victime de viol.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
2
|
Je peux imaginer ce que ressent une victime pendant un viol.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
3
|
Je m’implique vraiment dans les sentiments d’une victime de viol dans un film.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
4
|
Je peux comprendre à quel point une victime de viol peut se sentir impuissante.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
5
|
Je peux sentir l’humiliation d’une personne d’être forcée d’avoir des rapports sexuels contre sa volonté.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
6
|
Entendre parler de quelqu’un qui a été violé me fait sentir combien cette personne est bouleversée.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
7
|
Il n’est pas difficile de comprendre les sentiments d’une personne qui est forcée d’avoir des relations sexuelles.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
8
|
Je peux comprendre la honte et l’humiliation qu’une victime de viol ressent lors d’un procès pour prouver son viol.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
9
|
Je sais que si je parlais à quelqu’un qui a été violé, je serais bouversé.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
10
|
J’imagine le traumatisme émotionnel qu’une victime de viol pourrait ressentir si le procès du viol était rendu public dans la presse.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
11
|
J’imagine le courage qu’il faut pour accuser une personne de viol devant un tribunal.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
12
|
Je peux comprendre pourquoi une victime de viol se sent mal pendant longtemps.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
13
|
J’imagine la colère qu’une personne ressent après avoir été violée.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
14
|
J’ai du mal à savoir ce qui se passe dans la tête d’une victime de viol.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
15
|
Je ne comprends pas comment une personne violée peut être bouleversée.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
16
|
Je ne comprends pas comment quelqu’un qui a été violé peut blâmer son partenaire et ne pas prendre une partie de la responsabilité.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
17
|
Je peux voir comment quelqu’un qui a été violé serait bouleversé lors de son procès pour viol
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
18
|
Je peux sentir le tourment émotionnel qu’une victime de viol subit lorsqu’elle a affaire avec la police.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
Échelle d’empathie pour les auteurs de viol (RPEM)
|
|
1
|
Je trouve facile de prendre le point de vue d’une personne qui viole.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
2
|
Je peux imaginer ce que peut ressentir une personne qui viole lors d’un viol réel.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
3
|
Je m’implique vraiment dans les sentiments d’un violeur dans un film.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
4
|
Je peux comprendre à quel point un violeur peut se sentir puissant.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
5
|
En entendant parler d’un viol, je peux imaginer les sentiments du violeur.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
6
|
Il n’est pas difficile de comprendre les sentiments qui poussent quelqu’un à forcer une autre personne à avoir des rapports sexuels.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
7
|
Je sais que si je parlais à quelqu’un accusé de viol, je serais en colère contre lui
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
8
|
Je ressens l’humiliation d’être accusé d’avoir forcé quelqu’un à avoir des rapports sexuels.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
9
|
Je peux comprendre la honte et l’humiliation qu’un violeur accusé ressent lors d’un procès pour viol.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
10
|
J’imagine la colère qu’une personne éprouverait en étant accusée.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
11
|
Je ressens le traumatisme émotionnel qu’une personne accusée de viol pourrait ressentir si le procès pour viol était rendu public dans la presse.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
12
|
J’imagine le courage qu’il faut pour se défendre devant un tribunal contre l’accusation de viol.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
13
|
Je peux comprendre les sentiments d’un violeur après un viol.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
14
|
J’ai du mal à savoir ce qui se passe dans la tête d’un violeur.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
15
|
Je ne vois pas comment une personne accusée de viol pourrait être bouleversée.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
16
|
Je ne comprends pas comment quelqu’un accusé de viol peut blâmer sa victime.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
17
|
Je peux voir comment une personne accusée de viol serait bouleversée lors de son procès pour viol.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
|
18
|
Je peux sentir le tourment émotionnel qu’une personne accusée de viol subit lorsqu’elle a affaire avec la police.
|
1 2 3 4 5 6 7
|
Échelle d’empathie pour les victimes de viol (RVES)
Le Coping Using Sex Inventory (CUSI ; Cortoni & Marshall, 2001) a été utilisé pour évaluer l’autorégulation par le sexe. Le CUSI évalue l’utilisation du sexe comme stratégie d’adaptation pour faire face aux états négatifs associés aux situations stressantes. L’échelle comprend 16 items relatifs à des activités sexuelles consenties et non consenties avec des adultes et des enfants. Les items décrivent quatre types d’activités sexuelles : les fantasmes, la masturbation, l’utilisation de la pornographie et le comportement sexuel réel avec un partenaire. Les répondants indiquent, sur une échelle de 5 points, la fréquence à laquelle ils se livrent à ces activités sexuelles lorsqu’ils se trouvent dans des situations stressantes ou difficiles. Le CUSI est une échelle multidimensionnelle qui contient trois facteurs liés aux activités sexuelles consensuelles (CUSI consentement), aux comportements de viol (CUSI viol) et aux abus sexuels sur des enfants (CUSI enfant). La cohérence interne de l’échelle globale est de 0,88, et il a été constaté qu’elle permettait de distinguer les délinquants sexuels des délinquants non sexuels (Cortoni & Marshall, 2001).


 La décision d’une rétention de sûreté repose en grande partie sur le critère de « dangerosité » qui dépend lui-même d’une évaluation du risque de récidive que présente un condamné. Un tel pronostic, nécessairement aléatoire, requiert l’expertise des psychiatres dont le rôle est alors essentiel et la responsabilité engagée.
La décision d’une rétention de sûreté repose en grande partie sur le critère de « dangerosité » qui dépend lui-même d’une évaluation du risque de récidive que présente un condamné. Un tel pronostic, nécessairement aléatoire, requiert l’expertise des psychiatres dont le rôle est alors essentiel et la responsabilité engagée.
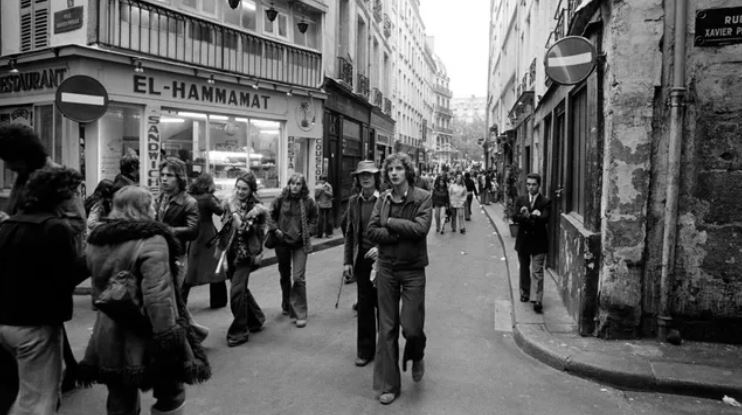 Thomas Legrand profite de cette semaine de Grenelle contre les violences faites aux femmes pour faire entendre un son provenant des archives de l’INA. Cela vient d’un reportage télévisé par France 3 Nancy, réalisé en 1975. On y voit des hommes évoquer la question des viols.
Thomas Legrand profite de cette semaine de Grenelle contre les violences faites aux femmes pour faire entendre un son provenant des archives de l’INA. Cela vient d’un reportage télévisé par France 3 Nancy, réalisé en 1975. On y voit des hommes évoquer la question des viols.