FRANCE INTER (mardi 3 juin 2014) Le 7/9 à propos de la réforme pénale
Peines hors les murs : l’exemple du bracelet électronique
Avec la contrainte pénale, la loi qui arrive ce mardi en première lecture à l’assemblée nationale veut aménager des peines à l’extérieur des prisons. Faire sa peine hors les murs, cela existe déjà. Est-ce que ça marche ? Zoom sur le bracelet électronique.
Le principe de ce boulet des temps modernes est simple : la personne condamnée s’engage à rester à son domicile à certaines heures, fixées par le juge (par exemple de 19h à 8h du matin). Si elle s’en éloigne trop, un surveillant pénitentiaire est prévenu à distance. Pour l’instant, le placement sous surveillance électronique, alternatif à la prison, n’est possible que sous certaines conditions : une courte peine – il faut que la personne ait été condamnée à moins de 2 ans d’emprisonnement – et qu’elle ait un sérieux projet de réinsertion. En 2012, le système concernait 8.856 personnes, selon l’administration pénitentiaire. En ce moment, 11.700 personnes vivent avec un bracelet électronique en France.
600.000 personnes
Avec la contrainte pénale, le texte qui arrive ce mardi à l’Assemblée prévoit d’étendre la possibilité de purger sa peine hors des prisons, à tous les délits (vols, délits routiers, dégradations…). Le gouvernement est favorable à limiter son application à ceux qui sont punissables au maximum de 5 ans d’emprisonnement. 600.000 personnes par an comparaissent devant un tribunal correctionnel. Les quelques 2.500 crimes jugés chaque année (viols, meurtres, vols à main armée…) ne sont pas concernés.
Faire des économies
Un des objectifs de ce texte : désengorger les prisons. Il permettrait aussi de réduire les coûts. En effet, une journée en détention au sein d’un établissement pénitentiaire coûte environ 100 euros par personne. Une journée sous surveillance électronique : 10 euros.
Prévenir la récidive
En outre, le système pourrait aider les délinquants à ne pas retourner en prison. Une étude réalisée en France, publiée en 2011, analyse le taux de récidive ; il serait de 61% pour des personnes initialement condamnées à de la prison ferme, deux fois moins élevé (32%) pour des personnes condamnées à des peines de prison avec sursis.
Pierre BOTTON: « Que la première minute de condamnation soit la première minute de réinsertion » (mardi 3 juin 2014)
Pierre Botton, ancien détenu et président de l’association« Ensemble contre la récidive »est l’invité de Clara Dupont-Monod.
L’invité de 7h50 : Pierre Botton par franceinter



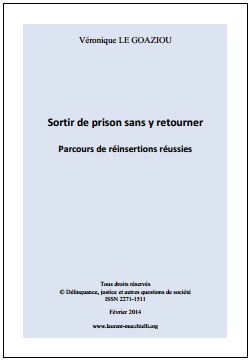 La surpopulation carcérale pose de façon aigüe la question de la réinsertion des personnes qui séjournent en prison. Beaucoup d’éducateurs, de visiteurs de prisons, de magistrats, de responsables des collectivités territoriales, d’avocats partagent une conviction : le travail de réinsertion est indispensable si l’on veut éviter que l’univers carcéral devienne un cercle infernal dont on ne sort que pour le retrouver après un bref passage en dehors. Dès lors, comment se donner les moyens de réussir ce pari ?
La surpopulation carcérale pose de façon aigüe la question de la réinsertion des personnes qui séjournent en prison. Beaucoup d’éducateurs, de visiteurs de prisons, de magistrats, de responsables des collectivités territoriales, d’avocats partagent une conviction : le travail de réinsertion est indispensable si l’on veut éviter que l’univers carcéral devienne un cercle infernal dont on ne sort que pour le retrouver après un bref passage en dehors. Dès lors, comment se donner les moyens de réussir ce pari ?