Guide d’évaluation de la qualité des rapports présentenciels (d’après Gels thorpe, Raynor et Tisi, 1992)
Évaluation de la qualité des rapports
« Une étude récente menée en préparation de la loi de 1991 (Gelsthorpe et Raynor, 1992) a permis d’effectuer un audit de qualité d’un certain nombre de rapports et de vérifier l’opinion des
des condamnés des Crown Courts sur les rapports en général, ainsi que sur la qualité et l’utilité des rapports particuliers qui leur sont présentés.
L’étude est née de l’exigence de la loi selon laquelle un tribunal chargé de la détermination de la peine doit normalement obtenir et examiner un rapport présentenciel dans un certain nombre de cas où un rapport d’enquête sociale était auparavant facultatif et, bien souvent, n’était pas établi s’il n’y avait pas de rapport avant le procès et un rapport aurait nécessité un nouvel ajournement à la suite d’une condamnation ou d’une modification tardive du plaidoyer. Cette situation a suscité des inquiétudes quant au nombre de rapports supplémentaires et aux ressources nécessaires pour les produire, ainsi que les des retards possibles, d’autres ajournements et peut-être davantage de placements en détention provisoire lorsqu’un plaidoyer de non-culpabilité empêchait
l’élaboration d’un rapport préalable au procès. (…)
La qualité des rapports était une question particulièrement sensible dans ces études, car il n’existait pas de norme générale en matière de qualité des rapports, et qu’il n’existe que peu de connaissances sur ce que les condamnés des Crown Courts pensaient des rapports normalement produits à leur intention. La méthode mise au point par les chercheurs comportait deux approches assez différentes et complémentaires.
L’instrument d’évaluation de la qualité était basé sur les directives officielles existantes et sur la théorie et la pratique du service de probation concernant les rapports d’enquête sociale. Des influences importantes ont été exercées par Bottoms et Steiman (1988), Raynor (1980 et 1985) et Gelsthorpe (1991).
L’exercice a finalement porté sur 42 variables relevant principalement de 5 rubriques. Ces variables concernaient:
- l’évaluation du rapport en ce qui concerne la couverture du contexte pertinent ;
- la présentation équilibrée et objective de l’accusé ;
- la couverture de l’infraction actuelle et des infractions antérieures, le cas échéant
- la couverture des options de condamnation et sur le style général,
- la lisibilité et la présentation.
Ces cinq notes partielles s’ajoutent les unes aux autres pour obtenir un score de qualité global. L’instrument utilisé était un précurseur du Quality Assessment Guide for pre-sentence reports (Guide d’évaluation de la qualité des rapports pré-sentenciels) produits ultérieurement par les mêmes chercheurs (Gelsthorpe, Raynor et Tisi, 1992)
 La conclusion la plus importante pour des raisons pratiques immédiates est que la qualité moyenne des rapports de notification rapide ne diffère pas significativement de la qualité moyenne des rapports pour lesquels des délais de préparation plus longs avaient été accordés.
La conclusion la plus importante pour des raisons pratiques immédiates est que la qualité moyenne des rapports de notification rapide ne diffère pas significativement de la qualité moyenne des rapports pour lesquels des délais de préparation plus longs avaient été accordés.
Cette constatation s’est reflétée dans l’orientation finalement donnée par le ministère de l’Intérieur au service de de probation et aux Crown Courts sur le développement du système de
système de rapports pré-sentenciels. En fait, la qualité des rapports était très inégale et incohérente, quel que soit le temps disponible. Les rapports à court terme contenaient environ autant de bons et de mauvais rapports que dans le reste de l’échantillon, et bien que les meilleurs rapports soient excellents, certains des moins bons étaient très faibles. Il est manifestement important que l’introduction de normes nationales pour les rapports soit soutenue par des procédures de formation et de contrôle de la qualité qui contribueront à éliminer le bas de la fourchette. En passant, il convient de noter que la majorité des rapports contenaient des fautes d’orthographe, de grammaire ou de ponctuation, généralement mineures, mais parfois non.
Il est également inquiétant de constater que la plupart des rapports consacrent toujours plus d’espace à l’histoire sociale du sujet qu’à l’examen de la délinquance ou de la condamnation.
Bien qu’en général les différences entre les rapports n’aient pas grand-chose à voir avec le temps disponible pour leur préparation, il y a quelques différences entre les rapports à préavis court et les rapports à préavis long. Les rapports plus rapides ont eu tendance, en moyenne, à être moins approfondies dans leur analyse de la délinquance, peut-être parce qu’il faut plus d’un entretien pour obtenir une image claire et réaliste d’un modèle de délinquance.Les rapports les plus rapides sont également moins susceptibles d’avoir utilisé des informations provenant d’autres sources que le défendeur, les procédures judiciaires et les dossiers des services de probation. Parents, partenaires, employeurs ou d’autres contacts utiles dans la communauté dans les rapports lorsque l’on disposait de plus de temps.
L’étude a également tenté d’identifier les différences dans la manière dont les rédacteurs de rapports ont abordé les différents groupes de délinquants. Des différences ont été constatées entre les
entre les rapports sur les femmes et les hommes. Les rapports sur les femmes étaient d’une qualité moyenne légèrement inférieure, principalement parce qu’ils avaient tendance à être moins bien documentés que ceux sur les hommes. Elles étaient également beaucoup moins susceptibles que les hommes d’être jugées aptes à effectuer un travail d’intérêt général. Les femmes figurent également en bonne place dans les rapports sur les hommes, par exemple en tant que partenaires ou mères. Une dispute avec un partenaire ou une séparation temporaire d’avec elle était souvent présentée comme une sorte de circonstance atténuante pour expliquer pourquoi un homme était passé à l’acte, par exemple dans une beuverie qui s’est terminée par un cambriolage ou une bagarre. Alternativement, un nouveau partenaire ou un partenaire réconcilié était présenté comme une raison de ne plus commettre de délits à l’avenir. Une femme a réussi à jouer les deux rôles, celui de provocatrice des délits passés et celui d’assurance contre les délits futurs. Si les délinquants masculins sont encouragés à croire que leurs délits sont causés ou évités de cette manière, cela pourrait ne pas les aider à assumer la responsabilité de leur propre délinquance ou non-délinquance ».
Evaluation rapports presentenciels
Sources:
- Peter Raynor ; David Smith & Maurice Vanstone (1994) Effective Probation Practice , ed mc Millan
- Gelsthorpe, L. R., Raynor, P. and Tisi, A. (1992) Quality assurance in pre-sentence reports, report to the Home Office Research and Planning Unit.



 « Jusqu’à récemment, la plupart des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de l’initiative « What Works » concernaient de programmes efficaces, principalement, mais pas toujours, des programmes avec du travail en groupe. Mais dès 1997, Underdown a souligné l’importance de la gestion des cas dans le cadre de What Works. Pour lui, la gestion de cas consistait principalement à guider et à soutenir le travail du programme, par une bonne évaluation, la planification, la motivation et la prévention des rechutes. Depuis lors, certains chercheurs sont allés plus loin et ont affirmé l’importance d’une bonne gestion de cas, plutôt que de programmes, pour des interventions efficaces. La relation entre l’agent et l’auteur de l’infraction est au cœur de cette démarche (voir, par exemple, Burnett et McNeill 2005).
« Jusqu’à récemment, la plupart des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de l’initiative « What Works » concernaient de programmes efficaces, principalement, mais pas toujours, des programmes avec du travail en groupe. Mais dès 1997, Underdown a souligné l’importance de la gestion des cas dans le cadre de What Works. Pour lui, la gestion de cas consistait principalement à guider et à soutenir le travail du programme, par une bonne évaluation, la planification, la motivation et la prévention des rechutes. Depuis lors, certains chercheurs sont allés plus loin et ont affirmé l’importance d’une bonne gestion de cas, plutôt que de programmes, pour des interventions efficaces. La relation entre l’agent et l’auteur de l’infraction est au cœur de cette démarche (voir, par exemple, Burnett et McNeill 2005).
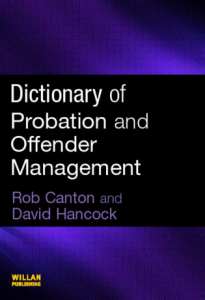
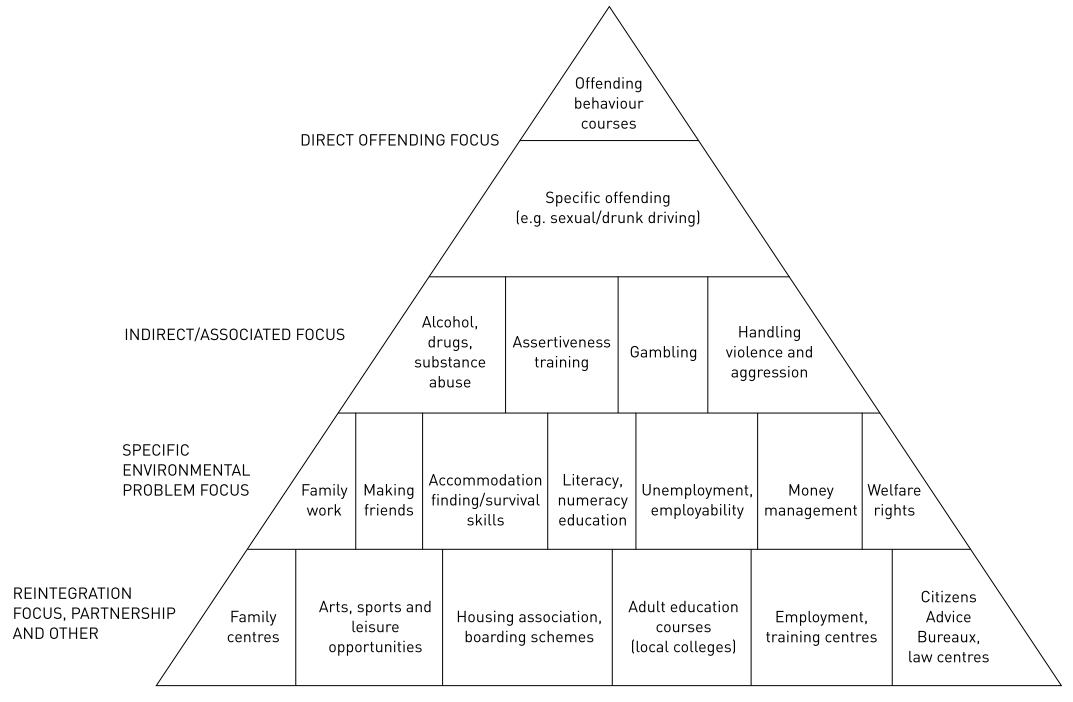

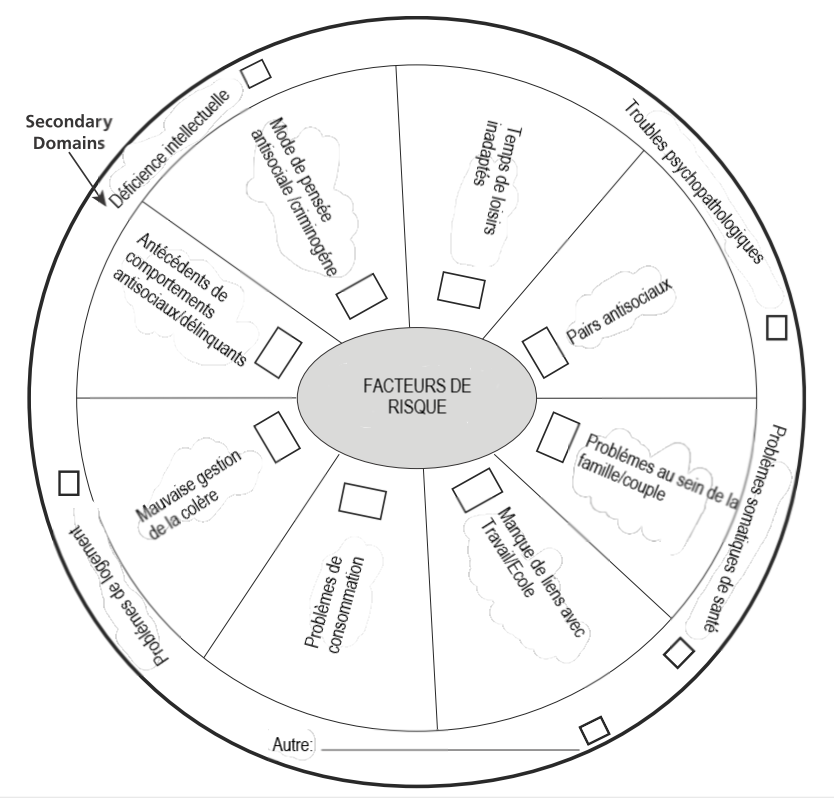
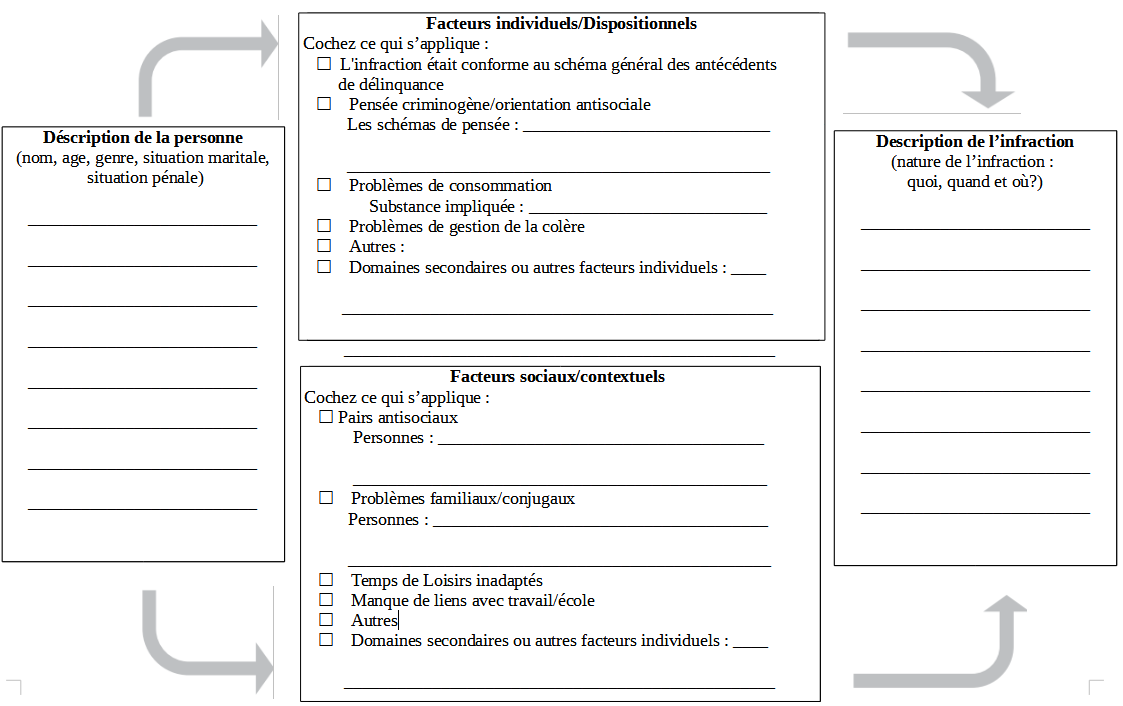
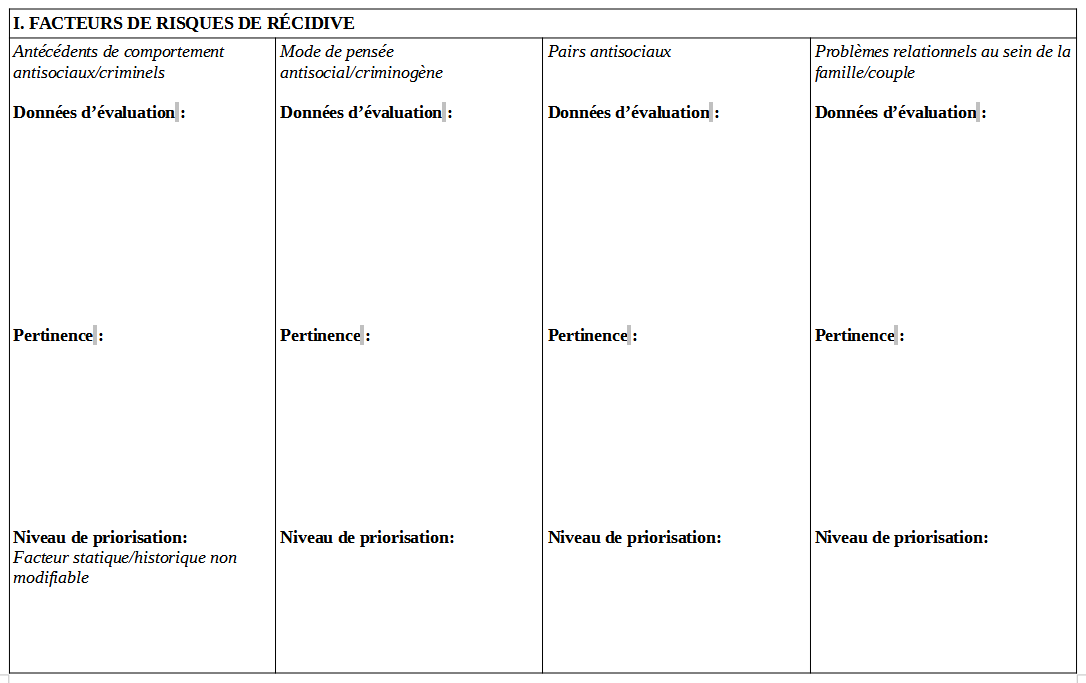
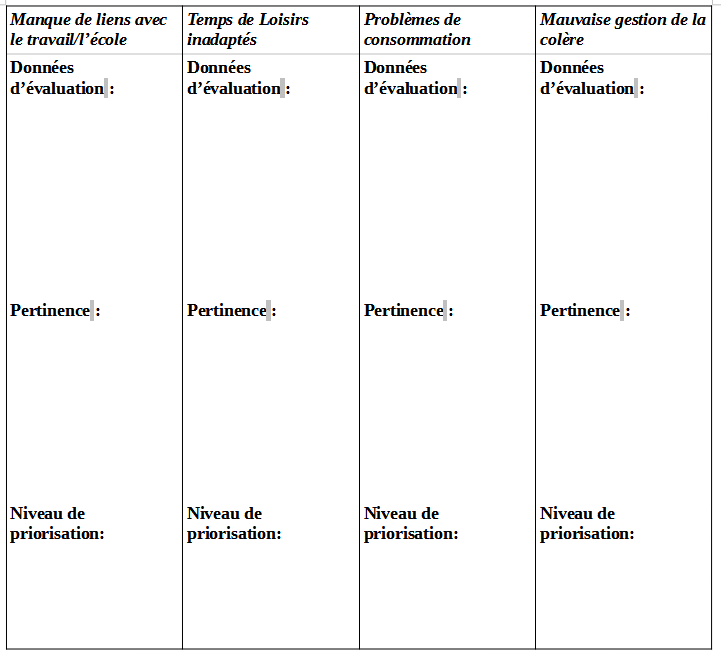
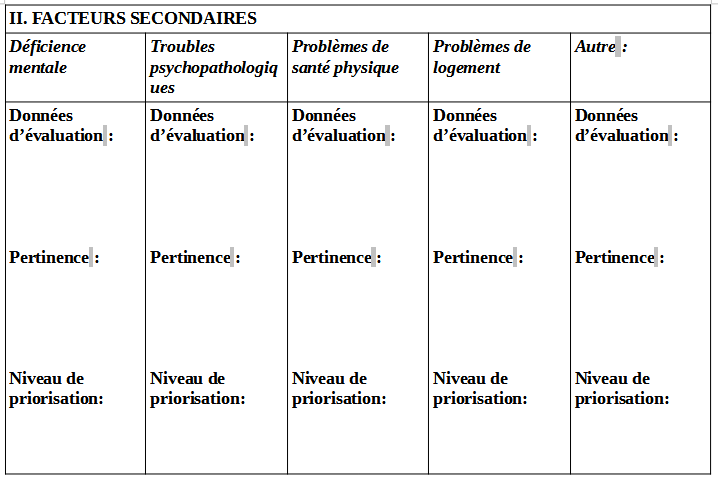
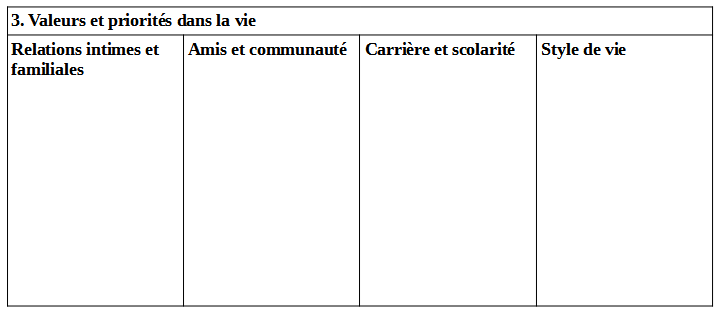
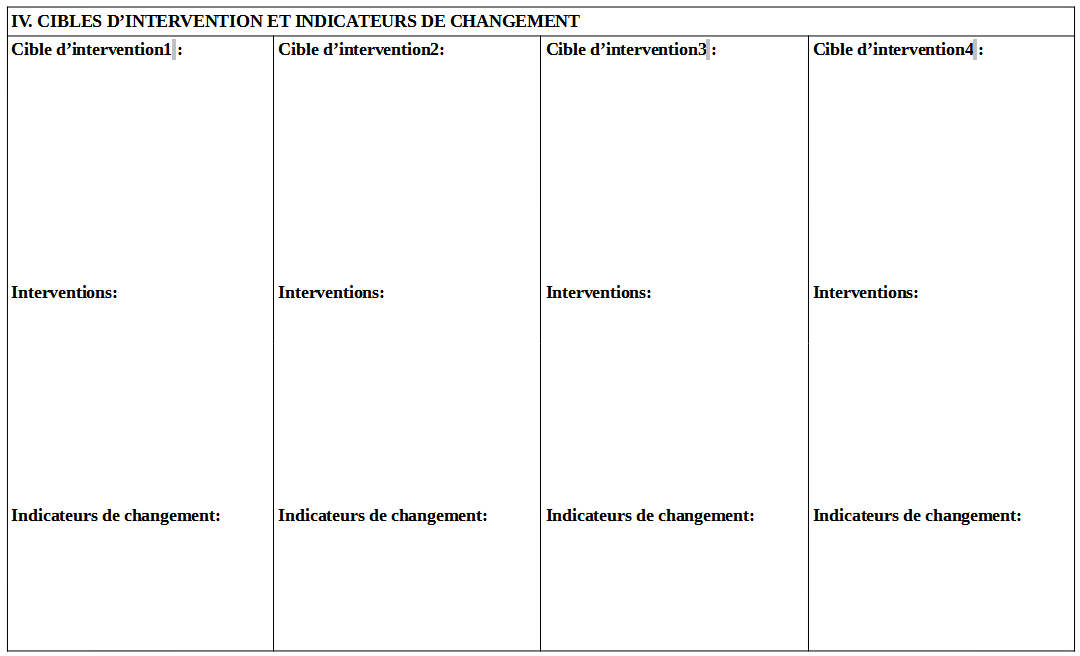
 Raymond Chip Tafrate, PhD, est psychologue clinicien et professeur au département de criminologie et de justice pénale de la Central Connecticut State University. Il est membre et superviseur de l’Albert Ellis Institute à New York City, NY, et membre du Motivational Interviewing Network of Trainers (réseau de formateurs à l’entretien motivationnel). Il consulte fréquemment des agences et des programmes de justice pénale sur des problèmes difficiles à changer tels que la dysrégulation de la colère et le comportement délinquant. Il est coauteur de nombreux ouvrages et a présenté ses recherches dans toute l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Australie. Il est coauteur, avec Howard Kassinove, d’un classique de l’auto-assistance, Anger Management for Everyone (La gestion de la colère pour tous).
Raymond Chip Tafrate, PhD, est psychologue clinicien et professeur au département de criminologie et de justice pénale de la Central Connecticut State University. Il est membre et superviseur de l’Albert Ellis Institute à New York City, NY, et membre du Motivational Interviewing Network of Trainers (réseau de formateurs à l’entretien motivationnel). Il consulte fréquemment des agences et des programmes de justice pénale sur des problèmes difficiles à changer tels que la dysrégulation de la colère et le comportement délinquant. Il est coauteur de nombreux ouvrages et a présenté ses recherches dans toute l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Australie. Il est coauteur, avec Howard Kassinove, d’un classique de l’auto-assistance, Anger Management for Everyone (La gestion de la colère pour tous). Damon Mitchell est psychologue agréé et professeur associé au département de criminologie et de justice pénale de la Central Connecticut State University.
Damon Mitchell est psychologue agréé et professeur associé au département de criminologie et de justice pénale de la Central Connecticut State University. David J. Simourd. Jusqu’à sa mort en 2022, David J. Simourd, PhD, CPsych, a exercé en cabinet privé à Kingston, Ontario, Canada, et a mené une carrière de 30 ans en tant que consultant/formateur, clinicien et chercheur. Le Dr Simourd a publié des articles, animé des ateliers de formation et agi à titre de consultant en évaluation et en traitement des délinquants auprès de divers organismes correctionnels en Amérique du Nord, en Asie et dans les Caraïbes. Il a fait partie du comité de rédaction de Criminal Justice and Behavior et a été membre de la Commission d’examen de l’Ontario, la commission d’engagement civil pour les délinquants souffrant de troubles mentaux en Ontario. En 2019, il a été élu membre de la Société canadienne de psychologie.
David J. Simourd. Jusqu’à sa mort en 2022, David J. Simourd, PhD, CPsych, a exercé en cabinet privé à Kingston, Ontario, Canada, et a mené une carrière de 30 ans en tant que consultant/formateur, clinicien et chercheur. Le Dr Simourd a publié des articles, animé des ateliers de formation et agi à titre de consultant en évaluation et en traitement des délinquants auprès de divers organismes correctionnels en Amérique du Nord, en Asie et dans les Caraïbes. Il a fait partie du comité de rédaction de Criminal Justice and Behavior et a été membre de la Commission d’examen de l’Ontario, la commission d’engagement civil pour les délinquants souffrant de troubles mentaux en Ontario. En 2019, il a été élu membre de la Société canadienne de psychologie.

 Raymond Chip Tafrate, PhD, est psychologue clinicien et professeur au département de criminologie et de justice pénale de la Central Connecticut State University. Il est membre et superviseur de l’Albert Ellis Institute à New York City, NY, et membre du Motivational Interviewing Network of Trainers (réseau de formateurs à l’entretien motivationnel). Il consulte fréquemment des agences et des programmes de justice pénale sur des problèmes difficiles à changer tels que la dysrégulation de la colère et le comportement délinquant. Il est coauteur de nombreux ouvrages et a présenté ses recherches dans toute l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Australie. Il est coauteur, avec Howard Kassinove, d’un classique de l’auto-assistance, Anger Management for Everyone (La gestion de la colère pour tous).
Raymond Chip Tafrate, PhD, est psychologue clinicien et professeur au département de criminologie et de justice pénale de la Central Connecticut State University. Il est membre et superviseur de l’Albert Ellis Institute à New York City, NY, et membre du Motivational Interviewing Network of Trainers (réseau de formateurs à l’entretien motivationnel). Il consulte fréquemment des agences et des programmes de justice pénale sur des problèmes difficiles à changer tels que la dysrégulation de la colère et le comportement délinquant. Il est coauteur de nombreux ouvrages et a présenté ses recherches dans toute l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Australie. Il est coauteur, avec Howard Kassinove, d’un classique de l’auto-assistance, Anger Management for Everyone (La gestion de la colère pour tous).