La thérapie comportementale dialectique (TCD) ou Dialectical behavior therapy (DBT).
 La thérapie comportementale dialectique (TCD), développée par Marsha Linehan (1993), est un traitement très prometteur pour le traitement des traumatismes. Il a été utilisé très efficacement pour aider les personnes qui ont des difficultés à gérer leurs émotions et à nouer des relations étroites, et avec les personnes qui pensent à se faire du mal. La thérapie comportementale dialectique met l’accent sur les émotions – en particulier la façon dont nous apprenons à gérer les sentiments difficiles. Si vous vous êtes déjà trouvé émotions difficiles, et si ces émotions interfèrent avec vos relations, la TCD peut être très utile. Elle repose sur les hypothèses suivantes :
La thérapie comportementale dialectique (TCD), développée par Marsha Linehan (1993), est un traitement très prometteur pour le traitement des traumatismes. Il a été utilisé très efficacement pour aider les personnes qui ont des difficultés à gérer leurs émotions et à nouer des relations étroites, et avec les personnes qui pensent à se faire du mal. La thérapie comportementale dialectique met l’accent sur les émotions – en particulier la façon dont nous apprenons à gérer les sentiments difficiles. Si vous vous êtes déjà trouvé émotions difficiles, et si ces émotions interfèrent avec vos relations, la TCD peut être très utile. Elle repose sur les hypothèses suivantes :
– Si vos réactions émotionnelles ne sont pas prises en compte (par ceux qui ont pris soin de vous) lorsque vous êtes jeune, vous aurez peut-être des difficultés à identifier, étiqueter et gérer vos émotions à l’âge adulte.
– Lorsque vous avez du mal à gérer vos émotions, cela se répercute sur vos relations avec les autres.
– Nous augmentons souvent notre niveau de détresse en pensant à ce qui s’est déjà produit et à ce qui pourrait se produire dans le futur
– La pleine conscience, qui est un ensemble de techniques permettant de revenir au moment présent, peut vous aider à gérer les émotions et les pensées pénibles.
– Il est parfois efficace d’essayer de changer les émotions négatives, et parfois d’accepter ces émotions difficiles. Vous pouvez développer des compétences pour vous aider à décider de l’approche à adopter dans diverses situations.
Le traitement par la thérapie comportementale dialectique a été développé à l’origine pour traiter les troubles de la personnalité limite. Les personnes chez qui l’on diagnostique un trouble de la personnalité limite ont souvent des difficultés relationnelles et ont souvent des antécédents de pensées et d’actions suicidaires.
Au cours des dernières années, la TCD a été utilisée pour aborder une variété de conditions, y compris le PTSD (Becker et Zayfert 2001). Ce mode de thérapie comporte plusieurs aspects : la pleine conscience, l’efficacité interpersonnelle, la régulation des émotions et la tolérance à la détresse.
LA TCD a également été testée avec des patients en contexte médicolégal, avec des résultats prometteurs dans la réduction de la violence et de la colère:
Analyse de l’étude
Cette étude visait à tester l’efficacité d’une TCD adaptée dans un contexte médico-légal masculin. L’objectif était de maximiser le rendement d’un milieu de pratique dans le cadre d’un essai quasi-contrôlé, et d’évaluer ainsi le potentiel de poursuite d’un essai contrôlé randomisé à grande échelle.
« L’épreuve de vérité pour une intervention ciblant la violence est de savoir si elle réduit les comportements violents. La fréquence des comportements violents n’a pas montré de changement significatif. Cependant, la gravité des comportements violents a diminué plus dans le groupe TCD (53% de réduction vs 22% de réduction), suggérant que la TCD a permis de réduire plus efficacement la gravité des actes que le traitement habituel. Ces gains ont été maintenus et la réduction a augmenté au fur et à mesure que le programme se poursuivait, pour une durée d’au moins six mois.
D’un point de vue anecdotique, le programme adapté de TCD a donné plusieurs résultats intéressants, ce qui indique son potentiel dans le traitement de ce groupe de clients. Le taux d’attrition très faible : un seul patient a quitté le programme, ce qui est inhabituel par rapport aux taux d’attrition observés dans d’autres études (Lipsey, 1995). En outre, lorsque le programme a pris fin, cinq patients ayant suivi la TCD ont mis en place un groupe d’entraide continuant à mettre en pratique leurs compétences et à remplir leur journal, ce qui va à l’encontre des attentes d’un faible engagement dans la thérapie (Warren et Dolan, 1996). Le point de vue du personnel confirme également l’utilité du programme. Ils rapportent que les patients ayant suivi la TCD fonctionnaient mieux dans d’autres traitements, et que les relations thérapeutiques se sont améliorées de manière significative, contrairement aux attentes (Gunderson, 1984). »
Voir l’étude (trad fr de l’étude en question): Practice-based outcomes of dialectical behaviour therapy (DBT) targeting anger and violence, with male forensic patients



 Le VRAG-R est conçu pour évaluer la probabilité de récidive violente ou sexuelle chez les délinquants de sexe masculin. L’ensemble des données comprend des informations démographiques, criminelles, psychologiques et psychiatriques sur les délinquants, recueillies dans les dossiers des institutions, ainsi que des informations sur la récidive après la libération. Le VRAG-R est un instrument actuariel à douze items et les scores obtenus à ces items font partie de l’ensemble de données.
Le VRAG-R est conçu pour évaluer la probabilité de récidive violente ou sexuelle chez les délinquants de sexe masculin. L’ensemble des données comprend des informations démographiques, criminelles, psychologiques et psychiatriques sur les délinquants, recueillies dans les dossiers des institutions, ainsi que des informations sur la récidive après la libération. Le VRAG-R est un instrument actuariel à douze items et les scores obtenus à ces items font partie de l’ensemble de données. La violence domestique est-elle courante ?
La violence domestique est-elle courante ?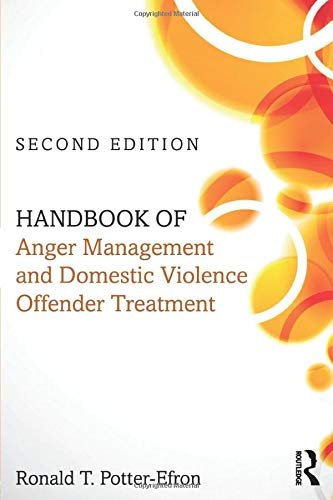 Relation entre la colère et la violence domestique
Relation entre la colère et la violence domestique