Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP) (Hart, Kropp, & Laws; Klaver, Logan, & Watt, 2003)
Le RSVP est un outil d’évaluation des risques de type « Jugement professionnel structuré » (JPS), développé suite à une revue systématique de la littérature sur la récidive sexuelle. Le RSVP définit la violence sexuelle comme «réelle, tentée ou menacée de contact sexuel avec une autre personne qui n’y consent pas » (Hart et al., 2003). Il a été élaboré à partir d’outils de JPS antérieurs tels que le précurseur du RSVP, le SVR-20 et le HCR-20 (Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997). Le RSVP peut être utilisé avec des hommes âgés de 18 ans et plus qui ont des antécédents connus ou soupçonnés de violence sexuelle. Le RSVP est destiné à aider les évaluateurs à mener une évaluation complète du risque de violence sexuelle dans des contextes cliniques et médico-légaux. L’évaluateur doit rassembler des informations complètes sur le cas à partir de sources multiples et évaluer le délinquant par rapport à vingt-deux facteurs de risque individuels ainsi que tous les autres facteurs de risque spécifiques à chaque cas.
Les vingt-deux facteurs sont divisés en cinq sections: Histoire de la violence sexuelle, problémes psychologiques, Trouble mental, Problémes sociaux et gestion. Chaque élément est codé trois fois: pour la présence dans le passé, la présence récente et la pertinence future. Chacune de ces notes est sur une échelle de trois points: 0: non preuve, 1: preuve partielle ou 2: preuve définitive. L’évaluateur doit déterminer la pertinence des facteurs de risque individuels en ce qui concerne les futures violences sexuelles potentielles et élaborer un plan de gestion des risques, décrire les scénarios les plus plausibles de futures violences sexuelles, et recommander des stratégies pour gérer le risque de violence sexuelle à la lumière des facteurs de risques et scénarios plausibles.Le manuel du RSVP stipule que ceux qui utilisent l’outil doivent avoir un bon niveau d’expérience, de compétence et de connaissance. Les caractéristiques importantes du manuel RSVP sont qu’il s’appuit sur des preuves pour chaque élément, avec des lignes directrices claires et opérationnelles pour le codage. Des ateliers de formation spécialisés sont fournis aux praticiens, mais ne sont pas obligatoires pour utiliser l’instrument. Une formation à l’utilisation du RSVP est néanmoins recommandée (Hart et al., 2003) et il existe des études qui démontrent que cette formation des utilisateurs améliore la fiabilité inter-juges des évaluation (Reichelt, James Blackburn, 2003; Muller & Wetzel, 1998; Sutherland et al, 2012). De même, selon Darjee et Russell (2012), il est important que ceux qui utilisent ces instruments d’évaluation connaissent leurs forces et leurs limites, et aient reçu une formation appropriée à leur utilisation et à l’interprétation : Il est important qu’ils sachent comment interpréter les résultats de n’importe quel outil afin d’arriver à des conclusions appropriées et de planifier la gestion des risques de manière appropriée. Donc, une importante caractéristique des outils JPS comme le RSVP, par opposition aux outils actuariels, est qu’ils dépendent non seulement du manuel et de la cotation des items mais aussi du praticien qui utilise l’instrument. Ils structurent les praticiens dans leur tâche, ils ne les remplacent pas.
Codage: RSVP_FR
Risk-for-Sexual-Violence-trad_fr_unofficial
Documentation: Risk_for_Sexual_Violence_Protocol_-_RSVP
ppt :
Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP):A real world study of the reliability, validity and utility of a structured professional judgement instrument in the assessment and management of sexual offenders in South East Scotland (January 2016)
Authors:Rajan Darjee,Katharine Russell, Lauren Forrest,Erica Milton,Valerie Savoie, Emily Baron, Jamie Kirkland & Stewart Stobie, NHS Lothian Sex Offender Liaison Service, Orchard Clinic, Royal Edinburgh Hospital
Résumé des conclusions
Cette étude apporte des preuves supplémentaires que le RSVP est un outil fiable. Ceci est vrai pour les cotations individuelles, les cotations totales et les jugements sommaires. Étant donné que les cliniciens n’utilisent pas le RSVP en additionnant les totaux, cette étude devrait leur donner confiance dans le fait que les jugements sous forme de résumé sont une méthode fiable pour résumer le risque que pose un délinquant. Il y a eu des preuves de validité convergente avec le RM2000 et le PCL-R. La validité prédictive est compliquée avec un outil comme le RSVP parce que les praticiens n’utilisent pas les scores totaux ; ils doivent utiliser les trois jugements sommaires. L’évaluation de la validité prédictive est également rendue compliquée par le niveau d’intensité que reçoivent les situations. Par conséquent, Il est irréaliste de se demander si le RSVP a une validité prédictive en matière de délits sexuels ou d’autres délits. La réponse à cette question doit plutôt prendre en compte la complexité de l’outil et l’influence potentielle du niveau de gestion. Dans notre échantillon, nous avons également constaté des différences lorsque nous avons utilisé différentes approches pour analyser les données de résultats, c’est-à-dire l’analyse ROC et l’analyse de survie. En utilisant l’analyse ROC, les scores totaux de la RSVP et certains des jugements sommaires ont prédit la violence, toute infraction grave et toute infraction sexuelle grave, mais n’ont pas prédit l’ensemble des infractions sexuelles. En utilisant l’analyse de survie, la hiérarchisation des affaires a permis de prédire le temps nécessaire à la commission de tout délit ou infraction sexuelle. Contrairement à d’autres études, nous avons ensuite tenté de prendre en compte le niveau de gestion des risques. Il est à noter que les personnes qui ont été identifiées comme présentant un risque élevé à l’aide du RSVP, et qui n’ont pas fait l’objet d’une gestion des risques proportionnelle à ce risque, ont très rapidement récidivé. L’importance du niveau de gestion des risques signifie qu’il faut faire preuve de prudence dans l’interprétation des données de validité prédictive qui ne tiennent pas compte du niveau auquel les cas sont gérés. Lors de l’examen de nos conclusions, il faut garder à l’esprit que notre échantillon de délinquants sexuels est inhabituel, complexe et à haut risque.
Le RSVP semble être un outil utile pour évaluer le risque de préjudice grave chez les délinquants sexuels, et a donc potentiellement un rôle dans certains cas au-delà des instruments obligatoires actuels pour les délinquants sexuels (c’est-à-dire la matrice de risque 2000, Stable et Aigu 2007 et LSCMI). Pour une sous-échantillon de la présente étude, nous avons entrepris une évaluation qualitative de l’utilité des évaluations RSVP du point de vue du personnel de justice pénale de première ligne chargé de superviser les affaires (ceci est rapporté ailleurs ; Judge et al. 2013). Il en ressort que le personnel de première ligne estime que les évaluations fondées sur la RSVP ont apporté une valeur ajoutée à l’évaluation et à la gestion de leurs suivis. Cela renforce l’idée que la RSVP peut jouer un rôle dans la gestion de la minorité d’agresseurs sexuels qui présentent un risque de préjudice grave.



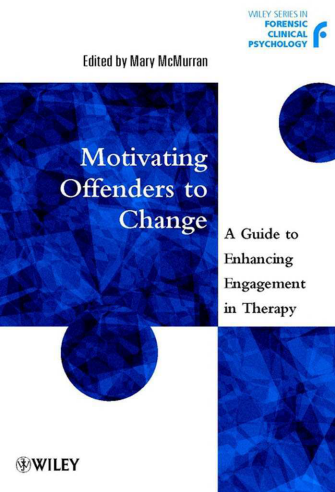
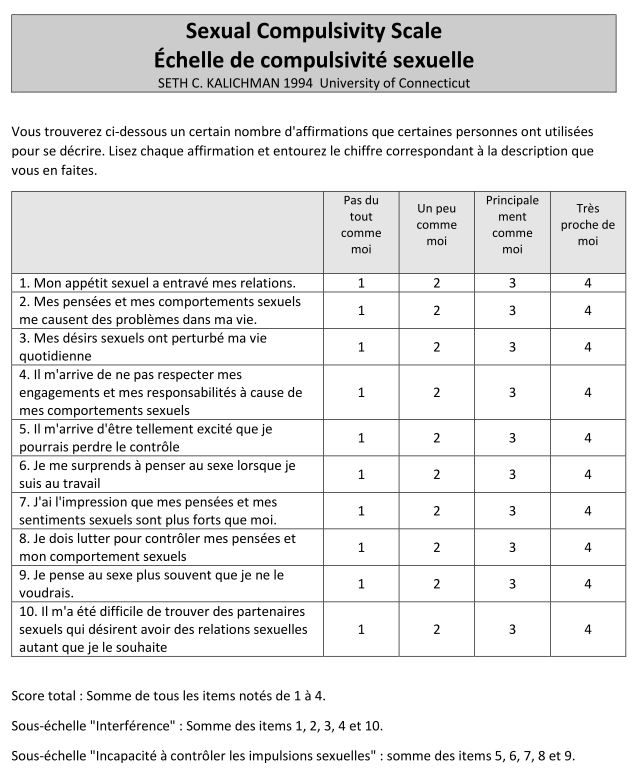
 Note. SONAR = Sex Offender Need Assessment Training.
Note. SONAR = Sex Offender Need Assessment Training. David Thornton: Le Dr Thornton est un psychologue exerçant en cabinet privé dans le Wisconsin. Il est autorisé à exercer en tant que psychologue dans le Wisconsin et le Minnesota aux États-Unis, ainsi qu’au Royaume-Uni. Il a été directeur de recherche pour le programme du Wisconsin destiné aux personnes sexuellement violentes pendant trois ans et, auparavant, directeur de traitement pour ce programme pendant plus d’une décennie. Il a publié des ouvrages sur les normes fondées sur des données probantes pour des programmes correctionnels efficaces et sur l’importance du style du thérapeute dans le cadre d’un traitement visant à réduire le risque de récidive sexuelle, contribuant à l’élaboration d’échelles telles que la Static-99, la Static-2002, la Static-99R, la Static-2002R et la Matrice du risque 2000. Il a participé au développement de l’évaluation psychologique du risque, en créant le cadre de l’évaluation structurée du risque (SRA), et aux moyens de comprendre et de mesurer les facteurs de protection, en participant à la création du SAPROF-SO. David Thornton a publié plus de 90 articles dans des revues à comité de lecture. Expérience : 2016 à ce jour : Cabinet privé; 2013-2016 : Directeur de recherche, Sand Ridge Secure Treatment Center; 2004-présent : Professeur II, Université de Bergen, Norvège; 2001-2013 : Directeur des traitements, Centre de traitement sécurisé Sand Ridge
David Thornton: Le Dr Thornton est un psychologue exerçant en cabinet privé dans le Wisconsin. Il est autorisé à exercer en tant que psychologue dans le Wisconsin et le Minnesota aux États-Unis, ainsi qu’au Royaume-Uni. Il a été directeur de recherche pour le programme du Wisconsin destiné aux personnes sexuellement violentes pendant trois ans et, auparavant, directeur de traitement pour ce programme pendant plus d’une décennie. Il a publié des ouvrages sur les normes fondées sur des données probantes pour des programmes correctionnels efficaces et sur l’importance du style du thérapeute dans le cadre d’un traitement visant à réduire le risque de récidive sexuelle, contribuant à l’élaboration d’échelles telles que la Static-99, la Static-2002, la Static-99R, la Static-2002R et la Matrice du risque 2000. Il a participé au développement de l’évaluation psychologique du risque, en créant le cadre de l’évaluation structurée du risque (SRA), et aux moyens de comprendre et de mesurer les facteurs de protection, en participant à la création du SAPROF-SO. David Thornton a publié plus de 90 articles dans des revues à comité de lecture. Expérience : 2016 à ce jour : Cabinet privé; 2013-2016 : Directeur de recherche, Sand Ridge Secure Treatment Center; 2004-présent : Professeur II, Université de Bergen, Norvège; 2001-2013 : Directeur des traitements, Centre de traitement sécurisé Sand Ridge Anthony BEECH
Anthony BEECH Dawn FISCHER : University of Birmingham. Le Dr Dawn Fisher, chercheur principal honoraire du « Centre for Forensic and Criminological Psychology » de l’université de Birmingham , a reçu le Senior Practitioner Award pour son travail dans le domaine de la réinsertion des délinquants, en particulier avec les adultes et les jeunes ayant un comportement sexuellement inapproprié.
Dawn FISCHER : University of Birmingham. Le Dr Dawn Fisher, chercheur principal honoraire du « Centre for Forensic and Criminological Psychology » de l’université de Birmingham , a reçu le Senior Practitioner Award pour son travail dans le domaine de la réinsertion des délinquants, en particulier avec les adultes et les jeunes ayant un comportement sexuellement inapproprié.