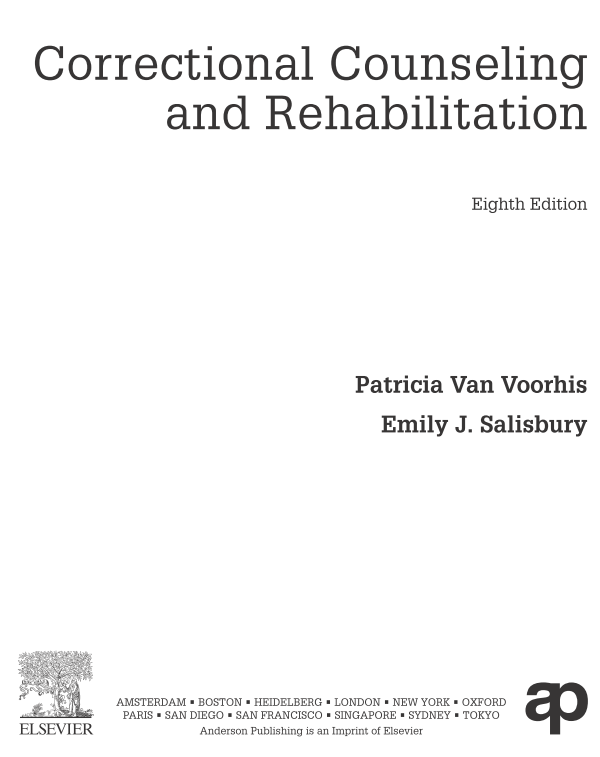Sur le sujet central de l’Alliance thérapeutique ou alliance de travail et son impact sur l’efficacité de la prise en charge, voici un extrait de l’ouvrage de Luc Isebaert, « Solution-Focused cognitive and systematic therapy ».
Effets des thérapeutes
Puisqu’aucune méthode de thérapie n’a le monopole de tous les bons thérapeutes, un autre facteur potentiellement commun est disponible pour expliquer le succès égal de méthodes manifestement différentes.
Saul Rosenzweig
Les facteurs liés au thérapeute représentent le montant de la variance attribuable non pas au modèle utilisé, mais plutôt à la personne du thérapeute. La variabilité entre les thérapeutes reste la règle plutôt que l’exception (Beutler et al., 2004). Traditionnellement, la plupart des recherches sur la variance des thérapeutes portent sur des variables discrètes telles que les compétences interpersonnelles, la sagacité, etc. Teyber et McClure (2000), cependant, affirment à juste titre qu’une telle focalisation peut détourner l’attention des influences les plus importantes du thérapeute, de l’intervention et de l’adaptation du client sur les résultats de thérapeutes spécifiques associés à des clients spécifiques. En effet, les facteurs liés au thérapeute sont apparus comme des aspects puissants et prédictifs des services thérapeutiques, qui expliquent une plus grande partie de la variance des résultats que tout autre traitement fourni, après ce que le client apporte. Wampold (2005) commente :
la variance des résultats due aux thérapeutes (8 à 9 %) est plus importante que la variabilité entre les traitements (0 à 1 %), l’alliance (5 %) et la supériorité d’une EST par rapport à un traitement placebo (0 à 4 %), ce qui en fait le prédicteur le plus robuste de tous les facteurs étudiés. (p. 204)
Selon l’étude, les estimations indiquent qu’entre 6 % (Crits-Christoph et al., 1991 ; Anker, Owen, Duncan, & Sparks, 2010 ; Wampold & Brown, 2005) et 9 % (Project MATCH Research Group, 1998) de la variance des résultats est attribuable aux effets du thérapeute. Si l’on met les choses en perspective, la variance attribuée aux facteurs liés au thérapeute est environ six à neuf fois plus importante que celle des différences de modèle ; ou, sur la variance attribuée au traitement (13 %), les facteurs liés au thérapeute représentent de 46 à 69 %. Dans le TDCRP (Treatment of Depression Collaborative Research Program), 8 % de la variance globale (ou 61 % de la variance attribuée au traitement) des résultats de chaque traitement était due aux thérapeutes (Kim, Wampold, & Bolt, 2006).
 Les psychiatres de l’étude soulignent cette constatation : Les patients recevant des pilules de sucre de la part du tiers supérieur des psychiatres les plus efficaces ont obtenu de meilleurs résultats que les patients prenant des antidépresseurs de la part du tiers inférieur des psychiatres les moins efficaces. Même pour les médicaments, la personne qui les administre est importante.
Les psychiatres de l’étude soulignent cette constatation : Les patients recevant des pilules de sucre de la part du tiers supérieur des psychiatres les plus efficaces ont obtenu de meilleurs résultats que les patients prenant des antidépresseurs de la part du tiers inférieur des psychiatres les moins efficaces. Même pour les médicaments, la personne qui les administre est importante.
Qu’est-ce qui explique cette variabilité ? Bien que nous sachions avec certitude que certains thérapeutes sont meilleurs que d’autres, il n’y a pas beaucoup de recherches sur ce qui distingue les meilleurs des autres, mais il y a une bonne possibilité et une évidence. Gassman et Grawe (2006) ont réalisé des analyses minute par minute de 120 séances impliquant 30 patients traités pour une série de troubles psychologiques. Ils ont constaté que les thérapeutes inefficaces se concentraient sur les problèmes en négligeant les points forts des personnes. Lorsque les thérapeutes inefficaces se sont concentrés sur les ressources des patients, ils l’ont fait plutôt à la fin d’une séance de thérapie. Les thérapeutes efficaces se concentrent sur les points forts de leurs patients dès le début. Ils ont immédiatement activé les ressources du client pour résoudre ses problèmes.
La chose la plus évidente est que ce que nous savons le mieux sur ce qui fait que certains thérapeutes sont meilleurs que d’autres est leur capacité à établir une bonne alliance entre les différentes présentations et personnalités des patients. Deux études récentes (Baldwin, Wampold et Imel, 2007 ; Anker et al., 2010) ont montré que les thérapeutes qui forment généralement de meilleures alliances obtiennent également de meilleurs résultats. Baldwin et autres (2007) ont dissipé le folklore commun en démontrant que les bonnes alliances étaient davantage fonction de ce que les thérapeutes apportaient sur la table que des patients : Les thérapeutes adeptes des alliances étaient capables de transcender le type de client, alors que d’autres thérapeutes moins efficaces ne l’étaient pas. En fait, Owen et ses collègues ont constaté que l’alliance expliquait tous les écarts entre les thérapeutes, après avoir pris en compte le sexe, la discipline et même l’expérience spécifique (avec la thérapie de couple). Ces résultats suggèrent que l’alliance représente peut-être le meilleur moyen d’influencer les effets des thérapeutes.
Ces deux domaines – ce que Gassman et Grawe ont appelé l’activation des ressources, et la conclusion d’alliances solides avec un plus grand nombre de clients – représentent probablement les meilleurs moyens de créer des résultats positifs, quelle que soit l’orientation du thérapeute. Une fois de plus, la SFCST (Solution-Focused Brief Therapy) semble avoir une longueur d’avance, comme le révélera un examen plus approfondi de l’alliance.
L’Alliance
Les observateurs semblent intuitivement percevoir les caractéristiques du bon thérapeute
et encore… parfois, être tellement impressionné qu’on en arrive presque à croire que la personnalité du thérapeute serait suffisante [c’est nous qui soulignons] en soi, en dehors de tout le reste, pour expliquer la guérison de nombreux patients par une sorte d’effet catalytique.
Saul Rosenzweig
La classe suivante de facteurs représente un large éventail de variables à médiation relationnelle que l’on retrouve dans les thérapies, quel que soit le référentiel théorique du thérapeute.
Les variables fournies par les thérapeutes, en particulier les critères de base popularisées par Rogers (1957), ont non seulement été soutenues empiriquement, mais sont également remarquablement cohérents dans les rétroactions des patients sur la réussite de la thérapie (Norcross & Lambert, 2005). Les chercheurs constatent régulièrement qu’une alliance positive – un partenariat interpersonnel entre la personne et le thérapeute pour atteindre les objectifs de la personne (Bordin, 1979) – est l’un des meilleurs prédicteurs du résultat (Horvath & Bedi, 2002 ; Horvath & Symonds, 1991 ; Martin, Garske, & Davis, 2000). La quantité de la variance attribuée à l’alliance varie de 5 à 7 % de la variance globale ou de 38 à 54% de la variance due au traitement. En termes simples, l’alliance représente cinq à sept fois le montant de la variance du résultat en tant que modèle et technique. Il existe plus de 1 000 résultats de processus-résultats qui soutiennent l’association entre une alliance forte et un résultat positif (Orlinsky et al., 2004).
Malgré cela, les détracteurs de l’alliance rejetteront cette dernière en affirmant que la recherche n’est que corrélationnelle. Cela revient à dire que fumer des cigarettes n’est que corrélé avec le cancer du poumon ! Ce qui est encore plus accablant, disent-ils, c’est que nous ne savons pas ce qui vient en premier, l’expérience d’une alliance forte ou le rapport d’un client sur le changement ou les avantages – la question classique de la poule ou de l’œuf. Notre récente étude sur les alliances de 500 patients (Anker, Owen, Duncan et Sparks, 2010) a directement abordé cette question. L’alliance a largement prédit les résultats, au-delà des changements substantiels intervenus au début, démontrant que l’alliance n’est pas simplement un artefact d’amélioration des patients, mais plutôt une force avec laquelle il faut compter en soi.
Enfin, Krupnick et ses collaborateurs (1996) ont analysé les données du TDCRP ((Treatment of Depression Collaborative Research Program) et ont constaté que si l’alliance, du point de vue du client, était prédictive de succès pour toutes les pathologies, le modèle de traitement ne l’était pas. Les scores moyens de l’alliance expliquaient jusqu’à 21% de la variance, tandis que les différences de traitement représentaient environ 0% de la variance des résultats (Wampold, 2001). Il faut garder à l’esprit que le traitement représente, en moyenne, 13 % de la variance. L’alliance dans le TDCRP explique davantage la variance en elle-même, ce qui illustre le fait que les pourcentages ne sont pas fixes et dépendent du contexte particulier du client, du thérapeute, de l’alliance et du modèle de traitement.
L’alliance telle que définie classiquement par Bordin (1979) comprend le lien relationnel entre le thérapeute et le client ainsi que leur accord sur les objectifs et la tâche de la thérapie. Bien qu’elle soit largement ignorée, il est un fait que l’alliance est notre allié le plus puissant et représente la plus grande influence que nous pouvons avoir sur les résultats. La SFCST ( Solution-Focused Cognitive and Systemic Therapy) attire par nature l’attention sur l’alliance de nombreuses façons. Cela peut être un défi pour tous les thérapeutes : L’alliance n’est pas sexy par rapport aux promesses de « thérapies miracles » et de « résultats à des années-lumière » qui imprègnent souvent le domaine thérapeutique.
Mais l’alliance n’est pas l’anesthésie avant l’opération – ce n’est pas ce que vous faites avant d’arriver à la vraie thérapie. Nous n’offrons pas de reflets rogeriens pour bercer les clients dans la complaisance afin de leur coller la véritable intervention ! L’alliance est probablement mieux conceptualisée comme un cadre global pour la psychothérapie ; elle transcende tout comportement spécifique du thérapeute et est une propriété de tous les aspects de la prestation de services (Hatcher & Barends, 2006). L’alliance est évidente dans tout ce que vous faites pour engager le client dans un travail intentionnel, depuis l’offre d’une explication ou d’une technique jusqu’à la prise du prochain rendez-vous. Vous devez mériter l’alliance ; elle ne vous est pas donnée. Vous devez vous mettre au service de chaque personne, de chaque interaction et de chaque séance. C’est une tâche ardue.
Un examen de la recherche (Norcross, 2010) dans la deuxième édition de The Heart and Soul of Change (Duncan et al., 2010) confirme ce que vous savez déjà. En ce qui concerne l’empathie, une méta-analyse de 47 études a révélé une taille d’effet (SE) de 0,32. Pour mettre cela en perspective, l’ES des différences de modèle et de technique n’est que de 0,20. La perception de l’empathie par votre client est donc plus puissante que toutes les techniques que vous pouvez utiliser. En ce qui concerne l’aspect positif, lorsque les clients évaluent les résultats, 88 % des études constatent une relation significative entre l’expérience d’un regard positif par le client et une conclusion réussie de la thérapie. Carl Rogers avait bien trouvé quelque chose !
La SFCST ( Solution-Focused Cognitive and Systemic Therapy) adopte des concepts relationnels tels que l’empathie et le regard positif par l’attention portée à la validation des clients ainsi qu’un effort concerté pour mettre en évidence ce qui va
chez les patients par opposition à ce qui ne va pas, de les considérer comme pleinement capables de résoudre tout problème. Cependant, là où les pratiques axées sur la recherche de solutions ont été les plus efficaces pour obtenir de bonnes alliances, c’est peut-être en s’efforçant de s’entendre avec le client sur les objectifs et les tâches de la thérapie – sur ce que vous allez travailler et comment vous allez le faire. Le fait de suivre avec ténacité les objectifs du client et d’extraire des solutions de son expérience garantit l’accord nécessaire sur les objectifs et les tâches de la thérapie.
D’une manière importante, l’alliance dépend de la prestation d’un traitement particulier : un cadre pour comprendre et résoudre le problème. D’une part, il ne peut y avoir d’alliance sans traitement. D’autre part, l’efficacité d’une technique dépend de son système de prestation : la relation client-thérapeute. Si la technique ne parvient pas à engager le client dans un travail intentionnel, elle ne fonctionne pas correctement et un changement est nécessaire. Si la recherche d’exceptions ou d’une perspective fondée sur les forces ne suscite pas la participation du client, par exemple, alors, aussi bonnes que soient ces idées, elles ne sont pas utiles avec ce client. C’est là que la diversité des modèles et des techniques s’avère payante.
Bien qu’il n’y ait pas de différence d’efficacité entre les approches en général, il y a une différence d’efficacité entre les approches avec le client dans votre bureau ici et maintenant . La question est la suivante : L’approche est-elle efficace ou non ? Son application aide-t-elle ou entrave-t-elle l’alliance? Est-ce quelque chose que vous et le client pouvez soutenir? Vos compétences en matière d’alliance sont véritablement en jeu ici – votre capacité interpersonnelle à explorer les idées du client, discuter des options, élaborer un plan en collaboration et négocier tout changement lorsque le client n’en tire pas profit. La technique, sa sélection et son application, en d’autres termes, sont des exemples de l’alliance en action. La question de la résonance et de l’accord sur les tâches – trouver un cadre de thérapie auquel vous et le client pouvez croire – est la raison pour laquelle il est très judicieux de demander aux clients leurs idées sur la manière de procéder, ou au moins d’obtenir leur approbation pour tout plan d’intervention. Traditionnellement, de tels processus n’ont pas été toujours constatées ; la recherche a porté sur des interventions qui favorisent le changement en validant la théorie privilégiée par le thérapeute. Pour servir l’alliance, il faut adopter un angle différent – la recherche d’idées qui favorisent le changement en validant le point de vue du client sur ce qui est utile – la théorie du changement du client (Duncan & Miller, 2000a ; Duncan & Moynihan, 1994 ; Duncan et al., 1992). Il n’est pas surprenant que Frank et Frank (1991) soient les mieux placés pour le dire : « Idéalement, les thérapeutes devraient choisir pour chaque patient, la thérapie qui correspond ou peut correspondre aux caractéristiques personnelles du patient et à sa vision du problème ».
Rappelons à nouveau le TDCRP (Treatment of Depression Collaborative Research Program). La perception qu’ont les clients d’un traitement qui correspond ou correspond à leurs croyances sur l’origine de leur dépression et sur ce qui serait utile (psychothérapie ou médicaments), a contribué à un engagement précoce, à la poursuite de la thérapie et au développement d’une alliance positive (Elkin et al., 1999).
« Que se passe-t-il si la personne reçoit d’abord un traitement contre la colère/l’agressivité tout en manifestant des comportements de dépendance ? Les possibilités sont les suivantes :



 Les psychiatres de l’étude soulignent cette constatation : Les patients recevant des pilules de sucre de la part du tiers supérieur des psychiatres les plus efficaces ont obtenu de meilleurs résultats que les patients prenant des antidépresseurs de la part du tiers inférieur des psychiatres les moins efficaces. Même pour les médicaments, la personne qui les administre est importante.
Les psychiatres de l’étude soulignent cette constatation : Les patients recevant des pilules de sucre de la part du tiers supérieur des psychiatres les plus efficaces ont obtenu de meilleurs résultats que les patients prenant des antidépresseurs de la part du tiers inférieur des psychiatres les moins efficaces. Même pour les médicaments, la personne qui les administre est importante.