Martine HERZOG EVANS vient sur son blog de publier une très instructive revue (in french!) de l’article Misalignment In Supervision:Implementing Risk/Needs Assessment Instruments in Probation (Criminal Justice and Behavior, 25 September 2014) .
 Risk and needs assessment (RNA) tools are well regarded as a critical component of a community corrections organization implementing evidence-based practices (EBPs), given the potential impact of using such tools on offender-level and system outcomes. The current study examines how probation officers (POs) use a validated RNA tool in two adult probation settings. Using interview and observational data, this study explores how POs use an assessment tool during all facets of their work from preplanning, routine administrative tasks, and face-to-face case management interactions with probation clients. Findings suggest POs overwhelmingly administer the RNA tool, but rarely link the RNA scores to key case management or supervision decisions. These findings highlight some of the challenges and complexities associated with the application of RNA tools in everyday practice. Study implications emphasize the need to modify current probation practices to create a synergy between the RNA and related supervision practices. Findings from this study contribute to a better appreciation for how the new penology integrates risk management with client-centered case models to improve outcomes.
Risk and needs assessment (RNA) tools are well regarded as a critical component of a community corrections organization implementing evidence-based practices (EBPs), given the potential impact of using such tools on offender-level and system outcomes. The current study examines how probation officers (POs) use a validated RNA tool in two adult probation settings. Using interview and observational data, this study explores how POs use an assessment tool during all facets of their work from preplanning, routine administrative tasks, and face-to-face case management interactions with probation clients. Findings suggest POs overwhelmingly administer the RNA tool, but rarely link the RNA scores to key case management or supervision decisions. These findings highlight some of the challenges and complexities associated with the application of RNA tools in everyday practice. Study implications emphasize the need to modify current probation practices to create a synergy between the RNA and related supervision practices. Findings from this study contribute to a better appreciation for how the new penology integrates risk management with client-centered case models to improve outcomes.
Cette recherche portait sur l’introduction en 2006 dans deux services de probation américains (un gros et un petit) d ’outils d’évaluation actuariels de quatrième génération, soient incluant l’évaluation du risque et des besoins, tout en liant cette évaluation à la planification du suivi. L’étude montre qu’en dépit d’une formation de qualité à l’utilisation de ces outils, en pratique, ceux-ci n’étaient nullement mobilisés.
Les pistes explicatives de ce décalage entre les objectifs et la formation, d’une part, et la réalité de terrain, d’autre part, étaient les suivantes – certaines de ces raisons étant particulièrement riches d’enseignement pour la France.
Certaines ne sont à mon sens pas transposables. L’une tenant à la culture du risque plutôt que de la réinsertion. Si certains auteurs ont pu considérer que l’on avait évolué dans la probation française vers une culture de ce type, l’on est en réalité très loin des représentations et pratiques américaines. Ainsi même si les pratiques et orientations institutionnelles et, sans doute, l’influence du type de recrutement ces dernières années a pu introduire la notion de risque – qui était largement absente auparavant – la culture des agents de probation est encore largement favorable à l’insertion et, à tout le moins, les agents de probation rejoignent massivement ce corps pour faire de l’insertion et interagir avec des condamnés, ce que nous confirment chaque année les petites études socio-démographiques de l’ENAP sur les CPIP (il est passionnant de retrouver exactement la même chose chez les JAP, comme l’a montré ma recherche récente : Le juge de l’application des peines. Monsieur Jourdain de la désistance, Paris, l’Harmattan, 2013).
Dans la droite ligne de ce particularisme américain, les auteurs soulignent que les agents de probation ne traitent pas de pensées pro-criminelles, etc. parce ce qu’ils ne pensent pas que les personnes peuvent réellement changer. En France, à mon sens nous pourrions nous heurter à un résultat similaire, à cette différence près que les agents de probation français croient certainement au changement. Leur résistance tiendrait plutôt à leur capacité à agir sur la cognition, faute de formation en techniques cognitives et comportementales et de connaissances en théorie des apprentissages sociaux.
Une seconde série de raisons sont totalement pertinentes pour nous.
1) Les agents ne croient pas à la pertinence de ces instruments – en dépit des nombreuses démonstrations scientifiques auxquelles ils ont été exposés – et préfèrent passer outre et imposer leur propre « flair » et analyse subjective. Ce risque est très présent en France. Restera à voir si les grandes évolutions annoncées dans la probation infléchiront les résistances et doutes.
2) Les agents américains ne sont pas suffisamment et correctement encadrés et supervisés sur le plan clinique, ce qui leur permet justement de faire finalement ce qu’ils veulent en dépit des orientations institutionnelles, lorsqu’ils se retrouvent en face à face avec les condamnés. Il est inutile de développer ce point, totalement transposable à la France. J’ai écrit à de multiples reprises qu’il était urgent de réfléchir au type d’encadrement dont nous avons besoin pour porter la modernisation de la probation. Il nous faut des leaders, qui connaissent sur le bout des doigt les techniques dont ils devront ensuite superviser sur le terrain et dans le concret qu’elles sont bien mises en place – pas en mode gendarme (un risque sérieux dans une institution très hiérarchisée), mais en mode tuteur méthodologique et technique. La révolution de la probation passe d’abord et avant tout par une révolution de l’encadrement.
3) Dans le même ordre d’idée, et crucial pour la France, c’est finalement le constat que la formation ne suffit absolument pas pour changer la pratique et qu’il faut ensuite sur le terrain un service après-vente de qualité, bien réel, remettre de la formation, du suivi, comme dans le programme STICS de Bonta et al. suscité (Canada). A défaut, c’est peine perdue. Saurons-nous relever ce défi et le porter financièrement et structurellement ?
4) Il faut aussi susciter l’envie et l’adhésion du terrain, dont nous avons vu supra qu’elle était défaillante aux Etats-Unis, et précisément les auteurs insistent aussi sur des expériences qu’ils ont eux-mêmes évaluées, en vertu desquelles des tiers extérieurs à l’institution ont assuré ce service après-vente (et le cas échéant la formation initiale) et qui ont donné en revanche d’excellents résultats. Clairement les agents de probation reçoivent avec moins de résistance des formations et un soutien logistique extérieur que lorsqu’il vient de leur institution. A méditer pour la France !
5) Enfin, les agents américains étaient dans la confusion quant aux politiques pénales menées et à la philosophie (pénologie) sous-jacente, puisqu’ils sont passés du tout carcéral hyper répressif au retour de la réinsertion, des programmes de sortie de prison, etc. Attention chez nous aussi, du fait des alternances politiques, à ne pas courir un risque similaire…
Retrouvez l’intégralité de l’article de MHE sur son blog



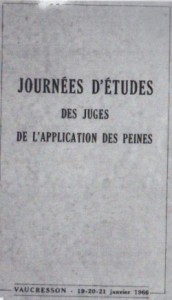
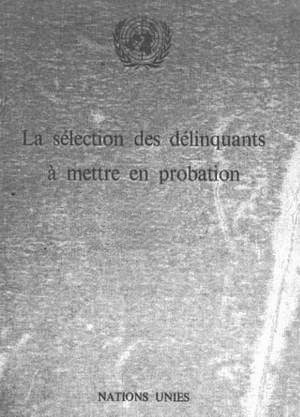
 Risk and needs assessment (RNA) tools are well regarded as a critical component of a community corrections organization implementing evidence-based practices (EBPs), given the potential impact of using such tools on offender-level and system outcomes. The current study examines how probation officers (POs) use a validated RNA tool in two adult probation settings. Using interview and observational data, this study explores how POs use an assessment tool during all facets of their work from preplanning, routine administrative tasks, and face-to-face case management interactions with probation clients. Findings suggest POs overwhelmingly administer the RNA tool, but rarely link the RNA scores to key case management or supervision decisions. These findings highlight some of the challenges and complexities associated with the application of RNA tools in everyday practice. Study implications emphasize the need to modify current probation practices to create a synergy between the RNA and related supervision practices. Findings from this study contribute to a better appreciation for how the new penology integrates risk management with client-centered case models to improve outcomes.
Risk and needs assessment (RNA) tools are well regarded as a critical component of a community corrections organization implementing evidence-based practices (EBPs), given the potential impact of using such tools on offender-level and system outcomes. The current study examines how probation officers (POs) use a validated RNA tool in two adult probation settings. Using interview and observational data, this study explores how POs use an assessment tool during all facets of their work from preplanning, routine administrative tasks, and face-to-face case management interactions with probation clients. Findings suggest POs overwhelmingly administer the RNA tool, but rarely link the RNA scores to key case management or supervision decisions. These findings highlight some of the challenges and complexities associated with the application of RNA tools in everyday practice. Study implications emphasize the need to modify current probation practices to create a synergy between the RNA and related supervision practices. Findings from this study contribute to a better appreciation for how the new penology integrates risk management with client-centered case models to improve outcomes.