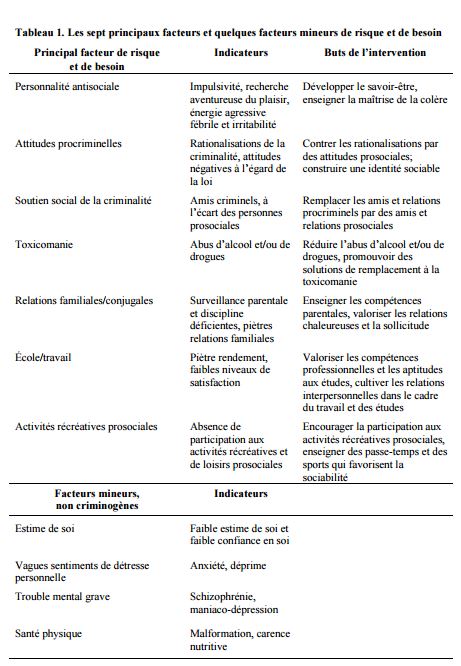Qu’est-ce que le mal ? Neuropsychiatres et psychologues se penchent sur cette question éternelle avec les méthodes d’investigation d’aujourd’hui.
Meurtres, crimes, viols, pourquoi certains individus engendrent le mal, parfois même sans éprouver aucun remords ? Manque d’empathie innée ou acquise ? Pourquoi certains groupes commettent des meurtres horribles dans différents conflits qui secouent l’Afrique ? Comment une thérapeute a pu être prise en otage puis violée par un patient dans un centre de détention de mineur ?
A travers différentes études et témoignages découvrez les mécanismes à l’origine de la cruauté.
Il y a quarante ans, le psychiatre américain Hervey Cleckley a réalisé la première étude de cas d’envergure sur des patients qui n’éprouvaient aucun remords au sujet des crimes qu’ils avaient commis. Cette absence d’empathie est-elle innée ou acquise ? Pour y répondre, le chercheur Gerhard Roth s’est intéressé à l’environnement de délinquants, montrant que celui-ci joue un grand rôle et peut altérer le cerveau dès le plus jeune âge. “Ces changements s’ancrent profondément entre l’âge de 4 et 7 ans, comme s’ils étaient d’origine génétique”, explique-t-il. Le neuropsychologue Thomas Elbert, lui, s’est penché sur les mécanismes qui poussent certains groupes à commettre des meurtres horribles dans différents conflits qui secouent l’Afrique et s’interroge sur le fonctionnement des enfants-soldats. Prise en otage et violée par un patient dans un centre de détention pour mineurs, une thérapeute témoigne et se demande pourquoi elle n’a pas su prévoir la réaction de ce jeune homme sur lequel elle avait écrit auparavant un rapport rassurant….


 The SEED (Skills for Effective Engagement, and Development) pilots were conducted between Spring 2011 and Spring 2012. Their purpose was to develop and test out a practice skills model based on the best international evidence about the impact of effective engagement with offenders on reducing reoffending. The model consists of core training followed by quarterly follow up training that teams of practitioners (offender managers) attend together with their team manager Senior Probation Officer (SPO), and continuous professional development (CPD) to support learning. The aim of the model is to bring about cultural change to enable professional practice and a focus on quality outcomes. SEED has now been brought together with a piloted model for reflective supervision to produce the SEEDS model (Skills for Effective Engagement, Development and Supervision). This is an integrated organisational and practice model intended to bring about the consistent application of evidence in day to day work with offenders. SEEDS is a non-mandatory approach that has been adopted by almost all probation trusts.
The SEED (Skills for Effective Engagement, and Development) pilots were conducted between Spring 2011 and Spring 2012. Their purpose was to develop and test out a practice skills model based on the best international evidence about the impact of effective engagement with offenders on reducing reoffending. The model consists of core training followed by quarterly follow up training that teams of practitioners (offender managers) attend together with their team manager Senior Probation Officer (SPO), and continuous professional development (CPD) to support learning. The aim of the model is to bring about cultural change to enable professional practice and a focus on quality outcomes. SEED has now been brought together with a piloted model for reflective supervision to produce the SEEDS model (Skills for Effective Engagement, Development and Supervision). This is an integrated organisational and practice model intended to bring about the consistent application of evidence in day to day work with offenders. SEEDS is a non-mandatory approach that has been adopted by almost all probation trusts. Vacheret Marion, Cousineau Marie-Marthe (2005)
Vacheret Marion, Cousineau Marie-Marthe (2005)