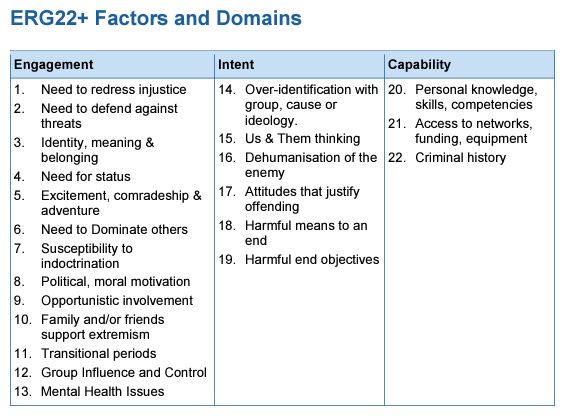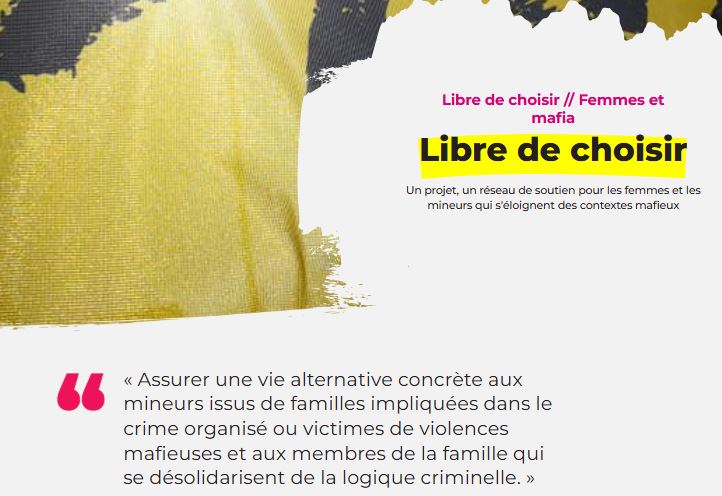 Depuis quelques années , à l’initiative du Tribunal pour mineurs de Reggio de Calabre , une action de coordination a été lancée entre les composantes institutionnelles et sociales qui s’occupent à divers titres de la protection des mineurs à travers le programme « Libre de choisir », qui consite principalement à éloigner les enfants des contextes mafieux et à les former à des métiers pour rompre avec les reseaux criminels.
Depuis quelques années , à l’initiative du Tribunal pour mineurs de Reggio de Calabre , une action de coordination a été lancée entre les composantes institutionnelles et sociales qui s’occupent à divers titres de la protection des mineurs à travers le programme « Libre de choisir », qui consite principalement à éloigner les enfants des contextes mafieux et à les former à des métiers pour rompre avec les reseaux criminels.
Le projet est né dans le but d’aider les jeunes qui vivent dans des contextes de criminalité organisée de nature mafieuse à se libérer de ces logiques qui lient les plus jeunes membres des familles mafieuses à un projet de vie criminel. Mais en même temps, cela s’est également révélé être une grande opportunité pour les adultes, en particulier les femmes et les mères , qui se trouvent dans une situation familiale et relationnelle mafieuse contre leur gré ou, après avoir payé leur dette à la société, croient que la mafia ne peut plus être le contexte dans lequel ils peuvent continuer à vivre et à élever leurs enfants.
Concrètement, il envisage la possibilité d’éloigner les mineurs de leur famille, et éventuellement la faisabilité d’assurer une véritable alternative aux membres de la famille qui se dissocient de la logique pénale, en prévoyant une relocalisation temporaire dans d’autres régions d’Italie. Au fil des années, nous avons suivi 49 situations – individuelles et familiales – soit plus de 120 personnes . Actuellement, nous accompagnons 24 situations de différentes manières : une cinquantaine de personnes, dont une dizaine de familles et quelques couples de frères et sœurs.
Il est né comme un protocole interministériel et voit la participation active de la société civile . Dans la dernière version du 31 juillet 2020, elle a été signée par : le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Éducation, le Ministère de l’Université et de la Recherche, la Présidence du Conseil des Ministres – Ministre de l’Égalité des Chances et de la Famille, la Direction Nationale Antimafia et Antiterroriste, la Conférence Épiscopale Italienne, le Tribunal pour Mineurs de Reggio de Calabre, le Parquet près le Tribunal pour Mineurs de Reggio de Calabre, le Parquet près le Tribunal de Reggio de Calabre, Libera. Associations, noms et chiffres contre la mafia. Le Protocole était, en plus d’une grande œuvre, aussi la légitimation formelle d’une action de grande responsabilité civile qui avait déjà été menée depuis un certain temps. Depuis des années, les mêmes personnes qui font partie des réalités institutionnelles demandent l’aide de notre Association, pour certaines situations délicates de sécurité personnelle, qui concernent des mineurs ou des adultes. Souvent nous nous sommes retrouvés, et nous nous trouvons, dans l’urgence d’aider une personne ou une cellule familiale, à changer d’environnement parce que leur maison, leur ville ne sont plus des endroits sécuritaires. Il est important de prendre en compte qu’actuellement les personnes, mineures ou majeures, même si elles souhaitent se dissocier en s’éloignant du milieu criminel d’origine, ne peuvent pas être adéquatement protégées par l’État car elles n’appartiennent pas à la figure juridique, actuellement prévue, du « collaborateur de justice » ou du « témoin de justice ».
Retirés simultanément de leur territoire et de leurs contextes familiaux respectifs, ces enfants ont l’opportunité de découvrir des horizons culturels, sociaux, affectifs et psychologiques différents, enrichissant leur vie d’expériences caractérisées par une saine et grande vitalité. En même temps, ce projet permet aux travailleurs de la justice pour mineurs, aux travailleurs sociaux, aux psychologues, aux familles d’accueil et aux communautés de travailler libres des pressions environnementales du contexte d’origine. Le but du projet n’est pas d’endoctriner , mais simplement de démontrer à ces enfants , pendant un certain temps, qu’en dehors des espaces clos de leurs maisons, il existe un autre monde, une alternative au style de vie qu’ils ont connu jusqu’à ce moment-là … On ne leur demande pas de renier leurs pères et mères, mais de s’offrir l’opportunité de se poser la question : « Est-ce que je veux vraiment l’avenir – cet avenir criminel – que ma famille a déjà choisi pour moi ? ». La thèse sur laquelle nous partons est en effet que parmi ces sujets criminels, nous sommes certains que beaucoup, s’ils avaient vécu des contextes différents, auraient exercé leur liberté de choix de manière plus décisive : en choisissant des actions alternatives à celles criminelles. Ce n’est pas un chemin sans difficultés, cependant, le soin apporté à chaque parcours individuel, l’absence d’automatismes et de froideur bureaucratique, rendus possibles à de nombreuses reprises par une bonne collaboration entre les institutions et la société civile, conduisent également à des résultats inattendus.
Contraste efficace avec la culture mafieuse. Free to Choose s’est immédiatement révélé être un outil puissant pour combattre la culture mafieuse : dès les premiers instants, les mères des garçons, épouses de chefs de la mafia, ont compris que ce que le Projet offrait était une réelle opportunité tant pour leurs enfants que pour elles-mêmes. Ainsi naît un chapitre inattendu et conséquent, où l’on sent que l’adhésion des femmes mafieuses à ce Projet, en plus de les conduire à écrire des pages de vie nouvelle dans leurs histoires personnelles, conduit à saper cette réalité familiale monolithique qui constitue l’un des points forts de la culture mafieuse.
Rôle de la société civile. Les institutions publiques, y compris judiciaires, malgré de nombreuses limitations dues à des pratiques difficiles à saper, sont invitées à mettre en jeu, dans ce projet, les conditions nécessaires et indispensables pour qu’un jeune puisse expérimenter une possibilité différente de regarder et de repenser sa propre vie. Mais nous avons constaté que la différence, pour un résultat positif, se fait par l’implication de la société civile , des « gens ordinaires » qui dans la vie de tous les jours nous font percevoir qu’il est possible de recommencer, qui partagent les nombreuses peurs et les joies des petits pas vers une plus grande autonomie de pensée et de choix. Des présences amicales qui partagent les difficultés de l’école ou du premier emploi , la présence d’associations ou de groupes de personnes disposés à accompagner avec empathie et humanité ces chemins de nouveaux départs, des présences amicales qui sont cruciales pour que les enfants et les adultes impliqués dans le Projet puissent puiser dans ces ressources d’humanité et de liberté qui sont restées longtemps cachées en eux-mêmes.
Nouvelles perspectives. Offrir la possibilité, aux personnes conditionnées par la culture criminelle mafieuse, de choisir de changer ou non leur vie : c’est un projet qui pour nous a un rêve implicite, que les Institutions, la Société Civile et nos propres communautés demandent la disponibilité concrète pour favoriser l’avenir d’un nouveau pays. Construire ensemble un pays où les Institutions et la Société Civile, chacune selon ses responsabilités, offrent une alternative concrète et efficace pour que les garçons et les filles puissent choisir, loin du conditionnement criminel, en regardant avec espoir l’avenir de leur vie. Tout cela signifie éliminer la motivation qui pousse souvent de nombreux jeunes à commettre des délits, parce qu’on ne leur a pas présenté d’alternatives concrètes.