Il existe un dépeçage pathologique qui chosifie le corps. C’est par exemple le cas d’un schizophrène qui mutile un cadavre parce qu’il est persuadé qu’il recèle le mal. Le criminologue Olivier Chevrier a rencontré un homme qui a tué sa mère pour lui ouvrir le ventre où il était persuadé que le diable se cachait. D’autres mutilations de cadavres sont propres aux tueurs en série, qui ne sont pas malades mais organisés. La mutilation est en quelque sorte leur signature.Joseph Vacher, un des premiers tueurs en série français reconnu, a tué onze adolescents, filles et garçons, dont il coupait les organes génitaux. Le tueur en série organisé peut agir par rapport à un fantasme qui le domine.
Selon les experts du FBI, les auteurs de meurtres en série gardent souvent des objets, et même parfois des membres. Il s’agit la plupart du temps de membres sexuels comme un téton ou un sein, ou encore une oreille ou un doigt. Ces objets sont pris comme souvenirs, et permettent au criminel de revivre les événements dans ses fantasmes. Dans certains cas, le meurtrier peut même consommer certaines parties du corps de sa victime pour se l’approprier totalement.
Des causes extérieures peuvent-elles expliquer cette pratique? C’est ce qu’affirment certains coupables, comme Sylvie Reviriego. Cette femme a tué son amie, lui a coupé la tête avant de la passer au four à micro-ondes puis, pendant une semaine, a dépecé peu à peu son cadavre resté sur le balcon. Sylvie Reviriego était soignée pour des problèmes psychiatriques, et elle aurait commis ce crime sous l’influence d’un cocktail de médicaments.
Remerciement à Olivier Chevrier, titulaire d’un DEA et d’un doctorat en sciences criminelles, intervenant à l’Université de Rennes 2 et à l’École de l’administration pénitentiaire d’Agen. «Crimes ou folie: un cas de tueur en série au XIXe siècle, Joseph Vacher», Olivier Chevrier, ed. L’Harmattan, 2006.
Lire l’article complet sur slate.fr



 La criminologie clinique « consiste essentiellement dans l’approche multidisciplinaire du cas individuel, à l’aide des principes et des méthodes des sciences criminologiques ou criminologies spécialisées » . Elle a pour but « par analogie avec la clinique médicale, de formuler un avis sur un délinquant, cet avis comportant un diagnostic, un pronostic et éventuellement un traitement »
La criminologie clinique « consiste essentiellement dans l’approche multidisciplinaire du cas individuel, à l’aide des principes et des méthodes des sciences criminologiques ou criminologies spécialisées » . Elle a pour but « par analogie avec la clinique médicale, de formuler un avis sur un délinquant, cet avis comportant un diagnostic, un pronostic et éventuellement un traitement »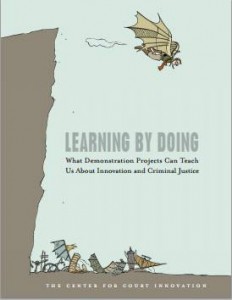 « Learning by doing », What Demonstration Projects Can Teach Us About Innovation and Criminal Justice
« Learning by doing », What Demonstration Projects Can Teach Us About Innovation and Criminal Justice