 Le VRAG-R est conçu pour évaluer la probabilité de récidive violente ou sexuelle chez les délinquants de sexe masculin. L’ensemble des données comprend des informations démographiques, criminelles, psychologiques et psychiatriques sur les délinquants, recueillies dans les dossiers des institutions, ainsi que des informations sur la récidive après la libération. Le VRAG-R est un instrument actuariel à douze items et les scores obtenus à ces items font partie de l’ensemble de données.
Le VRAG-R est conçu pour évaluer la probabilité de récidive violente ou sexuelle chez les délinquants de sexe masculin. L’ensemble des données comprend des informations démographiques, criminelles, psychologiques et psychiatriques sur les délinquants, recueillies dans les dossiers des institutions, ainsi que des informations sur la récidive après la libération. Le VRAG-R est un instrument actuariel à douze items et les scores obtenus à ces items font partie de l’ensemble de données.
Le Violence Risk Appraisal Guide-Revised (VRAG-R) est la mise à jour de l’outil actuariel d’évaluation du risque de violence le plus utilisé au monde. Conçu pour estimer la probabilité qu’un délinquant ou un patient de psychiatrie légale commette une nouvelle infraction violente ou sexuelle, le VRAG-R produit une estimation du taux de récidive pour différentes durées de suivi. Des études de réplication ont établi la capacité de la VRAG à prédire avec précision la récidive violente dans une variété de contextes ainsi que chez les agresseurs d’enfants, les violeurs et les délinquants non violents.
Il existe son pendant pour l’évaluation des risque de récidive violente chez les délinquants sexuels: la SORAG (Sex Offenders Risk Appraisal Guide, Quinsey, Rice, & Harris, 1995)
La VRAG est un outil actuariel développé à partir d’une population de personnes détenues hospitalisées dans un établissement de haute sécurité. La VRAG est utilisée pour évaluer le risque de récidive de violence et le risque de récidive générale chez des personnes atteintes de troubles mentaux. L’instrument a été traduit et validé en français (Pham, Ducro, Marghem, Reveillère, 2005) et présente une bonne capacité prédictive en matière de violence.
Une formation est nécessaire et impérative à son utilisation:
A noter que la VRAG est le résultat de recherches appliquées débutées il y a 45 ans (Premières études de l’équipe en 1971, Premières études de validations en 1975 avec la VRAG, Premières études sur le jugement Clinique en 1979)
Pour en savoir plus:
Ducro, C., & Pham, T. H. (2022). Convergent, discriminant and predictive validity of two instruments to assess recidivism risk among released individuals who have sexually offended: The SORAG and the VRAG-R. International Journal of Risk and Recovery, 5(1), 14–28
« L’évaluation du risque de récidive joue un rôle essentiel dans le système de justice pénale depuis de nombreuses années. Divers outils d’évaluation du risque ont été développés et recalibrés au fil des ans à cette fin. Deux de ces instruments, le Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) et le Sex Offender Risk Appraisal Guide (SORAG), ont tous deux été révisés avant d’être combinés dans le VRAG-R. Le but de notre étude était d’évaluer la validité convergente, discriminante et prédictive du SORAG et du VRAG-R dans une cohorte de 294 personnes libérées ayant commis des délits sexuels en Belgique française. Les résultats suggèrent que les outils ont une bonne validité convergente et la capacité de discriminer le niveau de risque des individus ayant commis des délits sexuels sur des victimes de moins de 14 ans, qu’ils soient intra- ou extra-familiaux, de celui d’autres individus à plus haut risque de récidive. En ce qui concerne la validité prédictive, les scores des deux instruments permettent de prédire la récidive non violente et non sexuelle avec un effet important, et la récidive générale (tout type de récidive) et la récidive violente et non sexuelle avec un effet moyen. La récidive sexuelle n’est pas prédite à un niveau statistiquement significatif par le SORAG ou le VRAG-R. La récidive violente (sexuelle et non sexuelle combinée) est modérément prédite par le SORAG et le VRAG. Toutefois, ces qualités prédictives varient en fonction de l’âge de la victime. Certaines combinaisons d’items peuvent être de bons prédicteurs. A cet égard, les items VRAG-R « manquement à l’obligation de libération conditionnelle » et « état civil » constituent ensemble un modèle prédictif de la récidive générale et de la récidive sexuelle. L’ajout de l’item « âge au moment de l’infraction indexée » améliore ce modèle pour la récidive générale ».
https://www.forensicpsychiatryinstitute.com/wp-content/uploads/2022/09/SORAG-and-the-VRAG-R.pdf
La feuille de codage (template created by Melanie Dougherty, School Psychologist and Licensed Behavior Analyst, New York State Office for People with Developmental Disabilities):
RAPPEL: Tous les outils d’évaluation requièrent une formation pour les utiliser.



 La violence domestique est-elle courante ?
La violence domestique est-elle courante ?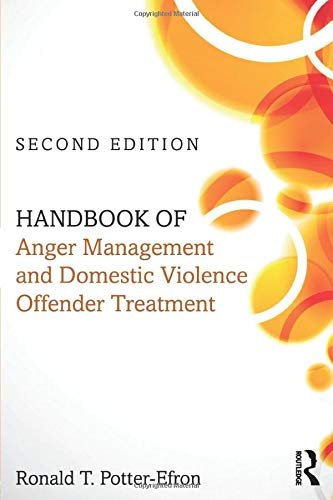 Relation entre la colère et la violence domestique
Relation entre la colère et la violence domestique