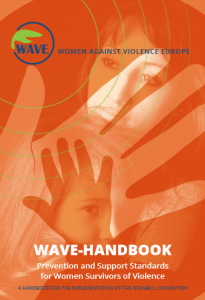 Liste des facteurs de risque de violence domestique: Manuel PROTECT (WAVE 2011)
Liste des facteurs de risque de violence domestique: Manuel PROTECT (WAVE 2011)
La liste suivante de facteurs de risque a été compilée à partir de recherches et de l’expérience des praticiens de la violence domestique.
Elle fournit un cadre pour recueillir plus systématiquement des informations sur les facteurs de risque et pour aider à identifier les risques et les éventuelles mesures de sécurité appropriées.
Pour les sources et une comparaison des différents instruments d’évaluation des risques, ainsi que les recherches et les preuves concernant les facteurs de risque respectifs, veuillez consulter le manuel PROTECT (WAVE 2011).
| Facteur de RISQUE | Catégorie de risque | |
| I. Antécédents de violence | ||
| 1 | Violence domestique antérieure à l’égard des femmes | Dans toutes les études sur les facteurs de risque de violence domestique à l’égard des femmes, la violence domestique antérieure s’avère être le facteur de risque le plus commun. |
| 2 | Violence envers les enfants ou d’autres membres de la famille | La violence fréquente au sein du foyer s’étendra aux autres membres de la famille, y compris les enfants. Les préoccupations initiales concernant la sécurité d’un enfant peuvent révéler des schémas de violence bien plus étendus au sein d’une famille. Les enfants peuvent également être utilisés par l’agresseur pour manipuler et contrôler émotionnellement la survivante. (Modèle Duluth de la violence domestique). |
| 3 | Comportement généralement violent | Les auteurs de violence domestique ont souvent des attitudes et des comportements antisociaux et recourent à la violence en dehors de la sphère familiale. Le recours à la violence en dehors de la famille indique une tendance générale à la violence, peut augmenter le risque pour la femme survivante et pose un risque pour les autres personnes, y compris les praticiens. |
| 4 | Violation des ordonnances de protection | La violation des ordonnances de protection (par la police, les tribunaux pénaux ou civils) et des ordonnances de contact ou de non-contact sont associées à un risque accru de violence future. |
| II. Formes et caractéristiques de la violence | ||
| 5 | Gravité et fréquence des actes de violence | L’augmentation de la gravité et de la fréquence des actes de violence est l’un des facteurs de risque les plus significatifs d’agressions graves et potentiellement mortelles. |
| 6 | Utilisation/menaces d’utilisation d’armes | L’utilisation effective d’armes ou les menaces d’utilisation d’armes constituent un facteur de risque important de violence grave et potentiellement mortelle. Dans les cas de violence domestique, toutes les armes, y compris les armes à feu, les couteaux et tout objet dangereux pouvant être utilisé pour blesser la victime, doivent être prises en compte dans l’évaluation des risques. |
| 7 | Comportement de contrôle et isolement | Le comportement de contrôle est considéré comme un facteur de risque important de violence grave et potentiellement mortelle répétée. L’isolement est une stratégie courante de contrôle et peut prendre des formes graves comme la privation de liberté (enfermer les femmes). |
| 8 | Le harcèlement criminel | Le harcèlement criminel est lié à la violence mortelle et grave contre les femmes, et lorsqu’il est associé à une agression physique, il est significativement associé au meurtre et à la tentative de meurtre. |
| 9 | Violence sexuelle | La violence sexuelle est souvent vécue comme faisant partie de la violence domestique à l’égard des femmes. Les femmes qui sont agressées sexuellement sont plus susceptibles de subir des blessures plus graves et des violences domestiques plus importantes. |
| 10 | Menaces de mort, menaces de préjudice, coercition | L’expérience pratique a montré que les violences graves sont souvent précédées de menaces. La coercition peut prendre différentes formes graves, dont le mariage forcé. |
| 11 | Strangulation et étouffement | La strangulation et l’étouffement sont des formes de violence très dangereuses ; environ la moitié des victimes d’homicide ont été confrontées à une tentative de strangulation dans l’année précédant leur décès. |
| III. Facteurs de risque liés au comportement de l’auteur | ||
| 12 | Problèmes liés à l’abus de drogues et d’alcool | Bien que l’abus de drogues et d’alcool ne soit pas une cause ou une excuse à la violence domestique à l’égard des femmes, l’abus d’alcool et de drogues d’un auteur est associé à un risque accru d’homicide et de violence plus grave. |
| 13 | Possession, jalousie extrême et autres formes d’attitudes nuisibles | La jalousie extrême et la possessivité sont associées à une violence grave. En outre, les attitudes patriarcales de l’auteur, telles que des concepts très rigides de l’honneur masculin ou familial et un sentiment de propriété sur les femmes, peuvent augmenter le risque. |
| 14 | Les problèmes liés à une mauvaise santé mentale, y compris menaces et tentatives de suicide | Les problèmes de santé mentale de l’auteur des violences, y compris la dépression, sont associés à un risque accru de violence répétée et grave. Les menaces de suicide et la mauvaise santé mentale de l’auteur sont des facteurs de risque dans les cas d’homicide-suicide. Dans 32% des cas de féminicide/homicide, l’auteur s’est suicidé par la suite. |
| 15 | Stress économique | Les changements dans la situation financière de l’auteur et le chômage sont des facteurs de risque importants dans les cas d’homicides liés à la violence domestique et sont liés aux concepts de masculinité et de rôles de genre. |
| IV. La perception du risque par la survivante | ||
| 16 | Peur pour elle-même et pour les autres | Les recherches montrent qu’il existe une forte corrélation entre l’auto-évaluation du risque par la survivante et le recours effectif à la violence par l’auteur. Cependant, certaines victimes de violence peuvent également minimiser et sous-estimer la violence. Dans une étude sur le féminicide menée par Campbell et al (2003), environ la moitié des survivants ne percevaient pas qu’il y avait un risque que l’agresseur les tue. |
| V. Facteurs aggravants | ||
| 17 | Séparation | La séparation est communément considérée comme un facteur de risque significatif de préjudice grave ou d’homicide. |
| 18 | Contact avec l’enfant | Les conflits relatifs au contact avec l’enfant sont fréquents après la séparation et représentent souvent un risque de violence répétée pour les femmes et les enfants. |
| 19 | Beau-fils ou belle-fille vivant dans la famille | Les facteurs de risque de la violence du partenaire intime incluent tout beau-fils ou belle-fille de l’auteur vivant dans le foyer. |
| 20 | Violence pendant la grossesse | Environ 30 % des violences domestiques commencent pendant la grossesse. La violence pendant la grossesse est un facteur de risque de violence grave et mortelle. Les femmes enceintes courent un plus grand risque de violence mineure et grave que les femmes non enceintes. |


 Ce projet représente un programme de réadaptation qui pourrait être utilisé avec des délinquants juvéniles ou des jeunes à risque. L’un des objectifs des personnes travaillant avec des jeunes délinquants est de les voir se réhabiliter et mener une vie productive. Il existe un certain nombre de programmes de réadaptation des délinquants, mais peu d’entre eux tentent de développer un sentiment d’empathie chez le jeune délinquant. Ce programme de 16 séances a été élaboré et révisé après qu’un projet pilote ait été mené avec un groupe de délinquants au Newfoundland and Labrador Youth Center. Les résidents et un co-facilitateur ont apporté des commentaires critiques qui ont été incorporés dans ce programme. Le programme reflète la conviction que si les jeunes délinquants reconnaissent la douleur et la souffrance qu’ils ont causées aux autres, ils sont moins susceptibles de récidiver. Le projet tente d’enseigner la signification des termes « victime », « empathie envers la victime » et « victimisation », et demande aux participants d’appliquer ces connaissances à des situations courantes de victimisation.
Ce projet représente un programme de réadaptation qui pourrait être utilisé avec des délinquants juvéniles ou des jeunes à risque. L’un des objectifs des personnes travaillant avec des jeunes délinquants est de les voir se réhabiliter et mener une vie productive. Il existe un certain nombre de programmes de réadaptation des délinquants, mais peu d’entre eux tentent de développer un sentiment d’empathie chez le jeune délinquant. Ce programme de 16 séances a été élaboré et révisé après qu’un projet pilote ait été mené avec un groupe de délinquants au Newfoundland and Labrador Youth Center. Les résidents et un co-facilitateur ont apporté des commentaires critiques qui ont été incorporés dans ce programme. Le programme reflète la conviction que si les jeunes délinquants reconnaissent la douleur et la souffrance qu’ils ont causées aux autres, ils sont moins susceptibles de récidiver. Le projet tente d’enseigner la signification des termes « victime », « empathie envers la victime » et « victimisation », et demande aux participants d’appliquer ces connaissances à des situations courantes de victimisation.
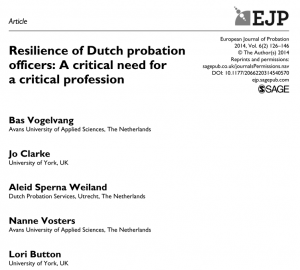
 Les affaires de rixes récurrentes à Paris ou en banlieue relancent régulièrement la peur des bandes de jeunes que l’on perçoit souvent comme de plus en plus violentes et de plus en plus nombreuses. Or, au-delà du flou qui entoure la notion de bande, quand on regarde ça de plus près, c’est presque le contraire : les bandes de jeunes il y en a toujours eu et si elles ressemblent beaucoup aux bandes de jeunes d’aujourd’hui, leur violence autrefois était sans commune mesure. Mais ce qui est intéressant c’est de mesurer la peur qu’elles suscitent, une peur qui dit beaucoup sur la place que les sociétés laissent à la jeunesse et sur le regard qu’elles portent sur elle.
Les affaires de rixes récurrentes à Paris ou en banlieue relancent régulièrement la peur des bandes de jeunes que l’on perçoit souvent comme de plus en plus violentes et de plus en plus nombreuses. Or, au-delà du flou qui entoure la notion de bande, quand on regarde ça de plus près, c’est presque le contraire : les bandes de jeunes il y en a toujours eu et si elles ressemblent beaucoup aux bandes de jeunes d’aujourd’hui, leur violence autrefois était sans commune mesure. Mais ce qui est intéressant c’est de mesurer la peur qu’elles suscitent, une peur qui dit beaucoup sur la place que les sociétés laissent à la jeunesse et sur le regard qu’elles portent sur elle.