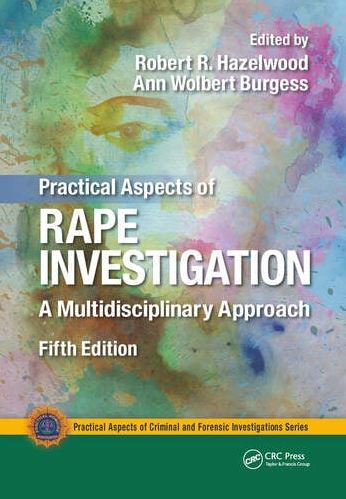Inventaire de l’hypermasculinité (y compris les attitudes sexuelles ; Mosher & Sirkin, 1984) & Évaluation de déficits de l’intimité/ problèmes socio-affectifs/ distorsions cognitives
 Hypermasculinity Inventory-Revised
Hypermasculinity Inventory-Revised
Pour chaque proposition, entourez le chiffre de la réponse qui cous correspond le plus en général sur une échelle de 1 à 10.
1) Après avoir vécu une expérience très dangereuse.
mes genoux faiblissent et je tremble de tous mes membres. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. J’ai l’impression de planer.
2) Je préfère
Parier plutôt que ne prendre aucun risque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ne prendre aucun risque plutôt que parier
3) Engueule moi et
Je ferai semblant de ne pas t’entendre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. je te répondrai pareil
4). En amour et en guerre
il faut toujours respecter les règles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . t 10. tout est permis.
5). Quand je vais à des fêtes
J’aime les fêtes sauvages et sans tabou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. J’aime les fêtes tranquilles avec de bonnes conversations
6). Certaines personnes m’ont dit que
Je prends des risques insensés. 1 2 3 4 5 6 7 810. 9 10. Je devrais prendre plus de risques.
7). Les hommes dits efféminés
sont plus artistiques et sensibles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. méritent d’être ridiculisés.
8). Utiliser des drogues ou de l’alcool pour « encourager » une femme à avoir des relations sexuelles avec
vous est
grossier et injuste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. OK si vous pouvez vous en sortir
9). j’aime
les voitures rapides et les histoires d’amour rapides. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. les voitures fiables et les amants fidèles
10). Les soi-disant « allumeuses »
devraient être pardonnés. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. devraient être violés.
11). Quand j’ai bu quelques verres
je me détends. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. je cherche les ennuis.
12). Tout homme qui est un homme
a besoin d’avoir des relations sexuelles régulières. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. peut se passer de relations sexuelles.
13) Quand je bois un verre ou deux
je me sens prêt à faire face à tout ce qui peut arriver. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. j’aime me détendre et m’amuser.
14). Quand il s’agit de prendre des risques
j’aime jouer la carte de la sécurité. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Je suis un flambeur.
15). Dans les conflits avec les autres
Je gagne en ne me battant pas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Je me bats pour gagner.
16). Se battre
est naturel pour moi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ne résout jamais un problème.
17) . Quand j’ai envie de me battre,
J’essaie de trouver des solutions de rechange. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. J’y vais
18) . Compte tenu de ce que je sais de la lutte,
c’est tout simplement stupide. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Celui qui le peut se bat, celui qui
ne peut pas se battre s’enfuit.
19) . Quand je m’ennuie
1. je regarde la télé ou je lis un livre 2 3 4 5 6 7 8 9 10. je cherche à m’amuser.
20) j’aime
conduire prudemment, en évitant tout risque inutile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. conduire vite, au bord du danger
21) Les filles qui draguent devraient
s’attendre à se faire embarquer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. choisir leurs hommes avec soin
22) . A mon avis
certaines femmes ne sont bonnes qu’à une seule chose. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. toutes les femmes méritent le même respect que les hommes
23) . Quand il s’agit de faire l’amour
je ne veux avoir des relations sexuelles qu’avec quelqu’un qui est tout à fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. je ne me sens jamais mal par rapport à mes tactiques lorsque j’ai des relations sexuelles
24) Je préférerais être un
un scientifique célèbre. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. un catcheur célèbre
25) Les lesbiennes ont un style de vie particulier
et devraient être respectées pour cela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. mais elles ont juste besoin d’une bonne bite bien raide
26) Si quelqu’un vous met au défi de vous battre,
il n’y a pas d’autre choix que de se battre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. il est temps de parler pour s’en sortir
27) Si tu m’insulte,
prépare-toi à assumer ce que tu dis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. J’essaierai de tendre l’autre joue
Hypermasculinity Inventory-Revised_FR