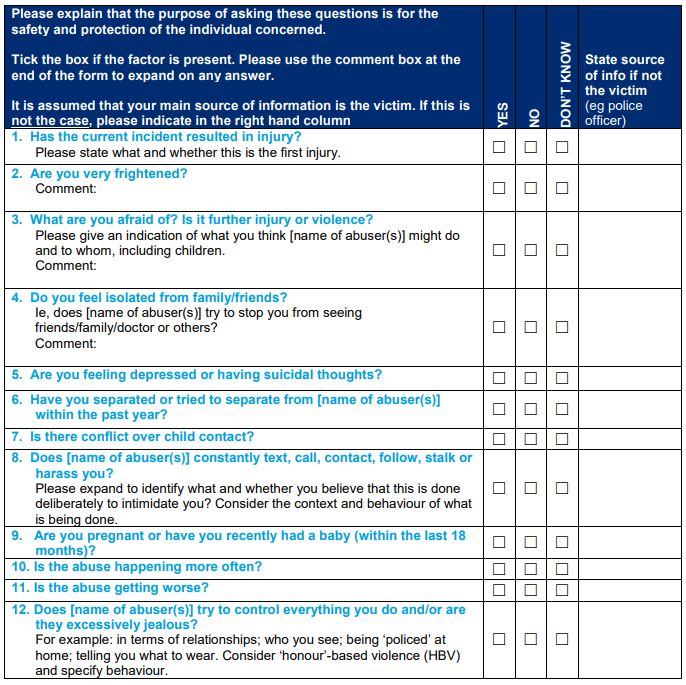Le rapport de l’OSCE, publié en décembre 2023, explore le rôle des femmes dans le crime organisé à travers des données et des études de cas dans plusieurs États participants. Il met en lumière leur implication dans divers marchés criminels, comme les crimes économiques et la traite des êtres humains, et souligne l’importance de reconnaître leur agence pour mieux lutter contre ce phénomène.
Le rapport de l’OSCE, publié en décembre 2023, explore le rôle des femmes dans le crime organisé à travers des données et des études de cas dans plusieurs États participants. Il met en lumière leur implication dans divers marchés criminels, comme les crimes économiques et la traite des êtres humains, et souligne l’importance de reconnaître leur agence pour mieux lutter contre ce phénomène.|
Année
|
Crime financier OC
|
Drogues illicites
|
Trafic de migrants
|
Traite des êtres humains
|
|---|---|---|---|---|
|
2018
|
15%
|
14%
|
11%
|
47%
|
|
2019
|
0%
|
16%
|
19%
|
14%
|
|
2020
|
17%
|
11%
|
9%
|
9%
|
|
2021
|
5%
|
15%
|
25%
|
12%
|
Pourcentage de femmes arrêtées pour drogues illicites et traite des êtres humains en Finlande (2018–2021)
|
Année
|
Drogues illicites
|
Traite des êtres humains
|
|---|---|---|
|
2018
|
18%
|
33%
|
|
2019
|
19%
|
33%
|
|
2020
|
15%
|
67%
|
|
2021
|
50%
|
17%
|
Ces tableaux illustrent la variabilité des taux d’arrestation selon les pays et les types de crimes, avec des pics notables, comme 47 % des arrestations pour traite des êtres humains en Belgique en 2018, ou 67 % en Finlande en 2020.
- Les femmes sont impliquées dans tous les marchés du crime organisé, avec une moyenne de 20 % des arrestations (plage de 11 % à 31 %) dans 9 États participants, notamment dans les crimes économiques et la traite des êtres humains.
- Le genre est rarement pris en compte dans les politiques ou les opérations policières, bien que les organisations de la société civile (OSC) y prêtent plus d’attention.
- Contrairement aux stéréotypes, les femmes peuvent utiliser ou ordonner la violence, comme en témoigne une augmentation de 21 % des agressions dans les prisons pour femmes au Royaume-Uni en 2022 par rapport à 2021.
- Les femmes exercent une agence à tous les niveaux de la hiérarchie du crime organisé (leaders, gestionnaires, soldats de base, facilitateurs), souvent via des liens familiaux ou sentimentaux, transmettant la culture et l’idéologie du crime organisé.
- Il existe un chevauchement entre victimes et auteurs, avec des transitions fréquentes, par exemple dans les cas de « county lines » (réseaux de distribution de drogue) et de traite.
- Les voies de recrutement diffèrent selon le genre : les femmes entrent souvent par la famille ou les relations, tandis que les hommes le font via le contexte social ; des facteurs socio-économiques comme la pauvreté affectent les deux.
Recommandations et actions proposées
Le rapport propose six recommandations principales, chacune accompagnée d’actions spécifiques, comme détaillé ci-dessous :
Recommandations et actions du rapport OSCE
|
Recommandation
|
Actions
|
|---|---|
|
Augmenter la sensibilisation sur le rôle des femmes dans le crime organisé
|
– Développer des matériaux de sensibilisation sensibles au genre, abordant les biais, dynamiques et avantages.
– Mettre en œuvre des activités de sensibilisation pour les praticiens sur l’agence des femmes dans les marchés et la hiérarchie.
|
|
Améliorer la justice pénale sensible au genre
|
– Développer des matériaux de formation pour identifier, enquêter et poursuivre le crime organisé avec une focale sur le genre.
– Offrir des formations durables, intégrer dans des programmes plus larges.
– Soutenir des plateformes de discussion sur les biais de genre au sein et entre les autorités et les OSC.
|
|
Renforcer la prévention sensible au genre
|
– Favoriser la compréhension des aspects de genre dans le recrutement, se concentrer sur les risques comme la violence domestique.
– Élaborer des pratiques basées sur des preuves pour l’identification et le suivi des risques via une approche multi-acteurs.
– Sensibiliser les femmes et les filles aux conséquences du crime organisé, utiliser les expériences vécues.
– Investir dans des compétences professionnelles et en alphabétisation financière pour l’indépendance économique des femmes à risque.
|
|
Promouvoir des programmes de sortie inclusifs selon le genre
|
– Augmenter la compréhension des moteurs et exigences spécifiques au genre pour sortir du crime organisé.
– Impliquer les femmes comme agents indépendants dans les initiatives judiciaires et non judiciaires de sortie, pas seulement comme partenaires.
– Assurer que les stratégies de sortie tiennent compte de la victimisation antérieure (par exemple, violence sexuelle/émotionnelle).
|
|
Promouvoir la collecte de données désagrégées par sexe
|
– Initier/améliorer la collecte et l’analyse régulières de données complètes désagrégées par sexe sur le crime organisé.
– Promouvoir le partage de données entre agences, conformément aux normes de confidentialité, pour la prévention, la perturbation et la sortie.
– Intégrer les données dans le policing basé sur le renseignement pour des efforts sensibles au genre basés sur des preuves.
|
|
Construire des partenariats efficaces
|
– Établir des plateformes multi-acteurs pour l’échange de stratégies sensibles au genre.
– Promouvoir l’échange d’informations régional et transrégional sur les réponses sensibles au genre au crime organisé.
|
Ces recommandations visent à combler les lacunes dans la compréhension et la réponse au rôle des femmes, en insistant sur une approche inclusive et basée sur des données.
Implications pour les politiques et pratiques
Le rapport souligne que l’absence de reconnaissance de l’agence des femmes dans le crime organisé entrave la compréhension de la complexité du paysage criminel et limite la capacité des États participants à lutter contre le crime organisé transnational ou à soutenir les femmes pour quitter ces groupes. Par exemple, les programmes de protection des témoins d’État, comme en Italie, montrent une faible participation féminine (3-5 % entre 1996 et 2015, 4 % en mars 2023), soulignant le besoin de stratégies plus inclusives.