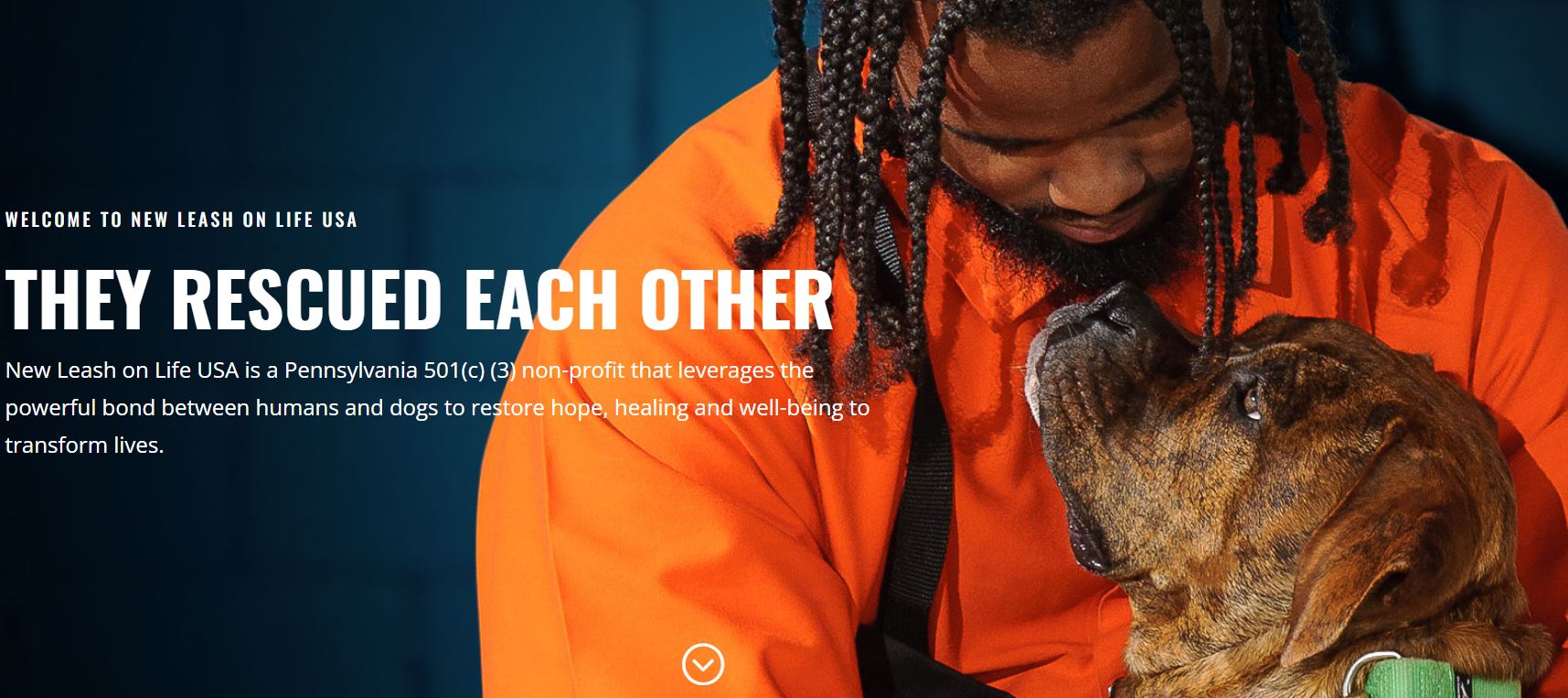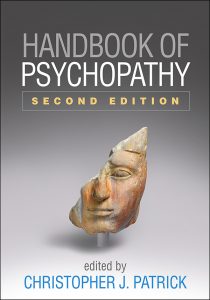Quelle est la validité de la notion de psychopathie dans le cadre d’une prise de décision juridique ?
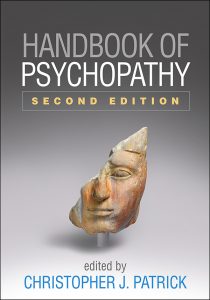 (extrait de « Questions juridiques et éthiques dans l’évaluation et le traitement de la psychopathie », de JOHN F. EDENS , JOHN PETRILA , SHANNON E. KELLEY, dans l’ouvrage Handbook of psychopathy de Christopher Patrick, 2019)
(extrait de « Questions juridiques et éthiques dans l’évaluation et le traitement de la psychopathie », de JOHN F. EDENS , JOHN PETRILA , SHANNON E. KELLEY, dans l’ouvrage Handbook of psychopathy de Christopher Patrick, 2019)
« Il est courant, dans les résumés d’affaires juridiques, de voir les mesures du PCL décrites globalement comme fiables et « valides » par les témoins experts et les juges. Bien qu’un peu compréhensibles, ces affirmations globales dans le contexte du système juridique sont généralement hors sujet parce qu’elles ignorent ce qui est généralement une question spécifique au contexte concernant l’utilité d’une mesure par rapport à une question juridique particulière (DeMatteo & Edens, 2006; Foster & Cone, 1995).
De telles déclarations vont également à l’encontre des directives professionnelles, qui stipulent que la fiabilité et la validité ne sont pas des propriétés statiques qui résident dans un test – et certainement pas dans des échelles d’évaluation professionnelles remplies par un large éventail d’examinateurs de la santé mentale. La «validité » fait référence à l’utilité des inférences qui peuvent être tirées des résultats d’un test spécifique (American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education, 2014). Lorsque la psychopathie est utilisée dans le cadre de violence, la question de sa validité tourne autour de son utilité prédictive par rapport au critère d’intérêt. par rapport au critère d’intérêt. À ce titre, les discussions sur de la validité du PCL doivent être formulées en fonction de la ou des questions de la (des) question(s) particulière(s) qu’il est censé éclairer (par exemple, le risque de violence d’un délinquant sexuel libéré). Les déclarations générales qui généralisent à l’excès des concepts complexes tels que la validité par souci de simplicité (par exemple, « le PCL-R est valide ») ne sont pas défendables en fin de compte. Des affirmations plus précises et plus limitées sur la signification des scores de psychopathie à des questions juridiques particulières (par exemple, « En supposant des niveaux adéquats de fiabilité inter-juges, les scores PCL-R peuvent différencier de manière significative les délinquants libérés qui présentent un risque plus élevé que ceux qui présentent un risque plus faible de violence dans la communauté »). En outre, les normes d’admissibilité telles que les critères de Daubert plaident en faveur un examen minutieux de la validité de toute technique d’évaluation par rapport à l’affaire en question.
Deux domaines dans lesquels la question de la validité se pose sont le risque de violence et l’aptitude au traitement. Dans ces domaines en particulier, nous pensons que le concept de psychopathie se prête à des excès considérables de la part des tribunaux, peut-être avec le soutien implicite ou explicite d’au moins certains des médecins légistes. En ce qui concerne d’évaluation du risque, quelques domaines clés méritent d’être soulignés en plus de ceux qui ont été mentionnés précédemment. Premièrement, bien que l’utilisation d’inventaires standardisés représente une amélioration par rapport au jugement clinique spontané, un diagnostic de psychopathie ne doit pas être assimilé à une désignation de « dangerosité », et ne doit pas non plus favoriser un niveau de confiance particulier concernant les prédictions dichotomiques de violence pour un délinquant spécifique. Bien que dans de nombreux contextes, un score élevé à la PCL-R identifie une personne qui, d’un point de vue probabiliste, est plus susceptible de commettre des actes de violence qu’une personne ayant un score moins élevé, il ne s’agit pas de l’équivalent fonctionnel d’un «délinquant dangereux » ou d’un « psychopathe sexuel ». Il s’agit de catégories catégories juridiques qui peuvent s’appuyer sur le témoignage d’un expert en santé mentale, mais qui sont en fin de compte décidées par le juge. En outre, indépendamment de la question juridique, le fait empirique est que les taux de base de récidive criminelle pour les délinquants psychopathes sur des périodes de suivi relativement longues sont variables et parfois relativement faibles (Freedman, 2001). Bien que cela n’exclue pas l’utilisation de la l’utilisation du PCL-R pour l’évaluation du risque, cela soulève des questions complexes sur le bien-fondé des affirmations catégoriques concernant le degré de risque d’un délinquant de risque d’un délinquant (par exemple, « le délinquant X présente un risque élevé de récidive » ; pour une analyse, voir Heilbrun, Dvoskin, Hart, & McNiel, 1999).
Plus généralement, on peut se demander s’il est justifié d’utiliser l’étiquette catégorique de « psychopathe », en particulier dans des contextes juridiques contradictoires. Zinger et Forth (1998), par exemple, soutiennent l’utilisation de mesures dimensionnelles plutôt que d’une terminologie catégorielle parce qu’elle apporte plus de précision dans les témoignages et réduit le risque d’incompréhension judiciaire. Une position similaire a été défendue par l’American Psychological Association (2010), qui déconseille d’étiqueter les individus en fonction de leur trouble ou de leur handicap (par exemple, « schizophrènes », « paraplégiques » et « psychopathes »). Dans le prolongement de ces recommandations, les cliniciens qui procèdent à des évaluations du risque chez les adultes et/ou les jeunes font le plus souvent référence à des caractéristiques liées à la psychopathie pour décrire les délinquants plutôt qu’à un diagnostic définitif, même si les rapports d’évaluation du risque chez les adultes, en particulier, indiquent fréquemment si un délinquant est ou non un « psychopathe » (Viljoen, McLachlan, & Vincent, 2010).
L’un des arguments en faveur d’une telle dichotomisation serait qu’il existe des preuves qu’un taxon latent sous-tend la psychopathie (Harris, Rice et Quinsey, 1994) et que « les psychopathes constituent une classe naturelle discrète » (Harris, Skilling et Rice, 2001, p. 197, c’est nous qui soulignons). Toutefois, contrairement à cette affirmation, au cours de la dernière décennie, des recherches utilisant des procédures taxométriques plus avancées ont fourni des preuves irréfutables que le concept composite de psychopathie et ses composantes distinctes sont de nature dimensionnelle, tant chez les jeunes que chez les adultes (Edens, Marcus, Lilienfeld et Poythress, 2006 ; Edens, Marcus et Vaughn, 2011 ; Guay, Ruscio, Knight et Hare, 2007 ; Murrie et autres, 2007 ; Walters, Duncan, & Mitchell-Perez, 2007 ; Walters, Marcus, Edens, Knight, & Sanford, 2011). Ainsi, les références qualitatives à la question de savoir si un individu est « un psychopathe », qui apparaissent relativement fréquemment dans les affaires pénales nord-américaines (DeMatteo et al., 2014b ; Viljoen, McLachlan, & Vincent, 2010), ne semblent pas être justifiées par l’état actuel des preuves.
Le même problème se pose en ce qui concerne la pertinence de la psychopathie pour la question de l’aptitude au traitement, dans la mesure où les individus désignés comme « psychopathes » sont souvent considérés comme une catégorie d’individus impossibles à traiter. Malgré ces affirmations, la question de savoir dans quelle mesure la psychopathie peut être traitée reste ouverte et fait l’objet de discussions et de recherches de plus en plus optimistes, comme en témoigne un récent numéro spécial de l’International Journal of Forensic Mental Health publié à l’occasion de la deuxième conférence de Bergen sur le traitement de la psychopathie (voir également Polaschek & Skeem, chapitre 29). La perspective nihiliste de certains commentateurs est remise en question par des analyses et des données plus récentes qui fournissent des preuves des effets du traitement pour les délinquants adultes et adolescents (Caldwell, McCormick, Wolfe, & Umstead, 2012 ; D’Silva, Duggan, & McCarthy, 2004 ; Salekin, Worley, & Grimes, 2010 ; Skeem, Polaschek, & Manchek, 2009 ; Wong, Gordon, Gu, Lewis, & Olver, 2012). Cependant, en comparaison avec d’autres domaines de la recherche sur la psychopathie, les stratégies de traitement et les résultats ont connu peu de progrès, les preuves émergentes reposant en grande partie sur des études de cas ou des programmes récemment lancés avec des résultats préliminaires. Plusieurs questions cruciales doivent encore être abordées, notamment celle de savoir si la psychopathie elle-même répond au traitement et comment les variations dans les constellations de traits psychopathiques peuvent correspondre à l’hétérogénéité des résultats du traitement (Polaschek & Daly, 2013). Une exception à cette pénurie de recherche empirique est la littérature sur le traitement des délinquants juvéniles psychopathes, qui indique un succès dans la réduction de la probabilité de violence future lorsque des stratégies d’intervention appropriées sont utilisées (Caldwell, 2011 ; Caldwell et al., 2012 ; Caldwell, Skeem, Salekin, & Van Rybroek, 2006).
Néanmoins, les recherches disponibles à ce jour suggèrent que les individus présentant des traits psychopathiques élevés sont moins susceptibles de bénéficier des types d’interventions qui ont généralement été étudiés et ont tendance à présenter des comportements impulsifs et perturbateurs, une difficulté à former des attachements émotionnels et une motivation limitée pour le changement (Leygraf & Elsner, 2007). Selon nous, cependant, ces résultats ne permettent pas de conclure que la psychopathie est « intraitable ».
Tout comme les interprétations des résultats des études sur la récidive (Edens, Petrila et Buffington-Vollum, 2001 ; Edens, Skeem, Cruise et Cauffman, 2001), ces résultats des études sur le traitement indiquent une différence probabiliste dans les résultats plutôt qu’une distinction catégorique entre les personnes ayant un score élevé ou faible à la PCL en termes de traitabilité. Ainsi, nous pensons que les examinateurs devraient scrupuleusement éviter de mal interpréter les résultats des études existantes pour en conclure que la psychopathie est immuable.
En outre, sur la base de ces résultats nomothétiques (au niveau du groupe), les examinateurs sont souvent invités à tirer des conclusions idiographiques sur des individus particuliers. Là encore, la décision juridique que doit prendre l’enquêteur peut s’appuyer sur des preuves ou des témoignages en matière de santé mentale, et ces témoignages doivent à leur tour s’appuyer sur une compréhension critique des points forts et des limites de la littérature existante en matière de traitement. L’absence relative d’études contrôlées examinant les approches thérapeutiques connues pour réduire la récidive parmi les populations de délinquants semble militer contre le fait de tirer des conclusions catégoriques selon lesquelles un délinquant psychopathe particulier ne répondra pas aux interventions correctionnelles qui fonctionnent avec d’autres délinquants. Il est peut-être encore plus important que les évaluateurs judiciaires soient conscients des limites des recherches antérieures sur le traitement qui, dans certains cas, comportaient des interventions douteuses sur le plan éthique et peu susceptibles d’entraîner une amélioration (p. ex. Harris, Rice et Cormier, 1994 ; pour plus de détails, voir Polaschek et Skeem, chapitre 29, dans le présent volume).
Ces conclusions prématurées basées sur des études méthodologiquement faibles (Vincent & Hart, 2012) sont en effet contestées par de nombreux résultats selon lesquels les délinquants ayant des scores PCL-R élevés peuvent bénéficier de traitements visant à réduire le risque de récidive générale ou violente lorsque les interventions sont administrées de manière appropriée et principalement axées sur les facteurs de risque dynamiques (Polaschek & Daly, 2013). »
 Les distorsions cognitives sont des schémas de pensée irrationnels ou négatifs qui peuvent exacerber des problèmes émotionnels et comportementaux, comme l’anxiété, la dépression ou, dans ce cas, l’escroquerie.
Les distorsions cognitives sont des schémas de pensée irrationnels ou négatifs qui peuvent exacerber des problèmes émotionnels et comportementaux, comme l’anxiété, la dépression ou, dans ce cas, l’escroquerie.