A quoi servent les activités en détention?
De nombreuses recherches confirment en effet que ces actions, combinées à un accompagnement global, réduisent significativement la récidive. Elles transforment les trajectoires en offrant des alternatives concrètes à la marginalisation et de ce fait confirment leur pertinence dans les politiques pénales modernes[1].
Ces actions agissent sur de multiples dimensions :
- Réduction de l’oisiveté : Les activités structurées limitent les comportements destructeurs en détention (Bouffard et al., 2000).
- Création de capital social : Les relations positives avec encadrants ou pairs renforcent les réseaux de soutien post-incarcération (Sampson & Laub, 1993).
- Approche holistique : Combattre les inégalités d’accès à l’éducation, à la culture ou au sport permet de s’attaquer aux racines de la délinquance (Théorie des opportunités différentielles, Cloward & Ohlin, 1960).
De plus en plus d’études soulignent l’impact du yoga et de la pleine conscience dans les systèmes pénitentiaires. Voici pourquoi cette approche mérite notre attention
Les preuves scientifiques parlent d’elles-mêmes:
Muirhead, Fortune (2016) Yoga in prisons: A review of the literature
« Il a été démontré que le yoga améliore certaines variables clés liées à la délinquance (par exemple, l’impulsivité, l’agression), ainsi que des variables qui pourraient améliorer la capacité des délinquants à participer à des traitements visant spécifiquement à réduire leur risque de comportement criminel (par exemple, la dépression, l’attention, la régulation émotionnelle). (source: sciencedirect.com)
🇬🇧 Une étude menée par l’Université d’Oxford (2013) sur 100 détenus a montré que la pratique régulière du yoga réduisait significativement le stress, l’anxiété et les comportements agressifs, tout en améliorant la régulation émotionnelle (Source : prisoners-doing-yoga-may-see-psychological-benefits).
🇺🇲 Le Prison Yoga Project, fondé en 2002, a documenté des témoignages de participants soulignant une meilleure gestion des conflits et un regain d’estime de soi, essentiels pour une réinsertion réussie. (source: prisonyoga.org/ )
🇸🇪Une recherche suédoise (Kerekes et al. 2017; Yoga in Correctional Settings: A Randomized Controlled Study) conclue que : « Par rapport au groupe témoin, les participants aux cours de yoga ont fait état d’une amélioration significative de leur bien-être émotionnel et d’une diminution de leur comportement antisocial après 10 semaines de yoga. Ils ont également amélioré leurs performances au test informatisé qui mesure l’attention et le contrôle des impulsions. »
🇦🇺Une recherche Australienne (Bartels et al. 2019) sur le yoga en prison conclue que: « Nos résultats indiquent que les participants ont tiré des avantages statistiquement et cliniquement significatifs du programme, comme en témoignent les améliorations de leurs niveaux de dépression, d’anxiété, d’estime de soi, d’orientation vers un objectif, d’affect négatif et de non-acceptation. Ils ont également fait état d’une amélioration de la flexibilité, du sommeil et de la relaxation, d’une réduction de la douleur et d’une amélioration de leur bien-être mental, déclarant que le programme leur avait permis de se sentir « calmes » et « en paix ».
Dans un système souvent axé sur la punition, intégrer des approches holistiques comme le yoga permet de :
✅ Réduire les tensions et les violences en détention.
✅ Préparer les individus à réintégrer la société avec des outils émotionnels solides.
✅ Aborder la réhabilitation sous un angle préventif.
Et que dit la recherche sur la médiation animale en milieu pénal ?
 Sur le plan de la recherche, les programmes sont tellement différents qu’il est difficile de les comparer réellement, et d’en tirer des meta-analyses méthodologiquement solides. Mais les résultats accumulés depuis des années sont prometteurs !
Sur le plan de la recherche, les programmes sont tellement différents qu’il est difficile de les comparer réellement, et d’en tirer des meta-analyses méthodologiquement solides. Mais les résultats accumulés depuis des années sont prometteurs !
Réduction des Comportements Violents
Une étude menée par Harkrader, Burke et Owen (2004) dans des établissements pénitentiaires américains a démontré que les détenus participant à des programmes de dressage canin présentaient une diminution significative des actes violents et un renforcement de leur sens des responsabilités. Ces activités favoriseraient également l’acquisition de compétences sociales essentielles pour la vie en communauté.
« Grâce à ces programmes de dressage de chiens, les détenus apprennent la responsabilité, la patience, la tolérance et les compétences en tant que dresseurs d’animaux. Les chiens constituent également un lien entre les détenus et les gardiens et réduisent les conflits entre les détenus et le personnel. » (Todd Harkrader; Tod W. Burke; Stephen S. Owen (2004) Pound Puppies: The Rehabilitative Uses of Dogs in Correctional Facilities)
Les chevaux, étant particulièrement sensibles au langage non-verbal, exigent des participants une forme de cohérence émotionnelle. Cette caractéristique permet de travailler sur la régulation émotionnelle, un déficit souvent observé chez les personnes ayant commis des actes délictueux. L’étude de Burgon (2016) a démontré que les participants développaient progressivement une meilleure reconnaissance et gestion de leurs émotions négatives comme la colère ou la frustration.
Développement de l’Empathie
Selon les travaux de Furst (2006), interagir avec des animaux permettrait aux personnes incarcérées de restaurer leur capacité à créer des liens émotionnels sains. Les animaux agissent comme des catalyseurs d’empathie, un élément clé potentiel pour réduire les risques de récidive. (Gennifer Furst (2006) Prison-Based Animal Programs: A National Survey)
Par ailleurs, le travail en groupe autour des chevaux favorise la coopération et l’apprentissage du travail d’équipe. L’étude longitudinale de Hemingway et al. (2015) a mis en évidence comment des détenus initialement isolés développaient progressivement des capacités de collaboration à travers des tâches collectives liées aux soins des équidés.
Impact sur la récidive
La revue des études (19) sur le sujet menée par Bachi (2013) montre clairement des résultats encourageants qui nécessitent d’être consolidés :
- Trois études ont mis en évidence une réduction des taux de récidive. Un examen des dossiers du service de probation (Chianese, 2010) a révélé que les filles qui ont participé à un programme de médiation animal récidivaient deux fois moins que les filles qui n’avaient pas été exposées à un chiot. Celles qui ont récidivé n’ont été accusées que de violations de la probation et n’ont pas commis de nouveaux délits.
- le programme carcéral équin « Wild Mustang Program (WMP) » au Nouveau Mexique, a également fait état d’une réduction des taux de récidive parmi les 56 hommes participant au programme (Cushing & Williams, 1995). Seulement 25 % des participants ont récidivé contre un taux de récidive moyen de 38,12 % dans l’État. Il s’agissait d’une à méthodes mixtes, composée d’entretiens qualitatifs et de méthodes quantitatives
- Ann Hemingway & Kezia Sullivan ont mis en évidence (Grande Bretagne) une diminution des violences domestqiues post intervention avec médiation équine. (Reducing the incidence of domestic violence: An observational study of an equine-assisted intervention) (“Des réductions significatives de la violence domestique et du statut d’enfant dans le besoin ont été constatées pour les familles dont un ou plusieurs membres ont suivi et achevé l’intervention assistée par la médiation équine”)
Les chercheurs attribuent ces effets positifs à plusieurs facteurs: l’acquisition de compétences transférables (patience, constance, responsabilité), le développement d’une relation significative, et l’expérience valorisante d’être en position de « soignant » plutôt que de personne à problèmes.
[1] Voir par exemple Meek & Lewis (2014) ; UNOCOC (2020), Andrews et Bonta (2010)).
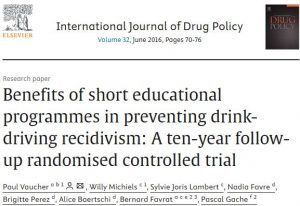 Conduire sous l’influence de l’alcool reste une cause majeure d’accidents routiers. En Suisse, comme ailleurs, une part importante des accidents mortels est liée à l’alcool. Mais comment prévenir efficacement la récidive chez les conducteurs sanctionnés pour la première fois ? Une équipe de chercheurs suisses a évalué l’impact de programmes éducatifs de durées différentes sur le risque de récidive… pendant 10 ans !
Conduire sous l’influence de l’alcool reste une cause majeure d’accidents routiers. En Suisse, comme ailleurs, une part importante des accidents mortels est liée à l’alcool. Mais comment prévenir efficacement la récidive chez les conducteurs sanctionnés pour la première fois ? Une équipe de chercheurs suisses a évalué l’impact de programmes éducatifs de durées différentes sur le risque de récidive… pendant 10 ans !

 Et si la clé pour réduire la récidive et favoriser la réinsertion se trouvait aussi dans une pratique millénaire , qui a dès lors toute sa place en détention ?
Et si la clé pour réduire la récidive et favoriser la réinsertion se trouvait aussi dans une pratique millénaire , qui a dès lors toute sa place en détention ? Sur le plan de la recherche, les programmes sont tellement différents qu’il est difficile de les comparer réellement, et d’en tirer des meta-analyses méthodologiquement solides. Mais les résultats accumulés depuis des années sont prometteurs !
Sur le plan de la recherche, les programmes sont tellement différents qu’il est difficile de les comparer réellement, et d’en tirer des meta-analyses méthodologiquement solides. Mais les résultats accumulés depuis des années sont prometteurs !



