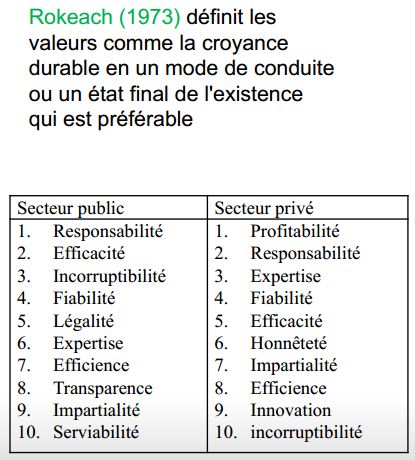Sylvain CHATELET (2014) « Si on ne veut rien faire pour les longues peines, il faut le dire clairement »; Dedans Dehos n°23 « Projet de réforme pénale : aussi indispensable qu’inabouti »; Mars 2014
Durant sa détention à la centrale d’Arles, Sylvain Chatelet a pu observer les effets positifs d’une gestion particulière dans cet établissement, favorisant la consultation des détenus et leur participation à la vie collective. Il demande la généralisation de ce modèle, plaide aussi pour la réduction de l’échelle des peines et la suppression des périodes de sûreté, qui rendent vains les efforts de réinsertion des condamnés à de longues peines. Des sujets soulevés lors de la conférence de consensus et ignorés par le projet de réforme pénale. Suscitant chez les détenus « frustration et incompréhension ».
« Même ceux qui font le plus les cadors vous prennent la main si vous la leur tendez. Il n’y en a pas un qui n’ait envie de changer de vie. »
La loi devrait affirmer un droit à la réinsertion, dans tous les types d’établissements pénitentiaires. Qu’il soit clair que la fonction de la prison est de réinsérer les gens, pas de fermer la porte, prendre la clé et la jeter ! Dans la plupart des centrales, on vous donne une cellule et on vous dit de vous démerder, de ne pas ennuyer l’administration, de faire votre vie tranquille et ça ira très bien. Ce n’est pas un hasard si ce sont des détenus d’Arles qui ont été choisis pour participer à la conférence de consensus. Depuis la réouverture de la centrale en 2009, la direction a essayé de mettre en place un autre type de gestion. Par exemple, j’ai été à l’initiative, avec l’ancien directeur, de la mise en place des « détenus facilitateurs ». Leur rôle est d’être attentifs aux autres, d’intervenir en cas de difficulté pour atténuer les conflits entre détenus ou avec des surveillants. Souvent les détenus ont une attitude de rejet vis-à-vis de l’administration. Mais avec un autre détenu, ils parlent toujours. Je leur expliquais : « si tu as un problème, tu viens me voir, on boit un café, tu m’exposes ton problème et je verrai de quelle manière je peux intervenir pour toi ». Au début, certains ont pensé qu’il s’agissait de « prévôts ». Progressivement, notre rôle a été compris et accepté.
Quelles sont les autres spécificités à Arles ?
La direction organise des journées de formation animées par des intervenants extérieurs – sur la criminologie, les addictions, la réforme pénale, etc. On se retrouve en comité restreint, dont les facilitateurs, et parfois des personnels pénitentiaires acceptent de participer. Ces rencontres se déroulent dans une pièce à part et le repas est pris en commun. Certains détenus n’ont pas partagé un repas depuis dix ans, ils ont l’habitude de manger en cellule en 5 minutes. Il n’y a pas une seule journée de formation dont je n’ai vu des participants sortir sans être transformés. Je pèse bien le mot : un véritable changement s’effectue en eux, une dynamique se met en place, ils voient les choses autrement et ils se montrent tels qu’ils sont. A Arles, ils font aussi rentrer des chevaux. Le contact avec ces animaux, ça vous renvoie à ce que vous ressentez, votre façon d’être, on ne peut pas tricher. Il y aurait beaucoup à dire encore sur ce qui est fait dans cette centrale. De manière générale, si vous coupez les gens de toute forme de rapports sociaux, vous en faites des animaux. Si vous essayez de garder le contact avec quelque chose qui se rapproche de l’extérieur, c’est plus facile ensuite de les remettre dans le monde réel. J’espère que ces actions importantes vont se répandre dans les autres centrales.



 This summary provides an overview of key evidence relating to reducing the reoffending of adult offenders. It has been produced to support the work of policy makers, practitioners and other partners involved in offender management and related service provision. The first version of this summary was published in September 2013, and this version has been updated to reflect recent evidence.
This summary provides an overview of key evidence relating to reducing the reoffending of adult offenders. It has been produced to support the work of policy makers, practitioners and other partners involved in offender management and related service provision. The first version of this summary was published in September 2013, and this version has been updated to reflect recent evidence. Thinking for a Change (T4C) is an integrated, cognitive behavior change program for offenders that includes cognitive restructuring, social skills development, and development of problem solving skills.
Thinking for a Change (T4C) is an integrated, cognitive behavior change program for offenders that includes cognitive restructuring, social skills development, and development of problem solving skills.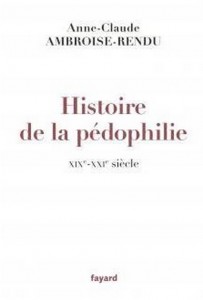 Parution de Anne-Claude Ambroise-Rendu, Histoire de la pédophilie, XIXe-XXe siècle, Paris, Fayard, 2014, 352 p. ISBN 978-2-213-67232-8, 24 €
Parution de Anne-Claude Ambroise-Rendu, Histoire de la pédophilie, XIXe-XXe siècle, Paris, Fayard, 2014, 352 p. ISBN 978-2-213-67232-8, 24 € Le modèle transthéorique soutient que les individus doivent passer par cinq stades de changement appelés précontemplation, contemplation, préparation, action et maintien pour arriver à modifier un comportement problématique. Il stipule également que le passage d’un stade à l’autre s’accompagne d’une évolution de la perception des coûts et des bénéfices associés au changement, ainsi que du sentiment d’efficacité personnelle. L’étude réalisée visait d’abord à vérifier si ces concepts s’appliquent à des hommes ayant des comportements violents envers leur partenaire, une problématique où le modèle suscite un intérêt grandissant. Elle visait également à vérifier s’il existe une relation entre la violence rapportée par les individus, leur tendance à blâmer leur partenaire et les stades de changement. Elle visait finalement à déterminer l’utilité du modèle pour prédire quels hommes choisissent de ne pas s’inscrire aux programmes d’aide qui leur sont proposés suite à des entrevues d’évaluation et lesquels décident d’abandonner avant la fin.
Le modèle transthéorique soutient que les individus doivent passer par cinq stades de changement appelés précontemplation, contemplation, préparation, action et maintien pour arriver à modifier un comportement problématique. Il stipule également que le passage d’un stade à l’autre s’accompagne d’une évolution de la perception des coûts et des bénéfices associés au changement, ainsi que du sentiment d’efficacité personnelle. L’étude réalisée visait d’abord à vérifier si ces concepts s’appliquent à des hommes ayant des comportements violents envers leur partenaire, une problématique où le modèle suscite un intérêt grandissant. Elle visait également à vérifier s’il existe une relation entre la violence rapportée par les individus, leur tendance à blâmer leur partenaire et les stades de changement. Elle visait finalement à déterminer l’utilité du modèle pour prédire quels hommes choisissent de ne pas s’inscrire aux programmes d’aide qui leur sont proposés suite à des entrevues d’évaluation et lesquels décident d’abandonner avant la fin.