Évaluation des représentations sociales concernant la violence: EFAE-20
Échelle Française de représentation de l’agression expressive (20 items) (’aprés le questionnaire EXPAGG sur les représentations sociales de la violence in : CAMPBELL A, MUNCER S, COYLE E, Social representation of aggression as an explanation of gender differences: a preliminary study. Aggrerszw Be/my 1992 ; 18 (2) : 95-108. ; ARCHER J, HAIGH A. Do beliefs about aggressive feelings and actions predict reported levels of aggression? Br J Soc Pyschol 1997 ; 36 (1) : 83-105.)
Ce questionnaire, dénommé EFAE-20 (Échelle française des représentations de l’agression expressive à 20 items), est inspiré du questionnaire EXPAGG utilisé dans des travaux britanniques sur les représentations sociales de la violence (35> 36) et a donné lieu a une procédure de validation en français (PATY B. La violence a l’école : étude d’une représentation sociale comme facteur de stress des enseignants [Thèse de doctorat de psychologie]. Reims : Universite de Reims Champagne-Ardenne, 2004) .
Il comporte 20 items destinés à recueillir les explications privilégiées par le répondant lorsqu’il s’agit de comprendre pourquoi on peut être violent. Les réponses se font sur une échelle en quatre points allant de 1 (pas du tout d”accord) à 4 (tout à fait d’accord).
Cette échelle permet de mesurer deux facteurs :
le premier facteur regroupe des items pour la plupart relatifs à une conception de la violence comme expressive. C’est le modèle frustration-agression qui sous-tend ce facteur de représentation.
Le second facteur correspond à une représentation plus instrumentale et plus contrôlable de la violence. Il regroupe des items où l’usage de la violence est présenté comme ayant une certaine finalité.
Le premier facteur regroupe des items pour la plupart relatifs à une conception de la violence comme expressive. C’est le modèle frustration-agression qui sous-tend ce facteur de représentation. Deux items “Les gens violents emploient souvent la force simplement parce qu’ils ne voient pas d’autres moyens d’agir” et “Les personnes violentes utilisent tout simplement leur agressivité lorsqu’il leur faut agir”, bien qu’évoquant l’idée “d’utiliser ou d”employer la violence” (vision a priori instrumentale de la violence), saturent le plus sur ce facteur. C’est très certainement le caractère excusable qui est ici mis en avant. En additionnant les items composant ce facteur, on mesure donc une conception naïve d’une violence ayant souvent comme origine la frustration (sous la forme de la jalousie par exemple), des violences subies auparavant ou encore des humiliations (comme le manque de respect). La dimension mesurée par ce facteur est appelée “conception de violence expressive” (à la suite de frustrations). Basé sur dix items, ce score peut théoriquement varier de 10 à 40. A titre indicatif, la note moyenne de référence pour des adultes, enseignants d’une trentaine d’années est de 27 (SD = 4,15) .
Le second facteur correspond à une représentation plus instrumentale et plus contrôlable de la violence. Il regroupe des items où l’usage de la violence est présenté comme avant une certaine finalité. De même, c’est surtout l’image de la violence urbaine, liée aux quartiers difficiles et aux ghettos, qui y est présentée comme inéluctable ou en tout cas comme une sorte de conduite nécessaire à la survie dans ces quartiers. Exemples : “Les jeunes issus de quartiers difficiles sont obligés de recourir à des comportements violents pour s’en sortir” et “Ne jamais être agressif, c’est prendre le risque de se faire marcher sur les pieds”.
Les items évoquant d’éventuelles solutions à ces formes de violence “Il est possible d”empêcher la violence en augmentant le nombre de policiers dans les rues” et “En punissant ou en éduquant plus efficacement, il doit être possible d’éviter la plupart des actes de violence” (solutions cohérentes avec le modèle d’apprentissage de l’agression) se retrouvent avec les saturations les plus fortes sur ce second facteur. Pour résumer, ce type de représentation sociale de la violence est celui d’une violence instrumentale et urbaine dont les causes sont sociales ou identitaires, à laquelle on trouve des justifications, et surtout que l’on conçoit comme évitable par l’éducation, la punition ou la répression. La dimension issue de ce facteur est appelée “conception de la violence instrumentale et curable”. Basée sur huit items, la mesure peut en théorie varier de 8 à 32. A titre indicatif, la note moyenne de référence pour des adultes, enseignants d’une trentaine d’années est de 17,90 (SD =3,59) (30).
Deux mesures sont donc fournies par l’administration de ce questionnaire EFAE-20 : la conception de la violence comme expressive et la conception de la violence comme instrumentale et curable.




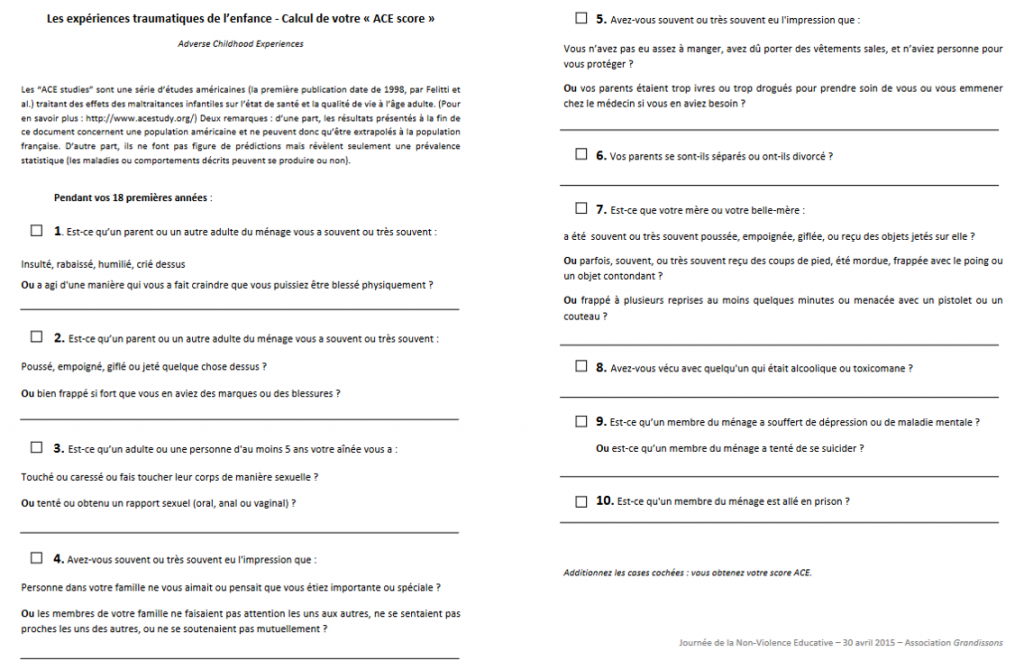


 Le VRAG-R est conçu pour évaluer la probabilité de récidive violente ou sexuelle chez les délinquants de sexe masculin. L’ensemble des données comprend des informations démographiques, criminelles, psychologiques et psychiatriques sur les délinquants, recueillies dans les dossiers des institutions, ainsi que des informations sur la récidive après la libération. Le VRAG-R est un instrument actuariel à douze items et les scores obtenus à ces items font partie de l’ensemble de données.
Le VRAG-R est conçu pour évaluer la probabilité de récidive violente ou sexuelle chez les délinquants de sexe masculin. L’ensemble des données comprend des informations démographiques, criminelles, psychologiques et psychiatriques sur les délinquants, recueillies dans les dossiers des institutions, ainsi que des informations sur la récidive après la libération. Le VRAG-R est un instrument actuariel à douze items et les scores obtenus à ces items font partie de l’ensemble de données. AVANT-PROPOS
AVANT-PROPOS