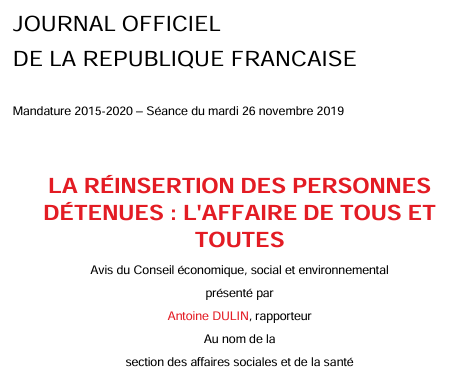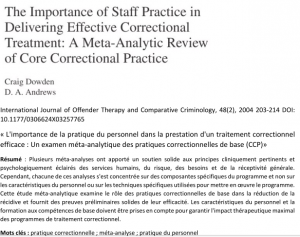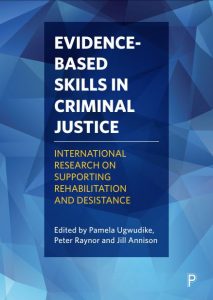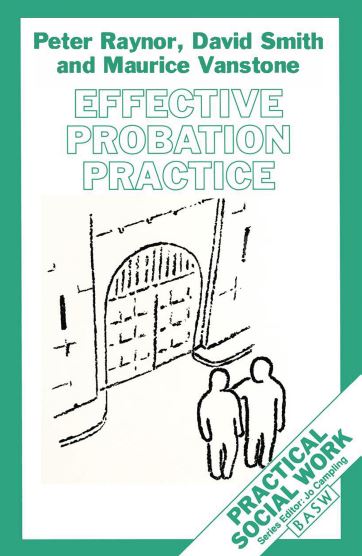Construire une relation collaborative : Modèle EPICS ( Effective Practices in Community Supervision)
Importance d’une APPROCHE ÉQUILIBRÉE
– Les agents de probation formés à l’EPICS qui ont une grande fidélité au modèle (EPICS & CCP) étaient beaucoup plus susceptibles d’être perçus comme fiables par les délinquants dont ils s’occupaient.
– L’étude a montré que plus la confiance entre le délinquant et l’agent augmente, plus les chances d’être arrêté à nouveau diminuent (Labrecque et al. 2013).
IMPORTANCE DE LA CLARIFICATION DES RÔLES
« La recherche suggère qu’un travail efficace avec des clients involontaires se caractérise par des discussions claires, honnêtes et fréquentes sur le rôle de l’intervenant et le rôle du client dans le processus de pratique directe ». (Trotter, 2006)
La clarification des rôles doit être considérée comme l’une des compétences clés dans le travail avec les clients involontaires et a été liée à de meilleurs résultats avec les probationnaires (Andrews et Bonta , 2010).
COMPOSANTES DE LA CLARIFICATION DES RÔLES
– Le double rôle de l’agent de probation
– Éléments flexibles ou inflexibles
– Attentes du délinquant
Exemple:
« J’ai mentionné qu’une partie de mon travail consisterait à vous aider à travailler sur les pensées et les comportements qui ont pu jouer un rôle dans le fait que vous vous retrouviez en probation. Pendant le temps que vous passerez avec moi, nous utiliserons des outils tels que la chaîne délictuelle, le renforcement des compétences et la résolution de problèmes afin de vous aider à mieux gérer les situations à risque à l’avenir. ».
RÔLE D’AIDANT: Expliquer au PPSMJ que le rôle du personnel est également de l’aider à résoudre les problèmes qu’il rencontre pendant la période de suivi :
|
«Une partie de mon travail consiste aussi à m’assurer que vous respectiez les conditions de vos décisions de justice. Cela va impliquer un certain contrôle de ma part. Nous nous rencontrerons régulièrement, je pourrai effectuer des visites à domicile. S’il arrive que vous ne respectiez pas les décisions de justice, je pourrais avoir à en subir les conséquences. Les conséquences possibles d’un non-respect des ordonnances du tribunal sont une révocation de la probation, des peines de prison ou de détention, une augmentation de la fréquence des entretien dans le cadre de votre probation ».
RÔLE DE RESPONSABILISATION è
|
« De même, au cours de nos rencontres il y aura certaines choses qui seront flexibles et d’autres qui ne le seront pas. Par exemple, le fait que nous nous rencontrions chaque mois n’est pas flexible. Cependant, je suis prêt à m’adapter à votre emploi du temps ou à l’horaire du bus pour m’assurer que vous êtes en mesure de vous rendre aux rendez-vous. Par conséquent, l’heure et les jours où nous nous rencontrons sont flexibles. D’autres éléments sont également flexibles, notamment ce sur quoi vous voulez travailler et vous concentrer en premier lieu, ainsi que l’endroit où effectuer votre travail d’intérêt général ».
DOMAINES FLEXIBLES (négociables) ET INFLEXIBLES (non négociables) :
|
Probationnaire : « Mon dernier CPIP ne semblait pas très intéressé par mes problèmes. Tout ce qui l’intéressait, c’était de savoir si je me présentais à mes rendez-vous et si je payais mes amendes. »
CPIP « Je pense également qu’il est important que vous vous présentiez à vos rendez-vous. Cependant, je me préoccupe des autres choses que vous faites également. En fait, j’espère que nous pourrons travailler sur d’autres problèmes qui semblent avoir conduit à votre sursis probatoire. Quelles sont les autres expériences que vous avez eues en matière de probation ? » (Source= Modèle EPICS : Effective Practices in Community Supervision)
ATTENTES DES PPSMJ :
|
Sources:


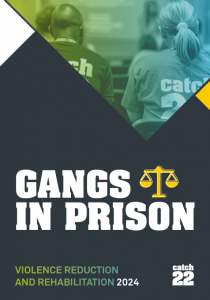
 Depuis longtemps, on suspecte que l’exclusion scolaire aggrave le risque de délinquance chez les jeunes, mais il est éthiquement impossible de randomiser ce type d’intervention . Les politiques éducatives récentes au Royaume-Uni ont vu une hausse significative des exclusions permanentes au terme d’automne 2023-24, suscitant des débats sur leurs effets délétères
Depuis longtemps, on suspecte que l’exclusion scolaire aggrave le risque de délinquance chez les jeunes, mais il est éthiquement impossible de randomiser ce type d’intervention . Les politiques éducatives récentes au Royaume-Uni ont vu une hausse significative des exclusions permanentes au terme d’automne 2023-24, suscitant des débats sur leurs effets délétères