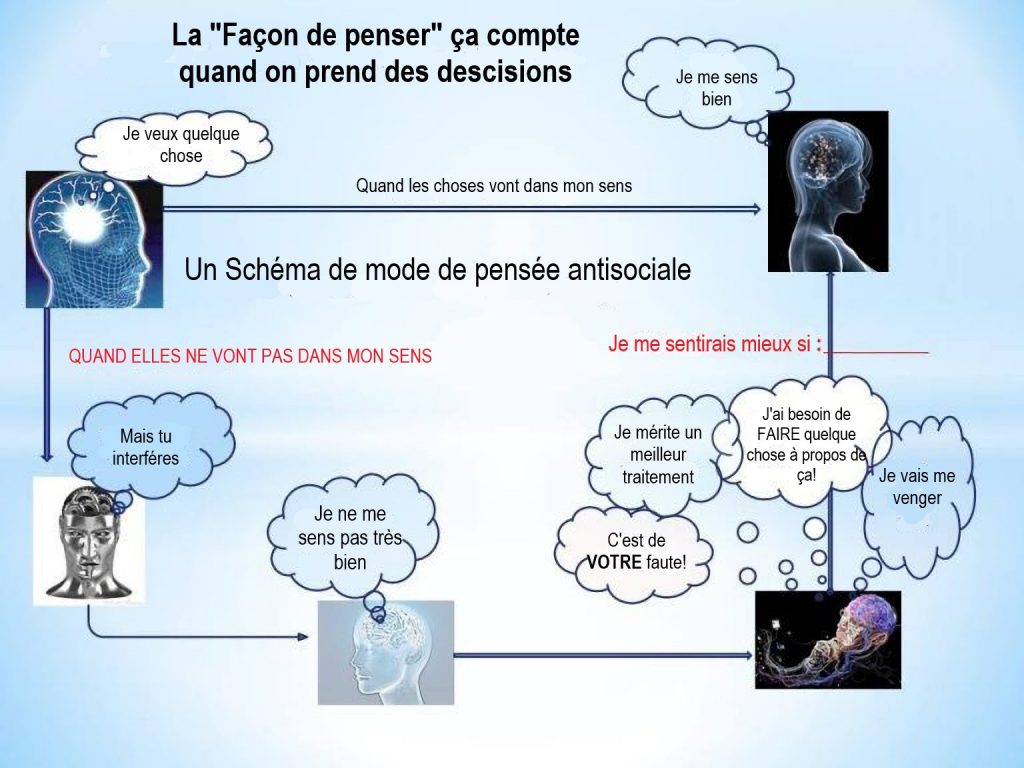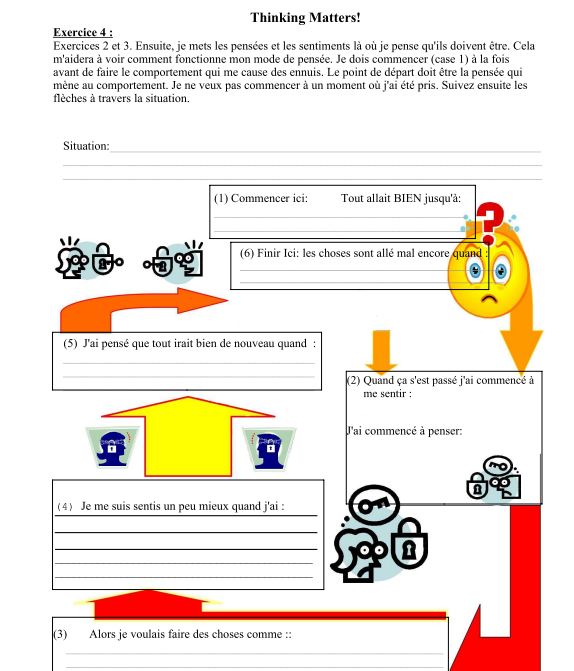Voici, pour ceux qui voudraient embrasser cette profession, comment est décrit le métier d’officier de probation sur le site américain work.chron.com
Problems Faced as a Probation Officer
(Article du 10 Juillet 2020)
« Les agents de probation surveillent les délinquants qui ont été placés sous surveillance judiciaire comme alternative à l’incarcération. Pour atteindre leurs objectifs, les agents de probation doivent faire face à des exigences administratives complexes, à des charges de travail importantes et à des budgets réduits qui ne laissent aucune place à l’erreur dans le suivi des probationnaires. Les candidats doivent prendre en compte les avantages et les inconvénients du métier d’agent de probation.
Par exemple, les agents s’aventurent souvent dans des environnements hostiles et œuvrent à la réinsertion de délinquants ayant des problèmes de dépendance ou des antécédents criminels violents. Divers problèmes conduisent souvent les agents à quitter la profession.
Charge de travail élevée
Parmi les obstacles au travail des agents de probation, citons le nombre élevé de dossiers à traiter. Les agents affirment que l’automatisation croissante de nombreuses fonctions ne s’est pas traduite par une diminution du nombre de délinquants. Dans le Maryland, par exemple, les agents de probation ont en moyenne 83 dossiers à traiter, selon une étude réalisée en 2014 par le département de la sécurité publique et des services correctionnels du Maryland. Face à un nombre aussi élevé de dossiers, les agents de probation n’ont d’autre choix que de se concentrer sur les cas à haut risque, ce qui laisse la plupart des délinquants avec une surveillance minimale ou nulle.
Faible rémunération
La faible rémunération est une frustration constante pour les agents de probation, dont les salaires ne reflètent pas la durée réelle de leur travail. En mai 2019, le salaire annuel médian des agents de probation et des spécialistes du traitement correctionnel était de 59 910 $, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Cependant, la paperasserie, les déplacements et les exigences du travail font que les agents de probation travaillent au-delà d’un horaire normal à temps plein. Par exemple, de nombreuses agences font tourner les postes de garde, ce qui exige que l’agent soit disponible 24 heures sur 24 pour gérer les urgences, rapporte le bureau.
Menaces pour la sécurité
Les agents de probation sont souvent amenés à travailler dans des zones à forte criminalité, des institutions ou des environnements hostiles. Selon une étude réalisée en 2005 par le National Institute of Justice, une sous-agence du ministère américain de la Justice, 39 à 55 % des agents de quatre États ont été victimes de violences ou de menaces liées au travail. De nombreux délinquants souffrent également de problèmes de toxicomanie qui les poussent à recourir à la violence. Par conséquent, les agents de probation doivent souvent porter des armes à feu pour se protéger.
Stress et épuisement professionnel
La pression constante exercée par les politiciens, les superviseurs et le public rend les agents de probation vulnérables au stress et à l’épuisement professionnel, ce qui nuit à leurs performances, comme le note l’enquête de l’institut. Les agents peuvent essayer diverses méthodes d’adaptation pour soulager le stress, comme l’exercice physique ou le fait de se confier à leurs collègues. Du côté négatif, les agents peuvent prendre des congés de maladie supplémentaires. Le manque d’avancement, les mauvaises relations avec les superviseurs et la frustration liée à l’attitude du public peuvent également inciter les agents à chercher un autre emploi ou à prendre leur retraite.
Risks of Probation Officers
(Article de decembre 2020)
« Les agents de probation surveillent les délinquants condamnés qui ont été placés sous la surveillance d’un tribunal comme alternative à l’emprisonnement ou après une période d’incarcération. La nature de cette relation expose les agents de probation à des risques psychologiques et physiques importants, comme les menaces des délinquants violents et de leurs associés, par exemple.
D’autres risques sont inhérents au domaine, comme la pression exercée pour respecter les délais imposés par le tribunal. Les aspirants professionnels de la justice pénale doivent réfléchir à la manière dont ces risques les affecteront avant d’entrer dans le domaine.
Environnements hostiles
Les agents de probation travaillent souvent dans des environnements hostiles qui les exposent à de graves risques de sécurité psychologique et physique. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les déplacements fréquents et le travail sur le terrain dans des quartiers à forte criminalité, des zones rurales isolées et des institutions sont une réalité du travail. D’autres conflits découlent du rôle de l’agent qui doit superviser tous les aspects de la vie d’un délinquant, ce qui le met en contact avec des membres de la famille, des amis et des proches parfois hostiles.
Lourde charge de travail
Les lourdes charges de travail sont une cause constante de stress pour les agents de probation. Ils risquent d’être incapables de suivre la paperasse et les délais imposés par le tribunal qu’ils ne peuvent pas contrôler. Les agents de probation des régions très peuplées comme Daytona Beach et Orange County, en Floride, ont souvent une douzaine de dossiers de plus que leurs collègues des autres régions de l’État, comme le rapporte WFTV 9 News. En conséquence, les agents se répartissent les dossiers entre des clients à haut risque à surveiller de près et d’autres qui peuvent être partiellement ou totalement ignorés pour gérer la charge de travail intenable des agents de probation.
Épuisement professionnelComme les autres professionnels de la justice pénale, les agents de probation risquent l’épuisement professionnel et la dépression. Les agents qui se sentent incapables de répondre aux exigences de leur travail réagiront en se fermant émotionnellement et en adoptant une attitude punitive envers les clients, rapporte In Public Safety.
Le résultat final est un manque d’empathie, ou dépersonnalisation. Cependant, si cet état psychologique d’épuisement de l’agent de probation n’est pas traité, l’agent manquera des indices importants que lui donnent les personnes sous sa supervision, ce qui entraînera une baisse supplémentaire de son efficacité.
Menaces pour la sécurité
La nature du travail de probation est physiquement risquée. Les agents doivent fréquemment superviser des délinquants qui ont commis des crimes graves ou qui souffrent de graves problèmes psychologiques et de toxicomanie qui les rendent moins hésitants à recourir à la violence. Les agents de probation peuvent être menacés, voire agressés, pour des raisons de sécurité.
Selon l’OSHA, les agents de probation font partie d’une catégorie professionnelle à haut risque pour la violence au travail dont sont victimes chaque année 2 millions de personnes aux États-Unis. Ces risques sont particulièrement élevés pour les agents de probation qui travaillent dans des environnements de garde comme les prisons ou les établissements psychiatriques.
Conflits sur le lieu de travail
Les agents de probation font souvent état d’un degré élevé de conflits au travail. La majorité des agents interrogés par le ministère de la Justice ont cité les relations avec les superviseurs comme un facteur de stress majeur, principalement pour un bon travail qui n’a pas été reconnu.
Les agents ont également identifié les bas salaires et le manque d’avancement comme d’autres causes de mauvaises relations avec les superviseurs. En mai 2019, les agents de probation gagnaient un salaire médian de 54 290 $, selon le BLS, ce qui ne reflète pas un emploi du temps qui nécessite souvent de nombreux déplacements et une disponibilité sur appel 24 heures sur 24.