InsideOut Dad® – Programme d’éducation parentale
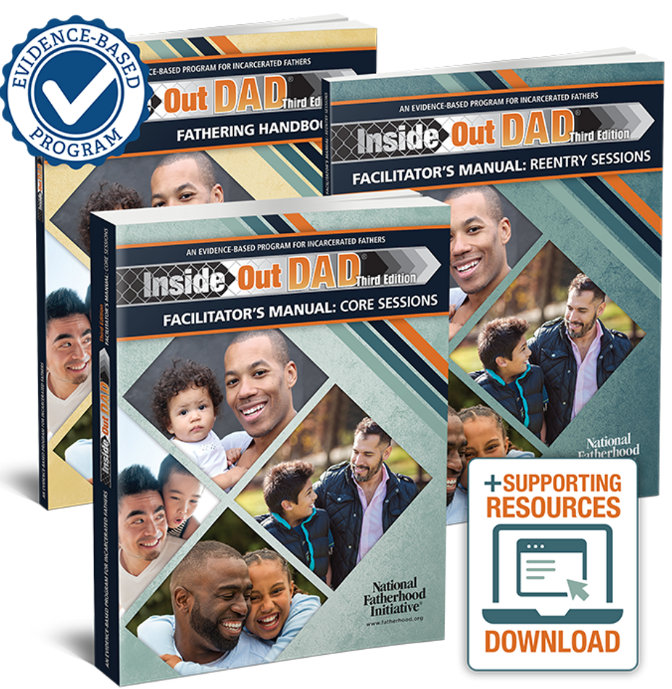 InsideOut Dad® est le seul programme de paternité basé sur des preuves et conçu spécifiquement pour les pères incarcérés. Programme standardisé pour 24 États et la ville de New York, InsideOut Dad® contribue à réduire les taux de récidive en reconnectant les pères incarcérés à leur famille, leur donnant ainsi la motivation nécessaire pour sortir et rester en dehors de la prison.
InsideOut Dad® est le seul programme de paternité basé sur des preuves et conçu spécifiquement pour les pères incarcérés. Programme standardisé pour 24 États et la ville de New York, InsideOut Dad® contribue à réduire les taux de récidive en reconnectant les pères incarcérés à leur famille, leur donnant ainsi la motivation nécessaire pour sortir et rester en dehors de la prison.
Populaire parmi les détenus et les anciens détenus, InsideOut Dad® a prouvé qu’il augmentait les contacts familiaux et améliorait les connaissances et les attitudes des détenus. Des centaines d’établissements fédéraux et d’État, de programmes de préparation à la libération et d’organisations communautaires utilisent ce programme de réinsertion qui change la vie.
Ce programme complet comprend 12 sessions de base et quatre sessions optionnelles qui sont coordonnées avec les sujets de base, ce qui le rend flexible pour une grande variété de programmes. Grâce à un matériel pratique et attrayant, InsideOut Dad® renforce l’estime de soi des détenus et leur permet d’acquérir des compétences relationnelles précieuses.
- Être un homme : Quel genre de père et de mari/partenaire suis-je ?, Rôles du père et de la mère
- Coparentalité et communication : Différences entre les parents, façons de communiquer
- Emotions & Sentiments : Montrer et gérer ses sentiments, le deuil et la perte
- Santé masculine : Stress et colère, santé physique, image corporelle
- Le rôle du père : Le père de l’intérieur, le rôle du père compétitif et non compétitif, les avantages du mariage
- La paternité de l’intérieur : Créer un plan de paternité
- Croissance et discipline des enfants : Objectifs, estime de soi, dialogue avec les enfants, morale, valeurs, récompenses et punitions
- Sessions de réintégration facultatives : La paternité à l’extérieur, les responsabilités et la pension alimentaire, les visites après la libération
- Session facultative sur la spiritualité : Spiritualité, foi et paternité
IoD-3rd_Survey-docs-LearningCenter.pdf
3rd_Edition_IoD_GuideToJails_final.pdf
Learn about the impact InsideOut Dad® has in Utah from the perspective of inmates, probation and parolees, facilitators, corrections facility staff, and the director of programs in the Utah Department of Corrections.


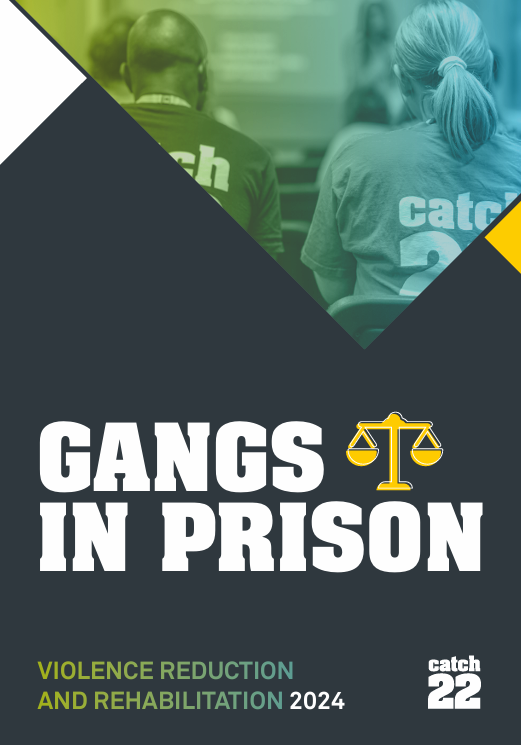
 Le programme pour délinquants à long terme (Long Term Offender Program: LTO) est conçu pour les condamnés à perpétuité et les détenus qui purgent des peines dont la date d’expiration minimale est de 10 ans ou plus.
Le programme pour délinquants à long terme (Long Term Offender Program: LTO) est conçu pour les condamnés à perpétuité et les détenus qui purgent des peines dont la date d’expiration minimale est de 10 ans ou plus.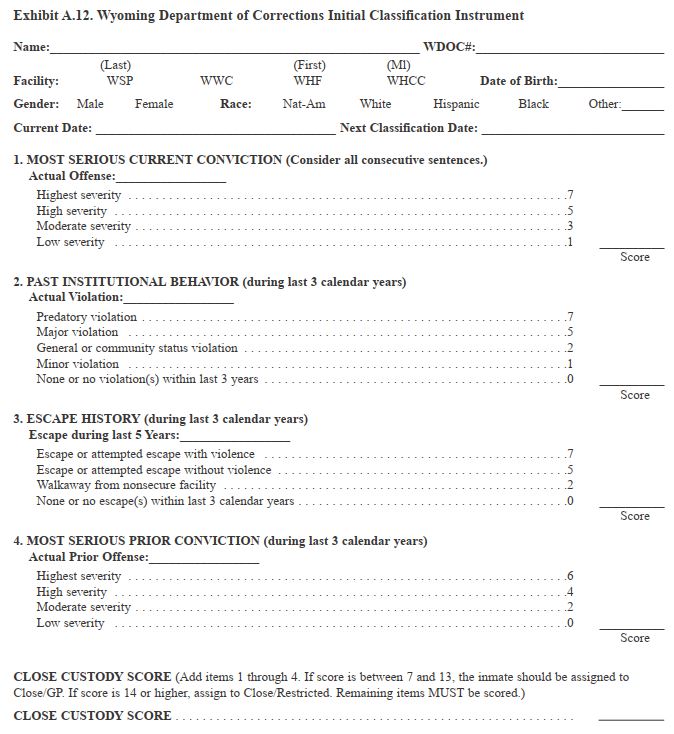
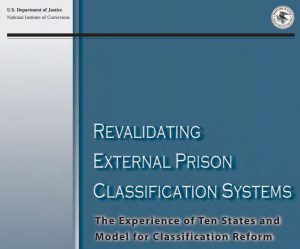
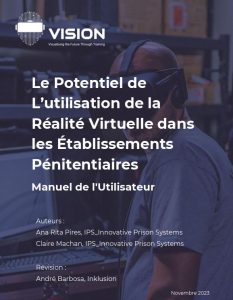



 Les prisonniers dont les liens familiaux sont solides tendent à présenter un taux moins élevé de récidive (Jackie Crawford (2003) “Alternative Sentencing Necessary for Female Inmates With Children” dans Corrections Today June 2003.
Les prisonniers dont les liens familiaux sont solides tendent à présenter un taux moins élevé de récidive (Jackie Crawford (2003) “Alternative Sentencing Necessary for Female Inmates With Children” dans Corrections Today June 2003.
Les objectifs principaux du projet sont les suivants :
1️⃣ Augmenter l’adhésion des personnes détenues aux programmes d’enseignement
et de formation professionnels par le développement de scénarios virtuels liés à l’inscription aux cours et à la motivation
2️⃣ Accroître l’engagement des personnes détenues dans l’enseignement et la formation professionnels.
3️⃣ Accroître leur réussite (préparation des personnes détenues à intégrer le marché
du travail après leur libération, à la réinsertion et à la prévention de la récidive).
4️⃣ Améliorer les compétences des formateurs et des éducateurs intervenant auprès des personnes détenues.