Une approche cognitivo-comportementale éducative de base mobilisable en probation: Le programme « Thinking Matters »
Thinking Matters est conçu comme une approche cognitive et comportementale éducative de base. Cette
approche comblera une lacune qui existe parmi les approches cognitivo-comportementales disponibles.
La plupart des programmes visent à produire un changement de comportement durable chez les
participants. Pour cette raison, ils sont complexes et prennent beaucoup de temps. Ces programmes ont souvent une durée de six mois à deux ans, lorsqu’ils sont dispensés comme prévu. La plupart des programmes tentent d’enseigner plusieurs approches différentes, comme la restructuration cognitive et les habiletés sociales. Ces approches supposent que les participants possèdent une compréhension de base des concepts et des idées sous-jacentes. Ils supposent également que les participants entrent dans le programme avec les compétences nécessaires à la réalisation des activités du programme.Thinking Matters enseigne ces compétences de façon très élémentaire. Comme il s’agit d’un sous-ensemble des compétences nécessaires pour produire un changement à long terme, elles peuvent être enseignées en peu de temps. La plupart des approches enseignent les rapports de pensée comme un élément singulier – dans un ensemble plus vaste.
Thinking Matters enseigne chaque élément des rapports de pensées individuellement. Avant de demander à un participant de créer un « rapport de pensées », on lui apprend à rédiger une description satisfaisante de la situation. On ne leur demande pas de rédiger des rapports de pensée tant qu’ils n’ont pas démontré qu’ils sont capables de rédiger une description satisfaisante de situation. Ils ne sont pas tenus d’adopter une approche axée sur les pensées à risque tant qu’ils n’ont pas démontré avoir acquis les exigences préalables d’un rapport de pensée. Cela rend l’apprentissage des compétences plus facile et plus facile à gérer pour les participants.Deux avantages fondamentaux de Thinking Matters :
- Les participants sont mieux préparés à réussir des approches de programme plus intensifs.
- Les animateurs qui utilisent des approches intensives peuvent s’en tenir aux scripts et aux méthodes du programme avec moins d’écarts et de déviations.
L’enseignement individuel des compétences permet d’acquérir les éléments constitutifs des approches cognitivo-comportementales ultérieures. Thinking Matters enseigne ces compétences en relativement peu de temps. Cela le rend très utile dans les situations où le temps est limité par des facteurs tels que la durée de la peine ou le manque de personnel. Les QSL et les prisons sont des exemples d’endroits où il peut y avoir des limites de temps. Thinking Matters peut être utilisé avec des participants qui n’ont pas les compétences de base requises pour exécuter des programmes plus intensifs.
On peut aussi l’élargir pour l’utiliser comme approche plus intensive en y ajoutant des compétences ou en exigeant des participants qu’ils mettent ces compétences en pratique pendant une période prolongée.
Lien comportements/pensées:
Les gens souhaitent souvent pouvoir changer des comportements improductifs en quelque chose de plus gratifiant et de plus satisfaisant. Malheureusement, beaucoup d’entre nous pensent qu’il faut une volonté et une détermination sans faille pour y parvenir. Cela peut être vrai. Mais ce n’est pas la façon la plus productive de créer un changement durable en nous-mêmes. La volonté peut s’affaiblir avec le temps. Le succès semble lointain lorsque cela se produit. Lorsque nous nous décourageons, il est facile de retomber dans des pensées improductives et des comportements destructeurs.
C’est pourquoi Thinking Matters aborde le changement de soi avec un ensemble de compétences qui peuvent être apprises et pratiquées relativement facilement. Il est difficile de maintenir les changements de comportement si l’on ne comprend pas la pensée spécifique qui conduit à un comportement particulier. Thinking Matters aide les gens à s’entraîner à examiner leur propre façon de penser, à déterminer quelle est la partie qui mène au problème et à choisir d’utiliser une autre façon de penser. Ces compétences aident à développer une saine curiosité envers soi-même, qui devient de plus en plus confortable au fur et à mesure qu’on les pratique.
Souvent, le « problème » de nos comportements n’est pas évident pour nous. Il s’agit généralement de la façon dont nos comportements se reflètent sur nous, façonnent le point de vue des autres et/ou sont en conflit avec les règles/lois ou créent des inconvénients/problèmes pour les personnes qui nous entourent. On a souvent l’impression que les gens doivent modifier leur façon de faire parce qu’ils ne sont pas raisonnables. Le programme « Thinking Matters » aide les gens à devenir plus conscients des thèmes de notre pensée. Si une personne prend conscience qu’elle blâme régulièrement les autres et considère ses associés comme « mauvais », elle peut commencer à remettre en question sa propre façon de voir le monde qui l’entoure. Parfois, les autres ont tort. Mais, est-ce que presque tout le monde a tort si souvent que cela mérite d’être un thème dans nos habitudes de pensée ?
Lien vers le site du programme Thinking Matters: http://thinkingmatters.us/
Extraits:
Un mot de l’auteur:
Bonjour tout le monde,
Je m’appelle Abe French. J’ai commencé à créer Thinking Matters il y a environ 14 ans. A l’époque, je développais et dispensais des programmes cognitivo-comportementaux dans une prison du comté et j’apportais une assistance technique au National Institute of Corrections (NIC). Mon « travail quotidien » était celui d’un gestionnaire de cas au Michigan Department of Corrections (MDOC). Jusque-là, j’avais été agent pénitentiaire et travaillais (principalement) avec des délinquants violents (1987-2000).
Une partie de mon travail (1993-2000) consistait à animer des groupes de « Stratégies pour penser de manière productive » (STP : Strategies for Thinking Productively). Nous utilisions un programme intitulé OPTIONS : A Cognitive Self-Change Program (Dr, John M. (Jack) Bush & Brian Billodeau). Vers 1997, notre établissement (Michigan Reformatory-MR) a également commencé à utiliser Thinking for a Change (T4C). Pendant quelques années, j’ai animé des groupes de délinquants en utilisant les deux modèles. J’ai eu la chance d’avoir été formé par les auteurs Dr. Jack Bush, Dr. Juliana Taymans, Dr. Barry Glick et Steve Swisher. Une formation supplémentaire en communication cognitive et réflexive, en entretien motivationnel et en jeu de rôle a également été dispensée par le MDOC. Je dois mentionner que Brian Billodeau, Mark Gornik, Deena Cheney et Michael Clark comptaient parmi mes formateurs. Ce sont tous des formateurs et des individus de premier ordre. (Merci.)
En 2001, je suis devenu coordinateur des subventions pour l’Office of Community Corrections (OCC). Mon domaine de spécialisation était la programmation cognitivo-comportementale. À ce titre, il m’incombait d’inventorier, de contrôler et de faire des recommandations sur les diverses approches utilisées dans l’ensemble de l’État dans le cadre du financement du MDOC. Au fil du temps, j’ai commencé à remarquer que de nombreuses bonnes approches étaient utilisées et que certaines d’entre elles ne l’étaient pas correctement. C’était généralement dû au fait que les ressources de l’agence et la dynamique logistique ne correspondaient pas bien aux paramètres du programme.
Il en résultait un manque de fidélité entre les directives des auteurs et l’exécution du programme. En réponse à cette situation, j’ai commencé à passer en revue toutes les approches cognitivo-comportementales que je pouvais accumuler. Mon objectif était d’aider les organismes et les individus à choisir des programmes d’études qui combineraient au mieux les ressources de l’organisme et les exigences du programme. Il s’agissait souvent d’expliquer les caractéristiques du programme et de déterminer si l’utilisateur final disposait des ressources nécessaires pour en assurer la fidélité. Nous avons souvent alerté sur des situations où une durée de séjour de 90 jours en prison ne permettait pas d’utiliser une approche calibrée pour 6 ou 12 mois. Souvent, les utilisateurs ne comprenaient pas initialement qu’un programme linéaire est difficile (voire impossible) à utiliser dans un groupe communautaire en milieu ouvert où l’inscription ouverte est une nécessité.
J’ai pris ma retraite du MDOC en 2013. Pendant environ un an, j’ai été le directeur d’un programme résidentiel de toxicomanie. Malheureusement, l’établissement n’a pas pu maintenir le financement des subventions et a fermé. Cela m’a donné assez de temps libre pour travailler davantage sur Thinking Matters, LLC. Depuis lors, je fais plus de formation, d’écriture et de consultation. J’ai appris à concevoir des sites Web et j’ai créé les sites de Thinking Matters pour soutenir notre travail avec les approches cognitivo-comportementales.


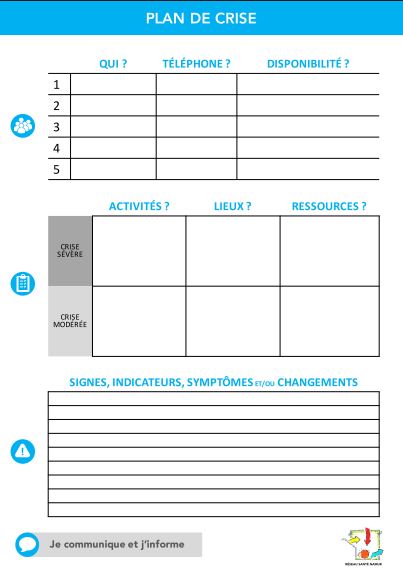

 La décision d’une rétention de sûreté repose en grande partie sur le critère de « dangerosité » qui dépend lui-même d’une évaluation du risque de récidive que présente un condamné. Un tel pronostic, nécessairement aléatoire, requiert l’expertise des psychiatres dont le rôle est alors essentiel et la responsabilité engagée.
La décision d’une rétention de sûreté repose en grande partie sur le critère de « dangerosité » qui dépend lui-même d’une évaluation du risque de récidive que présente un condamné. Un tel pronostic, nécessairement aléatoire, requiert l’expertise des psychiatres dont le rôle est alors essentiel et la responsabilité engagée. FRANCE CULTURE (2009) La parole de l’enfant victime
FRANCE CULTURE (2009) La parole de l’enfant victime