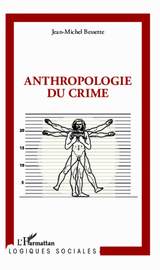 « L’étude du crime – disait Henri Lévy-Bruhl – est un des éléments de première importance pour connaître et mesurer les valeurs courantes dans une société ». Et il est vrai que la sociologie criminelle apparaît dès les débuts de la sociologie, chez Durkheim notamment, qui considérait le crime dans sa relation à la peine, c’est-à-dire par rapport à la réaction sociale qu’il suscite – je cite : « Il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu’il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons ». Et avant lui, Quetelet avait mis en évidence, par l’analyse statistique, ce qu’il appelait une « constante relative de la criminalité », une sorte de taux social du crime, en somme. Si l’on observe la structure sociale des chiffres de la criminalité, les proportions relatives des hommes et des femmes, la surreprésentation des jeunes et des classes populaires, la nature respective des crimes par rapport aux catégories socio-professionnelles, une remarquable stabilité dans le temps vient accréditer cette thèse. L’ambition de Jean-Michel Bessette est donc d’élargir la focale de la sociologie à tous les aspects de ce fait social et d’intégrer à une anthropologie du crime les données statistiques, juridiques et économiques – puisqu’il est prouvé que les crises ou la montée du chômage ont également une influence – mais aussi linguistiques, psychologiques, neurologiques et cognitives.
« L’étude du crime – disait Henri Lévy-Bruhl – est un des éléments de première importance pour connaître et mesurer les valeurs courantes dans une société ». Et il est vrai que la sociologie criminelle apparaît dès les débuts de la sociologie, chez Durkheim notamment, qui considérait le crime dans sa relation à la peine, c’est-à-dire par rapport à la réaction sociale qu’il suscite – je cite : « Il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu’il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons ». Et avant lui, Quetelet avait mis en évidence, par l’analyse statistique, ce qu’il appelait une « constante relative de la criminalité », une sorte de taux social du crime, en somme. Si l’on observe la structure sociale des chiffres de la criminalité, les proportions relatives des hommes et des femmes, la surreprésentation des jeunes et des classes populaires, la nature respective des crimes par rapport aux catégories socio-professionnelles, une remarquable stabilité dans le temps vient accréditer cette thèse. L’ambition de Jean-Michel Bessette est donc d’élargir la focale de la sociologie à tous les aspects de ce fait social et d’intégrer à une anthropologie du crime les données statistiques, juridiques et économiques – puisqu’il est prouvé que les crises ou la montée du chômage ont également une influence – mais aussi linguistiques, psychologiques, neurologiques et cognitives.
(…) Cette répartition socio-professionnelle de la criminalité présente-t-elle également une forme de stabilité à travers le temps ?
C’est un phénomène structurel, un peu comme si chaque catégorie socio-professionnelle secrétait une forme criminelle spécifique, et cette variable conserve une influence majeure, comme dans les viols sur mineurs où le clergé, les instituteurs, mais aussi les contremaîtres, l’armée ou la police se taillent la part du lion, toutes personnes ayant, comme on dit, autorité. Ce sont d’ailleurs les crimes contre les personnes qui sont les plus nombreux, 64%, et parmi eux les viols qui représentent près de la moitié des condamnations, les crimes contre les biens comptant pour 34% de l’ensemble et ceux contre la chose publique 2% seulement.
Parmi d’autres perspectives ouvertes par le regard anthropologique à partir de l’analyse des statistiques, il y a celle qui révèle le lien étroit entre criminalité et degré d’intégration à la société. Par exemple les veufs (y compris ceux qui ont expédié leur compagne dans l’autre monde), les divorcés et les célibataires sont surreprésentés dans la population criminelle, le mariage et la famille étant une norme prépondérante d’intégration. De même, le degré d’exposition aux tensions générées par le monde du travail augmente considérablement la probabilité de se retrouver devant une cour d’assises. C’est ce qui explique la moindre criminalité des apprentis, qui cumulent pourtant deux facteurs globalement favorables : la jeunesse et l’appartenance au monde ouvrier. A bon entendeur, salut (et là je m’adresse aux politiques)
Jacques Munier
Lire la chronique complète sur France culture


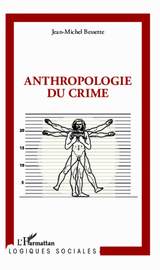 « L’étude du crime – disait Henri Lévy-Bruhl – est un des éléments de première importance pour connaître et mesurer les valeurs courantes dans une société ». Et il est vrai que la sociologie criminelle apparaît dès les débuts de la sociologie, chez Durkheim notamment, qui considérait le crime dans sa relation à la peine, c’est-à-dire par rapport à la réaction sociale qu’il suscite – je cite : « Il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu’il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons ». Et avant lui, Quetelet avait mis en évidence, par l’analyse statistique, ce qu’il appelait une « constante relative de la criminalité », une sorte de taux social du crime, en somme. Si l’on observe la structure sociale des chiffres de la criminalité, les proportions relatives des hommes et des femmes, la surreprésentation des jeunes et des classes populaires, la nature respective des crimes par rapport aux catégories socio-professionnelles, une remarquable stabilité dans le temps vient accréditer cette thèse. L’ambition de Jean-Michel Bessette est donc d’élargir la focale de la sociologie à tous les aspects de ce fait social et d’intégrer à une anthropologie du crime les données statistiques, juridiques et économiques – puisqu’il est prouvé que les crises ou la montée du chômage ont également une influence – mais aussi linguistiques, psychologiques, neurologiques et cognitives.
« L’étude du crime – disait Henri Lévy-Bruhl – est un des éléments de première importance pour connaître et mesurer les valeurs courantes dans une société ». Et il est vrai que la sociologie criminelle apparaît dès les débuts de la sociologie, chez Durkheim notamment, qui considérait le crime dans sa relation à la peine, c’est-à-dire par rapport à la réaction sociale qu’il suscite – je cite : « Il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu’il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons ». Et avant lui, Quetelet avait mis en évidence, par l’analyse statistique, ce qu’il appelait une « constante relative de la criminalité », une sorte de taux social du crime, en somme. Si l’on observe la structure sociale des chiffres de la criminalité, les proportions relatives des hommes et des femmes, la surreprésentation des jeunes et des classes populaires, la nature respective des crimes par rapport aux catégories socio-professionnelles, une remarquable stabilité dans le temps vient accréditer cette thèse. L’ambition de Jean-Michel Bessette est donc d’élargir la focale de la sociologie à tous les aspects de ce fait social et d’intégrer à une anthropologie du crime les données statistiques, juridiques et économiques – puisqu’il est prouvé que les crises ou la montée du chômage ont également une influence – mais aussi linguistiques, psychologiques, neurologiques et cognitives. (…) «On parle des 68.000 détenus enfermés, mais il y a surtout 170.000 condamnés en milieu ouvert suivis par l’administration pénitentiaire», rappelle incidemment un directeur de prison. Des détenus particuliers qui sont pris en charge par les Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), services sur lesquels repose déjà l’essentiel de la politique pénitentiaire.
(…) «On parle des 68.000 détenus enfermés, mais il y a surtout 170.000 condamnés en milieu ouvert suivis par l’administration pénitentiaire», rappelle incidemment un directeur de prison. Des détenus particuliers qui sont pris en charge par les Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), services sur lesquels repose déjà l’essentiel de la politique pénitentiaire. Le meurtre d’Adeline (socio-thérapeute suisse de la pâquerette) a créé une onde de choc dont on ne mesure pas encore la portée. Plusieurs cantons ont décidé de restreindre les sorties de détenus, ce qui touche de nombreux établissements pénitentiaires. Exemple avec la prison de Bellechasse dans le canton de Fribourg.
Le meurtre d’Adeline (socio-thérapeute suisse de la pâquerette) a créé une onde de choc dont on ne mesure pas encore la portée. Plusieurs cantons ont décidé de restreindre les sorties de détenus, ce qui touche de nombreux établissements pénitentiaires. Exemple avec la prison de Bellechasse dans le canton de Fribourg. Là-bas n’aime pas les murs, Là-bas préfère les ponts.
Là-bas n’aime pas les murs, Là-bas préfère les ponts.