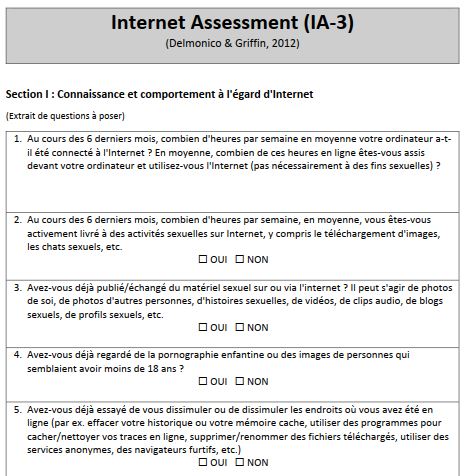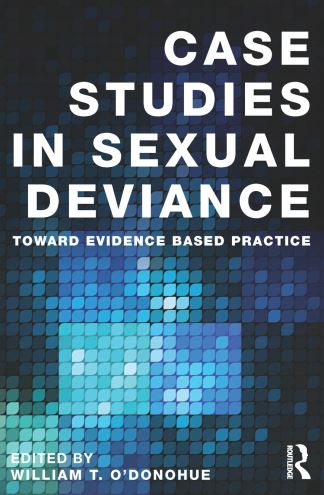« Dans leur ouvrage fondamental combinant une multitude de perspectives théoriques, Small bone, Marshall et Wortley (2008) ont articulé et illustré un modèle de santé publique qui distingue la prévention primaire (ou universelle), secondaire (ou sélectionnée) et tertiaire (ou indiquée). Bien qu’il n’y ait pas d’accord universel sur les distinctions précises entre la prévention primaire, secondaire et tertiaire lorsqu’elle est appliquée à la criminalité, l’idée essentielle est la possibilité que les interventions soient orientées vers la prévention de la violence sexuelle avant qu’elle ne se produise (prévention primaire ou secondaire), ainsi qu’après qu’elle se soit produite pour prévenir d’autres délits et victimisations (prévention tertiaire). En outre, le cadre adopte explicitement un cadre socio-écologique (Krug et al. 2002). Ce cadre situe les délinquants et les victimes dans leur contexte écologique naturel et situe les facteurs de risque et de protection à différents niveaux des systèmes écologiques dans lesquels les individus vivent leur vie.
« Dans leur ouvrage fondamental combinant une multitude de perspectives théoriques, Small bone, Marshall et Wortley (2008) ont articulé et illustré un modèle de santé publique qui distingue la prévention primaire (ou universelle), secondaire (ou sélectionnée) et tertiaire (ou indiquée). Bien qu’il n’y ait pas d’accord universel sur les distinctions précises entre la prévention primaire, secondaire et tertiaire lorsqu’elle est appliquée à la criminalité, l’idée essentielle est la possibilité que les interventions soient orientées vers la prévention de la violence sexuelle avant qu’elle ne se produise (prévention primaire ou secondaire), ainsi qu’après qu’elle se soit produite pour prévenir d’autres délits et victimisations (prévention tertiaire). En outre, le cadre adopte explicitement un cadre socio-écologique (Krug et al. 2002). Ce cadre situe les délinquants et les victimes dans leur contexte écologique naturel et situe les facteurs de risque et de protection à différents niveaux des systèmes écologiques dans lesquels les individus vivent leur vie.
Le cadre qui en résulte nous invite à envisager des cibles pour les interventions dans le but de :
– prévenir la délinquance ou la récidive chez les délinquants (qui, avant d’être délinquants, sont délinquants potentiels)
– empêchent la victimisation ou la revictimisation des enfants
– empêchent une infraction ou une récidive au sein d’une famille ou d’une communauté spécifique, et
– prévenir un incident ou une récidive d’abus sexuel d’enfants dans une situation ou un lieu spécifique ou un lieu spécifique »
Donald Findlater « the role of person and place in preventing child sexual abuse »
Points d’attention pour la prévention du Cadre de référence pour la prévention en matière de délinquance sexuelle
|
Prévention primaire |
Prévention secondaire |
Prévention tertiaire |
|
| Délinquants | – Dissuasion générale
– Prévention développementale |
– Intervention auprès
Des adolescents à risque et des hommes à risque
|
– Détection précoce
– Dissuasion spécifique – Traitement des délinquants et gestion des risques |
| Victimes | – formation à la « Résistance
– Renforcement de la résilience |
– Renforcement de la résilience et autres interventions auprès enfants à risque | – soigner les dommages
– Prévenir la répétition de la victimisation |
| Situations | – réduction des opportunités
– Contrôler les facteurs précipitants – surveillance/tutelle élargie |
– Prévention situationnelle dans les lieux à risque | – Plans de sécurité
– Interventions organisationnelles |
| Systèmes écologiques (environnement et interactions)
|
– Éducation parentale
– Renforcement de la communauté |
– Formation des « témoins »
– Habilitation des tuteurs – Interventions auprès des communautés à risque |
– Interventions auprès des familles « à problèmes », des pairs, des écoles, des agences de services et communautés |