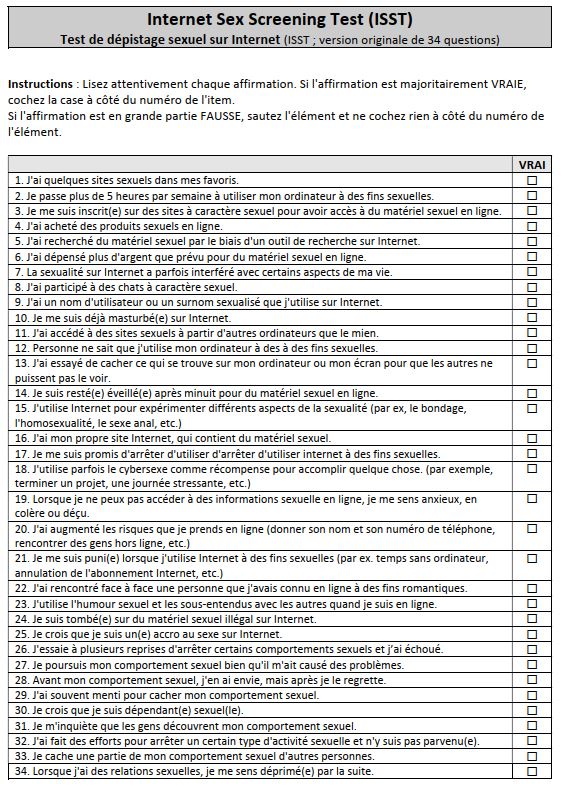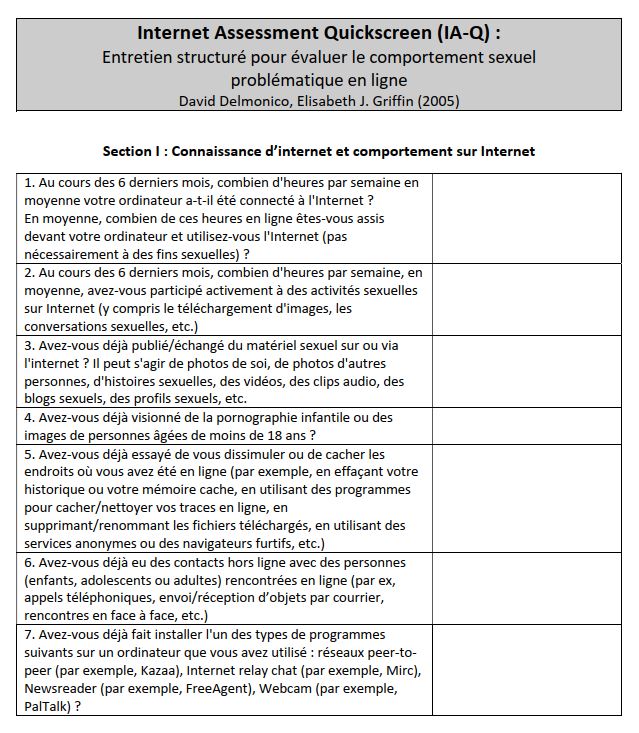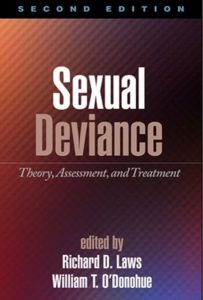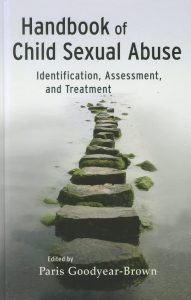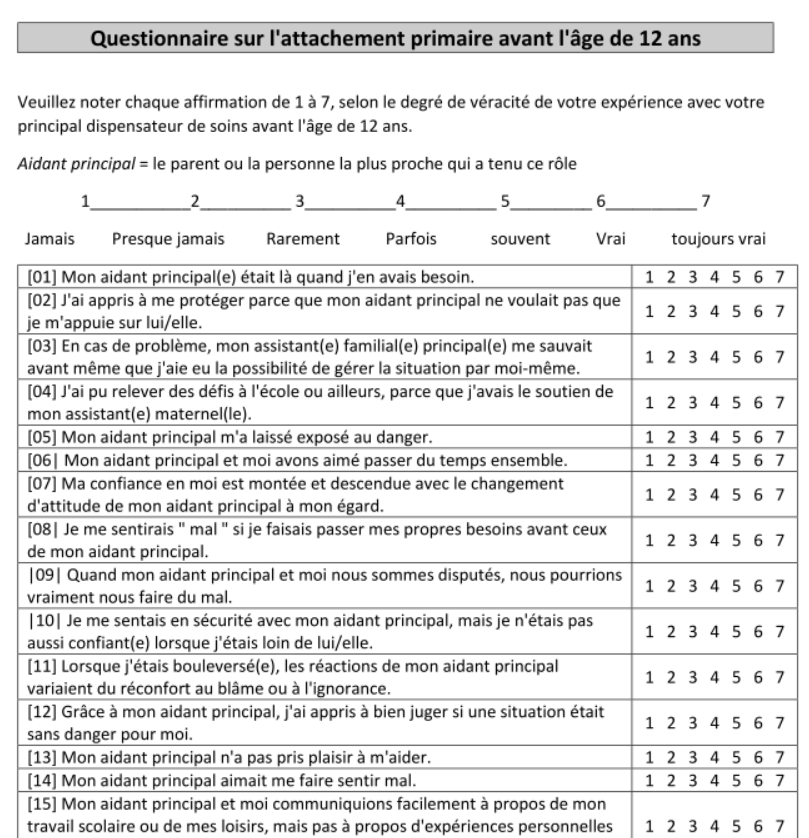Une théorie développementale de la délinquance sexuelle persistante à l’égard des enfants.
Deux trajectoires alternatives vers des tendances antisociales générales sont montrées : une trajectoire persistante au cours de la vie caractérisée par des déficits neurodéveloppementaux et des environnements précoces défavorables, et une trajectoire psychopathique qui n’est pas pathologique.
« Certains délinquants persistants dans leur parcours de vie et certains délinquants limités à l’adolescence sont pédophiles et recherchent des enfants prépubères, persistent à avoir des contacts sexuels avec des enfants et sont plus susceptibles de cibler des garçons que des filles. Les délinquants psychopathes sont moins susceptibles d’être pédophiles et plus susceptibles de rechercher des filles plus âgées (G. T. Harris, 2004).
La probabilité relative de récidiver d’une manière ou d’une autre dépendra de leur antisocialité, tandis que la probabilité de récidive sexuelle dépendra à la fois de l’antisocialité et de la pédophilie (Hanson & Bussiere, 1998 ; Hanson & Morton- Bourgon, 2005 ).
Cette théorie développementale de la délinquance sexuelle à l’égard des enfants s’expliquerait à la fois par la pédophilie et par l’antisocialité.
Les tendances antisociales se reflètent dans le facteur de désinhibition de Finkelhor (1984), les problèmes d’autorégulation de W. L. Marshall et Barbaree (1990), les problèmes de la personnalité de G. C. N. Hall et Hirschman (1992) et les problèmes de régulation émotionnelle de Ward et Siegert (2002).
Cette théorie développementale diffère cependant en se concentrant sur les deux voies de l’antisocialité et de la pédophilie, et en faisant des distinctions entre les trajectoires de vie, et en intégrant explicitement la psychopathie, qui s’est avérée être une explication importante de la criminalité. Comme le montre la figure, il existe deux sources d’antisocialité, l’une étant attribuée à des déficits neurodéveloppementaux et à un environnement précoce défavorable (trajectoire persistante du parcours de vie de Moffitt) et l’autre attribuée à une stratégie de vie stable (psychopathie).
La pédophilie est également associée à des déficits neurodéveloppementaux et à des antécédents d’abus sexuels.Ces deux facteurs augmentent la probabilité de commettre une infraction sexuelle contre un enfant, en conjonction avec des facteurs situationnels tels que l’accès à des enfants potentiellement vulnérables, l’intoxication et l’insatisfaction sexuelle (qu’il s’agisse d’une relation actuelle ou l’absence de relation).
Étant donné que la taxonomie de Moffitt est valable pour la délinquance féminine, cette théorie pourrait expliquer la délinquance sexuelle des femmes ».