Du choc à la solidarité
 Cette première série tentera de baliser, à partir de témoignages, le chemin qui conduit de la passivité à une activité politique ou judiciaire, de la commotion à la raison, de la solitude morale à la solitude active. Ce soir, en compagnie d’Alain Boulay, président fondateur de l’APEV.
Cette première série tentera de baliser, à partir de témoignages, le chemin qui conduit de la passivité à une activité politique ou judiciaire, de la commotion à la raison, de la solitude morale à la solitude active. Ce soir, en compagnie d’Alain Boulay, président fondateur de l’APEV.
Après le crime, la victime. La victime désigne étymologiquement l’animal sacrifié, symbole de passivité absolue, et exprime aujourd’hui la condition de celui qui est affecté par la violence du crime. La condition de victime consiste en effet toujours en une diminution d’être. La blessure risque de devenir ontologique et de se transmettre de génération en génération. C’est pourquoi la victime renvoie à deux réalités : à des personnes affectées directement dans leur chair et leur esprit mais aussi à des groupes victimes d’injustices historiques. Dans le premier cas, elle ouvre droit à une réparation juridique, dans le second elle offre une ressource politique. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de consacrer deux semaines à la question de la victime en examinant comment l’on passe d’une réalité brute, brutale, dévastatrice à une signification sociale et politique.
Cette première série tentera de baliser, à partir de témoignages, le chemin qui conduit de la passivité, qui réduit au silence, à une activité politique ou judiciaire, de la commotion à la raison, de la solitude morale à la solidarité active. Ce parcours s’articule autour d’un moment de justice qui agit comme opérateur de vérité, fixateur de mémoire et convertisseur du temps. Du temps vif du ressentiment, la victime peut connaître le temps apaisé du souvenir, le déni de son existence faisant place à une reconnaissance du tort.
Il n’était pas possible de commencer cette première semaine autrement qu’en donnant la parole à une victime ; en l’occurrence à Alain Boulay, un père dont la fille a été assassinée et qui a fondé, avec sa femme, l’association Aide aux Parents d’Enfants Victimes pour aider les parents ayant connu le même sort et faire reconnaître dans les institutions pénales la juste place de la victime, ni toute-puissante, ni infantilisée.
Ce qu’on a voulu, c’était réfléchir à ce qui nous était arrivé. Autant on le faisait par rapport à la victime, ce qu’elle pouvait ressentir, autant je l’ai fait par rapport aux institutions, parce qu’on se disait : « Est-ce que les institutions répondent vraiment aux besoins des victimes ? », « Est-ce que la justice répond aux besoins des victimes ? ». Et très vite on s’est rendus compte que la justice n’était pas faite pour les victimes, elle était faite pour les auteurs. (…) On voulait que la justice s’intéresse aussi aux victimes. (Alain Boulay)
Les attentats ont énormément fait changer les choses. Mais, tout de même, on a eu, fin des années 90, début des années 2000, beaucoup de réflexions sur les agressions sur enfants, sur la pédophilie, sur les viols. Il y a eu beaucoup de choses (campagnes sur les femmes battues), qui ont fait prendre conscience à la société, aux magistrats, aux policiers, de toutes ces victimes et de ce qu’elles pouvaient vivre. (Alain Boulay)
>>> Site de l’APEV
Extrait musical choisi par l’invité : « Le Monde est Stone » interprété par Fabienne Thibeault « Starmania » (1978).
Réparer les corps
Cette première série tentera de baliser, à partir de témoignages, le chemin qui conduit de la passivité à une activité politique ou judiciaire, de la commotion à la raison, de la solitude morale à la solitude active. Ce soir, avec le docteur Neema Rukunghu, chirurgienne à l’hôpital Panzi en RDC.
Aussi bien dans l’ex-Yougoslavie que dans l’Afrique des grands lacs, nombre de théâtres de conflits actuels le démontrent : le corps de la femme est devenue une arme de guerre. Par leurs viols, les miliciens non seulement saccagent des corps mais détruisent le corps social. La violence sexuelle n’a plus rien à voir avec le plaisir de soudards mais elle est administrée à des fins stratégiques. Le docteur Nadine Neema Rukunghu, chirurgienne pratiquant dans un hôpital dans l’est de la République démocratique du Congo, répare les corps des survivantes mais aussi les accompagne jusqu’au retour dans leur communauté.
Le corps de la femme est considéré comme une arme, c’est un terrain de bataille, les gens se battent sur le corps de la femme. (…) Violer une femme, une mère, le chef parfois, devant toute sa tribu, toute sa communauté, (…) c’est détruire tout le tissu social, complètement, et donc forcer cette population à fuir, à être nulle. (…) C’est stratégique, c’est étudié pour que les impacts aient des conséquences qui sont parfois pareilles que celles des armes lourdes, parfois même plus fortes car ce sont des choses qui vont continuer de génération en génération. (Dr. Neema Rukunghu)
Survivre après le 13 novembre
Cette première série tentera de baliser, à partir de témoignages, le chemin qui conduit de la passivité à une activité politique ou judiciaire, de la commotion à la raison, de la solitude morale à la solitude active. Ce soir, avec Arthur Dénouveaux, président de l’association Life for Paris.
Les attentats du 13 novembre ont suscité nombre d’associations comme Life for Paris, que préside actuellement Arthur Dénouveaux et dont le but est d’aider à survivre à un attentat ; car le goût de la vie, de la musique, de la diversité est le meilleur démenti apporté à ceux qui portent la mort en eux.
Finalement, il y a un grand détachement vis-à-vis de toutes ces questions militaires, et politiques, sur la manière dont le terrorisme se combat. Pour nous, le combat c’est nous, c’est de revivre, et c’est un « nous » qui englobe toute la société : comment est-ce que « nous » (on) se rediffuse au milieu de tout le monde. (Arthur Dénouveaux)
Quand vous vous retrouvez à la première réunion avec les juges d’instruction, des parents posent des questions sur la manière dont est mort leur enfant. Le juge répond : « Écoutez, moi, j’ai les auteurs, j’enquête sur les causes, les circuits de financement, je ne m’attache pas aux causes précises de chacun, vous pouvez aller voir le rapport d’autopsie ». Le juge, ce faisant, est probablement dans son rôle. Mais les victimes sont en droit d’attendre des réponses, et il manque sûrement un lieu d’échange entre l’État, qui sait beaucoup de choses, et les victimes, les parents de victimes, qui en savent très peu. (Arthur Dénouveaux)
De la défiance à la reconnaissance
Cette première série tentera de baliser, à partir de témoignages, le chemin qui conduit de la passivité à une activité politique ou judiciaire, de la commotion à la raison, de la solitude morale à la solitude active. Ce soir, en compagnie de Denis Salas, magistrat et essayiste.
Les juges ont d’abord montré une certaine défiance à l’égard des victimes dans lesquelles ils voyaient des trouble-fête dans un processus déjà délicat. Parce que la victime est paradoxalement menacée aujourd’hui d’une protection mal placée, trop intéressée par des politiques par exemple. D’où un nouveau mandat donné à l’institution judiciaire pour travailler avec elles, entendre leur plainte, et repenser les fondamentaux de l’audience. C’est le défi qu’analyse Denis Salas dans son dernier livre (La foule innocente, Desclée de Brouwer, 2018).
Très souvent quand il y a une non-réponse à la violence, ou un excès de réponse à la violence, (…) les victimes n’ont plus d’espace de reconnaissance, de parole judiciaire où ils peuvent exprimer une plainte. Et à ce moment-là, le récit littéraire devient le lieu où ils vont déposer cette plainte. (…) La littérature fait partie de cette audience que les victimes attendent pour qu’on leur rende justice. (Denis Salas)
- A propos de terroristes lors de leur procès :
Ils prennent la parole, ils s’expriment, ils se défendent, ils minimisent souvent leurs actes ; ils connaissent leurs droits, ils savent protester. Ce jeu-là, ils l’utilisent, ils entrent à l’intérieur (de ce jeu), et c’est peut-être une première étape pour les désolidariser de leur groupe d’appartenance et de leur idéologie salafiste. (Denis Salas)
Choix musical de l’invité : « Imagine » de John Lennon
Victimes et mémoire
Cette première série tentera de baliser, à partir de témoignages, le chemin qui conduit de la passivité à une activité politique ou judiciaire, de la commotion à la raison, de la solitude morale à la solitude active. Ce soir, avec Denis Peschanski, historien, directeur de recherche au CNRS.
Les crimes de masse « qu’on ne peut ni juger, ni pardonner » ont donné lieu à un travail de mémoire spécifique. L’historien Denis Peschanski a fait de la mémorialisation son objet d’études en se penchant d’abord sur la mémoire de la société française de la Seconde Guerre Mondiale. Il travaille aujourd’hui à un projet de grande ampleur sur les victimes des attentats du 13 novembre en montrant ce que les neurosciences peuvent apporter à la compréhension du psycho-trauma des victimes.
En Normandie, en trois mois, vous avez eu bien plus de morts et de destructions que la région en a connues pendant toute l’occupation. Avec un très léger problème, c’est que les bombes étaient larguées par les copains qui venaient vous libérer. (…) Ca n’a aucun sens. Aucune utilité sociale. On ne peut pas en donner de récit qui soit intégrable dans une mémoire collective de la société française. Ce qui fait que vous avez une sorte de terrible opposition entre un choc individuel très profond dans toutes les familles normandes (…) et l’absence de prise en charge par le collectif, par l’Etat. Et cette tension-là est assez dramatique. (Denis Peschanski)
Je me dis, avançons une hypothèse, (…) qui va devenir un guide pour les années de recherche qui vont suivre (…) : il est impossible de comprendre pleinement ce qui se passe dans les mémoires collectives si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales des mémoires individuelles, et inversement, il est impossible de comprendre pleinement ces dynamiques de la mémoire si on ne prend pas en compte l’impact du social. (Denis Peschanski)





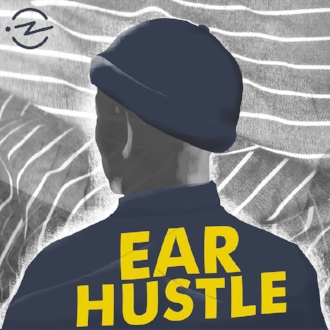




 Le crime de masse résulte d’une inversion monstrueuse de la légalité : la souveraineté non seulement ne protège plus mais devient meurtrière, massacrant une partie de son peuple, le tiers de justice se fait partisan voire bourreau lui-même. Comment s’en relever ?
Le crime de masse résulte d’une inversion monstrueuse de la légalité : la souveraineté non seulement ne protège plus mais devient meurtrière, massacrant une partie de son peuple, le tiers de justice se fait partisan voire bourreau lui-même. Comment s’en relever ? Lorsque le crime est organisé, chaque acte risque de perdre sa transgressive. Il risque d’être perçu comme produisant paradoxalement un certain ordre répondant à une légalité para-politique, un « sotogoverno » qui brouille toute référence à la justice.
Lorsque le crime est organisé, chaque acte risque de perdre sa transgressive. Il risque d’être perçu comme produisant paradoxalement un certain ordre répondant à une légalité para-politique, un « sotogoverno » qui brouille toute référence à la justice. Que se passe-t-il dans la tête d’un criminel ? Tentative d’explication avec Michel Dubec, psychiatre et psychanalyste, devenu expert auprès des tribunaux. Pendant un quart de siècle, il a côtoyé les pires meurtriers, de Carlos à Guy Georges…
Que se passe-t-il dans la tête d’un criminel ? Tentative d’explication avec Michel Dubec, psychiatre et psychanalyste, devenu expert auprès des tribunaux. Pendant un quart de siècle, il a côtoyé les pires meurtriers, de Carlos à Guy Georges…