Cobras et Pitbulls – Les hommes qui battent leurs femmes
Dans leur livre, When Men Batter Women (1998), les docteurs Jacobson et Gottman décrivent la violence conjugale comme « une agression physique ayant pour but de contrôler, d’intimider, et d’assujettir un autre être humain ». Les coups s’accompagnent toujours de blessures et sont pratiquement toujours associés à la peur, voire à la terreur, de la part de la femme battue ».
Connaître les motivations d’un agresseur peut aider à déterminer si une relation abusive peut être sauvée ou si elle est irrécupérable.
Les docteurs Jacobson et Gottman ont constaté que les agresseurs ont tendance à se classer dans l’une des deux catégories suivantes: les Pitbulls (hommes dont les émotions explosent rapidement, qui ne sont pas sûrs d’eux et qui ont une dépendance malsaine à l’égard des femmes qu’ils maltraitent) ou les Cobras (des hommes qui sont froids et ont le sens du calcul lorsqu’ils infligent douleur et châtiment à leurs victimes).
Au cours de leur étude, Jacobson et Gottman ont confirmé qu’il n’y a rien qu’une femme battue puisse faire pour mettre fin à la violence, et une fois que cela a commencé, cela s’arrête rarement, même si l’agresseur suit un programme de traitement.
En général, lorsque la violence physique diminue ou s’arrête, elle est simplement remplacée par des menaces verbales et de la violence psychologique. Ce type de violence ne laisse pas de traces et n’est pas contraire à la loi, mais il fonctionne parce qu’il effraie les femmes battues autant que la violence physique. Il est particulièrement utile aux agresseurs car ils peuvent contrôler leurs victimes en les menaçant et en leur rappelant verbalement qu’elles ont déjà été battues, tout en évitant d’avoir des ennuis avec la justice.
Le tableau suivant décrit les principales différences entre les Cobras et les Pitbulls.
Bien qu’il y ait des différences notables, les deux sont très dangereux et imprévisibles.
|
Cobras |
Pittbulls |
| Calme à l’intérieur tout en frappant ; froid et calculateur ou explosions incontrôlées | S’excite intérieurement (la colère augmente) au fur et à mesure que les coups se poursuivent |
| Traits criminels évidents, violence envers les autres, peu ou pas de remords | Habituellement, il n’est violent qu’à l’égard de son partenaire. Ressent un certain degré de culpabilité, mais blâme généralement le partenaire |
| Pas de peur de l’abandon, mais un besoin désespéré de contrôle ; engagements superficiels | Dépendance émotionnelle à l’égard du partenaire, fréquemment jaloux, paranoïaque et obsessionnel |
| Motivé par le désir de gratification et de contrôle immédiats | Motivé par la peur d’être abandonné et besoin de contrôle |
| Frappe vite et fort en combinaison avec une agressivité et de la violence psychologique, mais peut se distraire après le départ de la victime | Frappe fort et refuse de lâcher prise ; Traque souvent la victime pendant des années après son départ |
| Plus difficile à quitter au début, mais plus sûr à long terme .
Sait comment tromper les policiers, les juges et les thérapeutes en disant ce qu’il faut. Justifie le fait de battre sa femme pour lui apprendre qu’il a le contrôle |
Plus facile à quitter au départ, mais plus dangereux à long terme
Se sent victime et croit que sa femme est l’auteur des faits Ressent une certaine culpabilité, mais reproche à sa femme de lui avoir fait perdre son sang-froid. |
| Prend le contrôle par une violence féroce ou une colère explosive
Le contrôle signifie être laissé seul et ne pas se faire dire ce qu’il faut faire par une femme Résiste aux règles du ménage et à la participation intime ; refuse de faire des changements personnels |
Gagne le contrôle par l’isolement et le contrôle de l’esprit ; nie l’expérience de la réalité de la femme jusqu’à ce qu’elle doute de sa propre santé mentale
Contrôler signifie prendre le contrôle de la vie d’une femme, en surveillant ses activités, et la transformer en marionnette Exigent des changements de la part de leur partenaire, mais ne sont jamais satisfaits de leurs partenaires peu importe leurs efforts ; évite le changement pour eux-mêmes |
| Très effrayant, mais captivant et charmant. tactiques de contrôle et d’intimidation très efficaces
Se sent supérieur aux autres et au-dessus de la loi La violence est généralement plus grave, avec des armes et des menaces de mort Plus violent sur le plan émotionnel au départ
Antécédents traumatiques impliquant des violences de la part de plusieurs membres de la famille Plus gravement violent dans une relation active Très rarement, voire jamais, aidés par des thérapies ou des programmes destinés aux agresseurs. |
Charmant ; personnalité de type Dr. Jekyll et Mr. Hyde; utilise la violence et le et le piégeage pour contrôler
Se sent victime ; souvent déprimé ; rationalise ses actes en rejetant la faute sur les autres Capable de brutalité chronique et sauvage Devient violent sur le plan émotionnel à mesure qu’il devient plus enragé Un peu de violence à la maison, le père étant souvent un agresseur Plus gravement violent après la séparation ou le divorce Parfois aidé par des thérapies et des programmes pour les agresseurs |
CobrasAndPitBulls.pdf (focusministries1.org)
Selon Stith et al. (2012), non seulement le contexte relationnel de la violence varie, mais les caractéristiques des personnes violentes ne sont pas les mêmes. On s’accorde de plus en plus à dire qu’il existe deux types d’hommes auteurs de violence : ceux qui sont décrits comme « caractérologiques » et ceux qui sont décrits comme situationnels. Pour les auteurs caractériels, la violence fait partie d’un effort global de domination et de contrôle d’une partenaire. Les auteurs situationnels, quant à eux, ont tendance à se trouver dans des relations où la violence est plus susceptible d’être réciproque et où la violence sert à exercer un contrôle sur des interactions spécifiques, plutôt que de s’inscrire dans un schéma global de domination.
On suppose que la VIF situationnelle est la forme la plus répandue de violence relationnelle. En fait, l’étude de John Gottman et Neil Jacobson (1998) sur les VIF, menée pendant 10 ans auprès de 200 couples, a révélé que 80 % des VIF est d’origine situationnelle et 20 % seulement d’origine caractérielle. Les rapports de police confirment ces estimations de 89%/20%. Les incidents caractériels attirent (à juste titre) l’attention des médias et ce sont les victimes de VIF caractérielle qui se présentent dans les refuges, mais la grande majorité de la VIF est situationnelle.
En ce qui concerne la violence situationnelle, Gottman et Jacobson (1998) ont constaté qu’aucun des couples victimes de violence situationnelle ne s’est livré à une escalade de la violence domestique caractérielle. Ils ont également constaté que la VIF situationnelle n’implique pas de contrôle ou de domination et que l’auteur de la violence fait preuve de remords, comprend l’impact, intériorise le blâme et souhaite sincèrement changer. Ils ont également constaté que la violence était réciproque et qu’il n’y avait pas clairement d’auteur ou de victime.
La théorie de Gottman et Jacobson sur la VIF situationnelle est la suivante : 1) un manque de compétences sociales dans l’expression des besoins et la gestion des conflits conduit à une escalade, et 2) l’inondation ou l’excitation physiologique diffuse (Diffuse Physiological Arousal (DPA) ) joue un rôle majeur dans l’escalade vers la violence physique. Par conséquent, les couples souffrant de violence situationnelle peuvent bénéficier de l’apprentissage de compétences sociales pour exprimer leurs besoins et mieux gérer les conflits. L’inondation, ou DPA, est la réponse physiologique à une menace perçue ou à une attaque qui conduit à une réaction de lutte, de fuite ou d’immobilisation. Les couples souffrant de violence situationnelle peuvent également tirer profit de l’apprentissage de l’identification de l’inondation, de la pause et de l’auto-apaisement physiologique.
Gottman et Jacobson ont constaté qu’il existe deux types d’hommes auteurs de violence caractérielle : Les « Pit Bulls » et les « Cobras ». Les Cobras sont typiquement violents dans tous les aspects de la vie ; les Pit Bulls sont typiquement violents uniquement envers leur partenaire intime. Les victimes des refuges sont pour la plupart des victimes de Pit Bulls ou de Cobras.
Les Pitbulls ont une grande peur de l’abandon et sont extrêmement jaloux. Ils se méfient de l’indépendance de leur partenaire et essaient de l’isoler socialement. Ils sont dominateurs, condescendants et donnent des leçons. Ils mènent la danse avec leur front lorsqu’ils s’adressent à leur victime. Leur colère augmente progressivement, devenant de plus en plus belliqueuse et méprisante. Leur pouls augmente lentement avec la colère et est élevé lorsqu’ils frappent.
Les cobras sont violents dans les relations en dehors du couple. Ils utilisent la peur et l’intimidation pour obtenir le pouvoir et le contrôle. Ils mènent la danse avec leur menton lorsqu’ils parlent à leur victime. Ils commencent par être très belliqueux, provocateurs et dominateurs. Ils ont d’emblée l’air menaçant et ne semblent pas calmes. Il est intéressant de noter que leur rythme cardiaque diminue avant qu’ils ne frappent, de sorte qu’ils sont le plus calmes au moment où ils frappent. Ils peuvent être charmants, très manipulateurs et séducteurs. Ils peuvent utiliser des armes pour menacer leurs victimes et les surprennent souvent. Ils ne montrent aucun remords.
Situational vs. Characterological Intimate Partner Violence – Happy Couples Healthy Communities


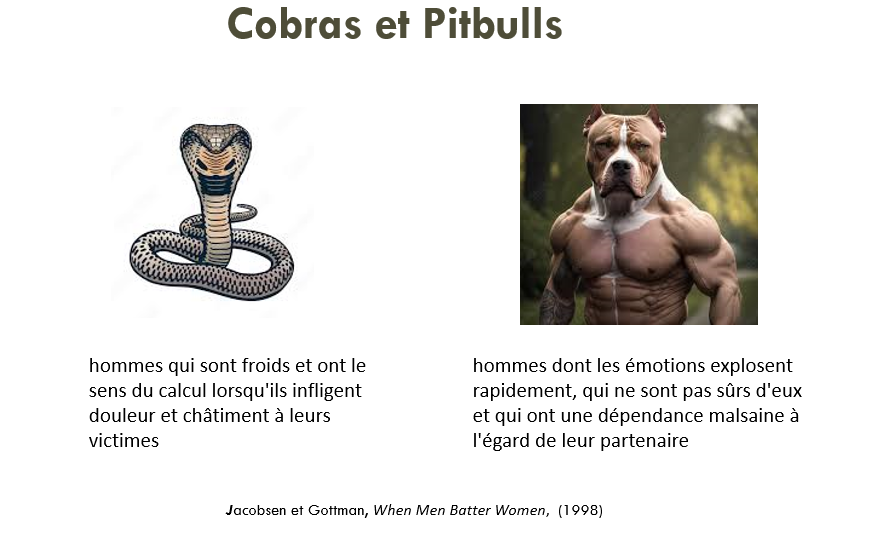
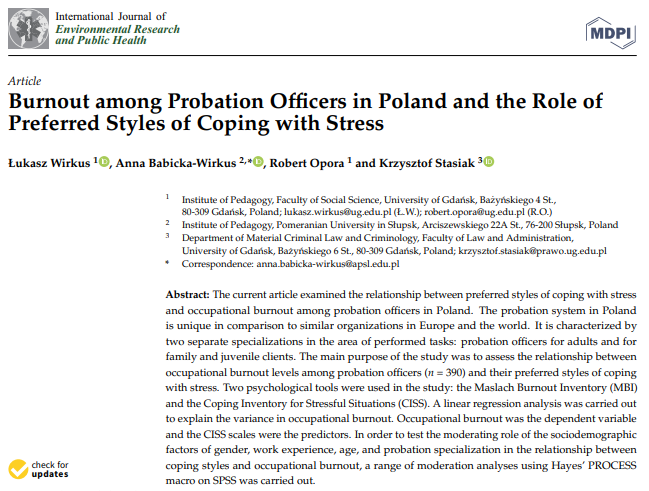
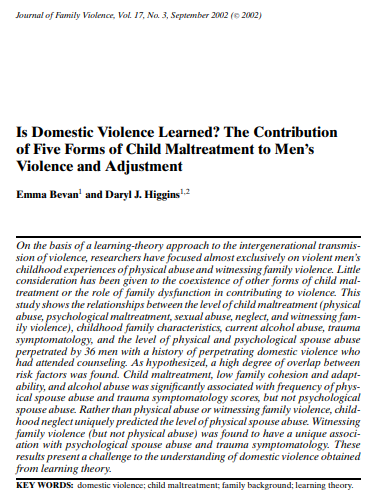 Sur la base d’une approche de la transmission intergénérationnelle de la violence fondée sur la théorie de l’apprentissage, les chercheurs se sont concentrés presque exclusivement sur les expériences de l’enfance des hommes violents où ils ont subi des violences physiques et ont été témoins de violences familiales. Peu d’attention a été accordée à la coexistence d’autres formes de maltraitance infantile ou au rôle des dysfonctionnements familiaux qui ont contribué à la violence. Cette étude montre les relations entre le niveau de maltraitance de l’enfant (violence physique, psychologique, sexuelle, négligence et témoin de violence familiale), les caractéristiques de la famille pendant l’enfance, l’abus actuel d’alcool, la symptomatologie des traumatismes et le niveau de violence physique et psychologique à l’égard de la conjointe perpétrées par 36 hommes ayant des antécédents de violence domestique et ayant suivi des séances de conseil. Comme nous l’avions supposé, un degré élevé de chevauchement entre les facteurs de risque a été constaté. Les mauvais traitements infligés aux enfants, le manque de cohésion et d’adaptabilité de la famille et l’abus d’alcool ont été associés de manière significative à la fréquence de la violence physique à l’égard de la conjointe et aux scores de symptomatologie traumatique, mais pas à la violence psychologique à l’égard de la conjointe. Plutôt que la violence physique ou le fait d’être témoin de violence familiale, c’est la négligence pendant l’enfance qui permet de prédire le niveau de violence physique à l’égard du conjoint. Le fait d’être témoin de violence familiale (mais pas d’avoir subi des violences physiques) s’est avéré avoir une association unique avec la violence psychologique à l’égard du conjoint et la symptomatologie traumatique.
Sur la base d’une approche de la transmission intergénérationnelle de la violence fondée sur la théorie de l’apprentissage, les chercheurs se sont concentrés presque exclusivement sur les expériences de l’enfance des hommes violents où ils ont subi des violences physiques et ont été témoins de violences familiales. Peu d’attention a été accordée à la coexistence d’autres formes de maltraitance infantile ou au rôle des dysfonctionnements familiaux qui ont contribué à la violence. Cette étude montre les relations entre le niveau de maltraitance de l’enfant (violence physique, psychologique, sexuelle, négligence et témoin de violence familiale), les caractéristiques de la famille pendant l’enfance, l’abus actuel d’alcool, la symptomatologie des traumatismes et le niveau de violence physique et psychologique à l’égard de la conjointe perpétrées par 36 hommes ayant des antécédents de violence domestique et ayant suivi des séances de conseil. Comme nous l’avions supposé, un degré élevé de chevauchement entre les facteurs de risque a été constaté. Les mauvais traitements infligés aux enfants, le manque de cohésion et d’adaptabilité de la famille et l’abus d’alcool ont été associés de manière significative à la fréquence de la violence physique à l’égard de la conjointe et aux scores de symptomatologie traumatique, mais pas à la violence psychologique à l’égard de la conjointe. Plutôt que la violence physique ou le fait d’être témoin de violence familiale, c’est la négligence pendant l’enfance qui permet de prédire le niveau de violence physique à l’égard du conjoint. Le fait d’être témoin de violence familiale (mais pas d’avoir subi des violences physiques) s’est avéré avoir une association unique avec la violence psychologique à l’égard du conjoint et la symptomatologie traumatique.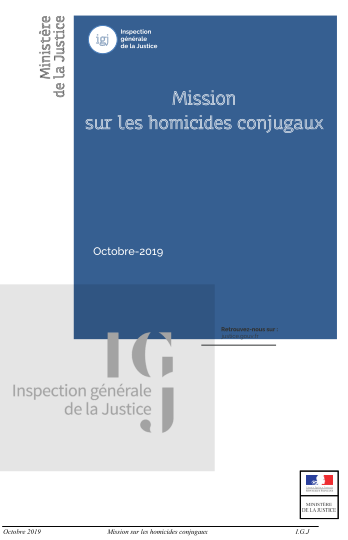
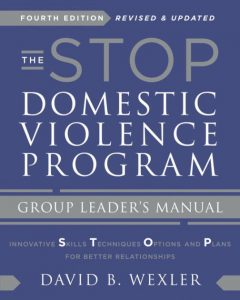

 Le stress est un élément normal et naturel de la vie. Mais pourquoi certaines personnes gèrent-elles bien le stress et développent-elles une résilience, alors que d’autres semblent éprouver des difficultés ? D le Dr Bruce Perry explore l’impact du stress et des traumatismes sur le cerveau et l’effet qui en résulte sur l’apprentissage. Ses enseignements ont aidé des écoles à réduire considérablement les problèmes de comportement et à créer des environnements d’apprentissage sûrs.
Le stress est un élément normal et naturel de la vie. Mais pourquoi certaines personnes gèrent-elles bien le stress et développent-elles une résilience, alors que d’autres semblent éprouver des difficultés ? D le Dr Bruce Perry explore l’impact du stress et des traumatismes sur le cerveau et l’effet qui en résulte sur l’apprentissage. Ses enseignements ont aidé des écoles à réduire considérablement les problèmes de comportement et à créer des environnements d’apprentissage sûrs.