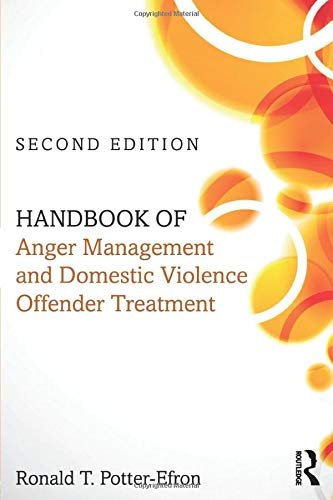Violence conjugale: utiliser le schéma « la maison des abus » (House of Abuse) de Michael F. McGrane
Violence conjugale: utiliser le schéma « la maison des abus » (House of Abuse) de Michael F. McGrane
Le schema « House of Abuse » a été élaboré par Michael F. McGrane, MSW, LICSW, directeur du Violence Prevention & Intervention Services (VPIS) de la Fondation Amherst H. Wilder. Le schema est à retrouvé dans l’ouvrage de M Mc Grane intitulé « the house of abuse, understanding violence in the home ».
Le schéma « la maison des abus » fait également partie d’un programme complet sur la violence domestique intitulé Foundations for Violence-Free Living: A Step-by-Step Guide to Facilitating Men’s Domestic Abuse
Groups, disponible auprès de Fieldstone Alliance. publication du Family Violence Prevention Fund intitulée Domestic Violence: A National Curriculum for Family Preservation Practitioners, rédigé par Susan Schecter, MSW, et Anne L. Ganley, PhD
L’objectif principal de ce diagramme est de montrer comment l’agresseur, qui manque d’estime de soi et de confiance, utilise le pouvoir et le contrôle pour abuser de son partenaire. Chaque pièce du schéma de la maison des abus représente une forme d’abus que l’agresseur utilise. Il s’agit notamment de formes subtiles de manipulation allant jusqu’à la violence physique. Aucune de ces formes n’est acceptable dans une relation saine. Les abuseurs utilisent le pouvoir et le contrôle pour construire leur maison de l’abus afin d’obtenir la supériorité dans leurs relations au prix de la peur, du contrôle et de la soumission de leur partenaire.
La section la plus importante du diagramme est la fondation, qui représente les sentiments de l’agresseur, tels que l’insuffisance, l’insécurité et la faible estime de soi. Le fondement est la base du contrôle.
L’objectif principal de l’agresseur est d’obtenir du pouvoir et du contrôle sur son partenaire, car il pense pouvoir gérer ses propres sentiments de cette manière. L’agresseur pense que s’il peut manipuler et contrôler son partenaire, son sentiment d’inadéquation disparaîtra.
Les huit pièces principales (tactiques d’abus) de la maison sont les suivantes :
- Abus religieux: Citations de la Bible – C’est ici que l’agresseur cite des versets bibliques pour abuser et démoraliser son/sa partenaire. Il le/la rejette en le culpabilisant et en lui faisant honte, et il utilise la persécution religieuse pour minimiser son estime de soi et le contrôler.
- Privilège masculin: « La maison d’un homme est son château » – L’homme violent démoralise sa partenaire féminine parce qu’il pense que le fait d’être une femme la rend inférieure. Il pense que puisqu’il est né homme, il est supérieur aux femmes. Les hommes machos vivent dans cette pièce. Leurs structures de croyances masculines sont synonymes de conceptions sociétales patriarcales.
- Abus sexuels : Refus d’accorder des relations sexuelles à son partenaire – L’agresseur utilise le sexe comme un outil pour revendiquer sa domination sur son partenaire.
 Les infidélités: L’agresseur multiplie les liaisons pour asseoir sa domination et faire en sorte que sa partenaire se sente inadéquate. Il trompera sa partenaire, puis la blâmera pour cette tromperie. Il dira à sa partenaire que c’est de sa faute ou que c’est elle qui l’a poussé à le faire. Il peut s’agir de phrases telles que : « Si seulement tu me faisais l’amour plus souvent, je n’aurais pas à te tromper ».
Les infidélités: L’agresseur multiplie les liaisons pour asseoir sa domination et faire en sorte que sa partenaire se sente inadéquate. Il trompera sa partenaire, puis la blâmera pour cette tromperie. Il dira à sa partenaire que c’est de sa faute ou que c’est elle qui l’a poussé à le faire. Il peut s’agir de phrases telles que : « Si seulement tu me faisais l’amour plus souvent, je n’aurais pas à te tromper ».
- Violence verbale et psychologique: Injures – L’agresseur utilise des termes désobligeants ou fait sentir à son conjoint qu’il n’est pas à la hauteur. Il peut s’agir de phrases comme « Tu es une merde et tu ne vaux rien ». Crier – L’agresseur utilise sa voix pour intimider ou effrayer sa partenaire. Le dénigrement – L’agresseur rabaisse sa partenaire et lui donne l’impression qu’elle ne vaut rien ou qu’il n’est pas à la hauteur. Il peut par exemple lui dire qu’il ne peut jamais rien faire de bien et qu’il est pathétique et sans valeur. Le retrait – L’agresseur se retire de son partenaire. Il agit ainsi pour susciter les craintes d’abandon de son partenaire et lui faire peur qu’il le quitte.
- Isolement social: Contrôle économique – L’agresseur garde tout l’argent, contrôle les comptes bancaires et les finances de son partenaire en ne lui donnant que de l’argent de poche et rien d’autre. Pas d’amis – L’agresseur isole son conjoint. Il ne lui permet pas de sortir, d’avoir des amis ou de fréquenter d’autres personnes. Pas de famille – L’agresseur empêche son partenaire de voir sa famille, contrôle son agenda social et/ou les médias sociaux, et détruit activement les relations entre son partenaire et sa famille. Surveillance du téléphone, du courrier électronique et des appels – L’agresseur vole le téléphone de son partenaire et le fouille et/ou oblige son partenaire à partager ses mots de passe.
- Abus physique: Il peut s’agir de gifles, de crachats, de poussées, de menaces, de coups, de bousculades et d’empoignades.
- Tactiques d’intimidation: Il peut s’agir de regards, de jets d’objets, de grognements et de menaces. Il peut également s’agir de méthodes passives agressives ou ouvertement agressives visant à effrayer le partenaire pour qu’il se soumette.
- Maltraitance des enfants: L’agresseur utilise les enfants comme des pions dans la procédure de divorce. Il peut également menacer de retirer les enfants à son partenaire. Il peut également s’agir de tout ce qui implique indûment les enfants ou de tout ce qui est destiné à effrayer le partenaire en utilisant les enfants.
Comment utiliser la « maison des abus »?
Commencez par demander une définition des types les plus évidents de conflit destructeur ou de comportement abusif d’une personne à l’autre dans une relation – cela donnera généralement lieu à des définitions qui impliquent la violence physique et probablement la violence sexuelle. Cela donnera généralement lieu à des définitions qui impliquent des violences physiques et probablement des cris et des hurlements. Posez la question : Quelles sont les façons dont une personne dans une relation intime adulte pourrait être destructrice ou abusive envers son partenaire ? Comment quelqu’un peut-il maltraiter quelqu’un d’autre ? Au fur et à mesure que le groupe identifie différents thèmes, identifiez les différentes pièces en et ajoutez certains des exemples dans la pièce où ils s’intègrent le mieux.
La forme de conflit destructeur que constitue le privilège du sexe féminin comprend l’insistance de la femme pour avoir plus de contrôle sur les décisions relatives à l’éducation des enfants ou sur la couleur du nouveau canapé. Si une femme insiste sur le fait qu’elle ne devrait pas avoir à travailler parce que c’est le travail de l’homme, nous avons là un exemple de privilège féminin.
- La religion. L’utilisation de la religion comme forme d’abus consiste à invoquer la Bible (ou autre livre sacré) pour rationaliser la domination. Il convient de souligner que, comme les statistiques, la Bible peut être interprétée pour expliquer à peu près n’importe quoi. Attention donc aux remarques qui peuvent sembler irrespectueuses à l’égard de la Bible ou de la religion, qui peuvent être très préjudiciables à la relation initiale. Il est souvent utile de commencer par suggérer qu’une forme de conflit destructeur peut consister à restreindre le droit d’un partenaire à aller à l’église qu’il souhaite ou d’insister pour qu’un partenaire participe à la religion alors qu’il n’en a pas envie. Au fil de la discussion, essayez de poser la question suivante : « Comment quelqu’un pourrait-il utiliser la Bible comme une forme de conflit destructeur ?
- Maltraitance des enfants. Toute forme de violence physique, sexuelle, verbale ou émotionnelle à l’égard des enfants est également un conflit destructeur pour le mariage. Utiliser les enfants comme des pions dans la bataille entre les parents ou menacer de faire du mal aux enfants en sont également des exemples. Cela peut souvent conduire à une discussion sur la façon dont les enfants maltraités deviennent eux-mêmes des agresseurs dans la génération suivante.
Après avoir établi les rôles de la Maison des abus, demandez aux membres du groupe de réfléchir aux questions suivantes :
- Est-ce une maison dans laquelle vous aimeriez vivre ?
- Vous n’avez pas besoin de dire quoi que ce soit à haute voix, mais voyez si vous reconnaissez l’une ou l’autre de ces pièces comme étant une pièce de votre maison actuelle.
- Là encore, ne dites rien à voix haute, mais voyez si vous reconnaissez certaines de ces pièces comme étant des pièces de la maison dans laquelle vous avez grandi.
- Diriez-vous que la plupart des exemples que nous avons trouvés sont des comportements illégaux ou criminels ? Si ce n’est pas le cas, sachez que nous définissons les comportements abusifs dans les relations comme tout ce qui est manifestement blessant ou destructeur dans cette relation, même si vous ne pouvez pas aller en prison pour cela.
A retrouver sur: https://mind-opener.com/articles/house-of-abuse/
SchechterS._GanleyA._A_Natural_Cirruculumn_for_Family_Preservation_Practitioners
 Une femme envisage de quitter son mari, qui la maltraite depuis cinq ans. Ce n’est pas la première fois qu’elle envisage de partir. Ses enfants sont effrayés par les cris de leur mère et les bleus sur son visage. Ils ne savent pas ce qui va se passer ensuite.
Une femme envisage de quitter son mari, qui la maltraite depuis cinq ans. Ce n’est pas la première fois qu’elle envisage de partir. Ses enfants sont effrayés par les cris de leur mère et les bleus sur son visage. Ils ne savent pas ce qui va se passer ensuite.
La violence au sein du foyer reste une épidémie cachée qui est souvent mal comprise par ceux qui n’ont pas été touchés par sa colère. Ils peuvent se demander : « Pourquoi ne part-elle pas ? ». « Pourquoi les hommes maltraitent-ils les femmes qu’ils aiment ? La maison des abus de Mike McGrane a été créée pour aider les auteurs de violence domestique à examiner leurs comportements et, espérons-le, à mettre fin à leurs abus. Cet exercice d’intervention a été utilisé dans de nombreux contextes avec des victimes/survivantes, des cliniciens, des conseillers en toxicomanie, l’armée, des lycées et des collèges, ainsi qu’avec le grand public dans le monde entier, afin d’améliorer la compréhension de ce problème complexe.
S’appuyant sur les trois décennies de travail de l’auteur avec les auteurs et les victimes/survivants, The House of Understanding Violence in the Home décrit chaque pièce de la maison des abus à travers les histoires des hommes et des femmes qui y ont vécu – et propose des conclusions sur les types d’interventions qui peuvent aider à ramener la paix dans la maison.
 Les questions ci-dessous constituent un guide sommaire pour le praticien qui s’enquiert des facteurs de risque connus chez la victime de violence conjugale. Bien que le praticien ne puisse pas prédire qui va gravement blesser ou tuer, s’il y a un ensemble de réponses positives aux questions sur les indicateurs de risque ci-dessous ou si la victime se sent en danger, le praticien voudra aider la cliente à à élaborer immédiatement un plan de sécurité pour elle-même et ses enfants.
Les questions ci-dessous constituent un guide sommaire pour le praticien qui s’enquiert des facteurs de risque connus chez la victime de violence conjugale. Bien que le praticien ne puisse pas prédire qui va gravement blesser ou tuer, s’il y a un ensemble de réponses positives aux questions sur les indicateurs de risque ci-dessous ou si la victime se sent en danger, le praticien voudra aider la cliente à à élaborer immédiatement un plan de sécurité pour elle-même et ses enfants.

 Violence conjugale: utiliser le schéma « la maison des abus » (House of Abuse) de Michael F. McGrane
Violence conjugale: utiliser le schéma « la maison des abus » (House of Abuse) de Michael F. McGrane



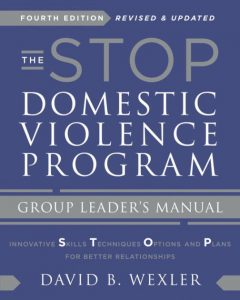
 David B. Wexler, Ph.D., est un psychologue clinicien exerçant à San Diego, spécialisé dans le traitement des relations conflictuelles. Il est le directeur exécutif de l’Institut de formation aux relations à but non lucratif, qui propose des formations et des traitements au niveau international pour le développement des relations et la prévention et le traitement de la violence dans les relations. Il a également été superviseur clinique et administratif de l’étude de recherche parrainée par le NIMH sur la violence domestique dans la marine, de 1991 à 1996, puis de 2001 à 2006.
David B. Wexler, Ph.D., est un psychologue clinicien exerçant à San Diego, spécialisé dans le traitement des relations conflictuelles. Il est le directeur exécutif de l’Institut de formation aux relations à but non lucratif, qui propose des formations et des traitements au niveau international pour le développement des relations et la prévention et le traitement de la violence dans les relations. Il a également été superviseur clinique et administratif de l’étude de recherche parrainée par le NIMH sur la violence domestique dans la marine, de 1991 à 1996, puis de 2001 à 2006.
 Elliot LOUAN: Responsable d’Etudes et de Recherches, IERDJ – CPIP ; chargé de formation probation/criminologie : formateur pratiques correctionnelles fondamentales (Core Correctional Practices) et évaluation des risques de récidive ; chargé d’enseignement DU Sciences Criminelles Angers, DU Evaluation et Prevention de la Récidive Lille, DU Criminologie ICP, M2 DHEP ENAP ; Intervenant occasionnel ENM, ENAP, SPIP, EP ; Membre du Comité National Violences Intra-Familiales (CNVIF) Commission Recherche ; candidat au doctorat en criminologie. Formé aux outils d’évaluation des risques suivants : VRAG, SORAG, HCR-20, LS-CMI, ODARA-ERVFO, STATIQUE-99R, STABLE, AIGU, SARA.
Elliot LOUAN: Responsable d’Etudes et de Recherches, IERDJ – CPIP ; chargé de formation probation/criminologie : formateur pratiques correctionnelles fondamentales (Core Correctional Practices) et évaluation des risques de récidive ; chargé d’enseignement DU Sciences Criminelles Angers, DU Evaluation et Prevention de la Récidive Lille, DU Criminologie ICP, M2 DHEP ENAP ; Intervenant occasionnel ENM, ENAP, SPIP, EP ; Membre du Comité National Violences Intra-Familiales (CNVIF) Commission Recherche ; candidat au doctorat en criminologie. Formé aux outils d’évaluation des risques suivants : VRAG, SORAG, HCR-20, LS-CMI, ODARA-ERVFO, STATIQUE-99R, STABLE, AIGU, SARA.